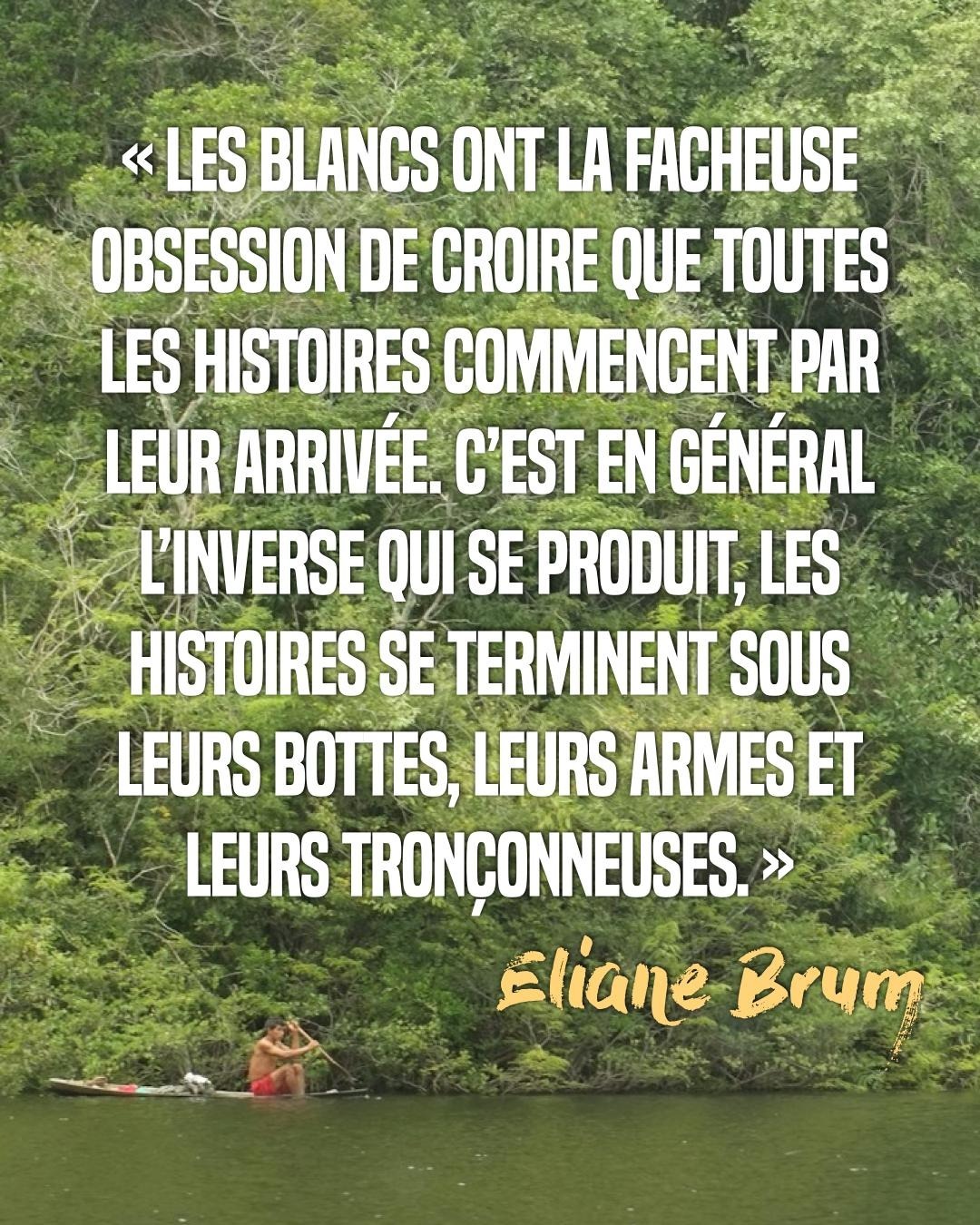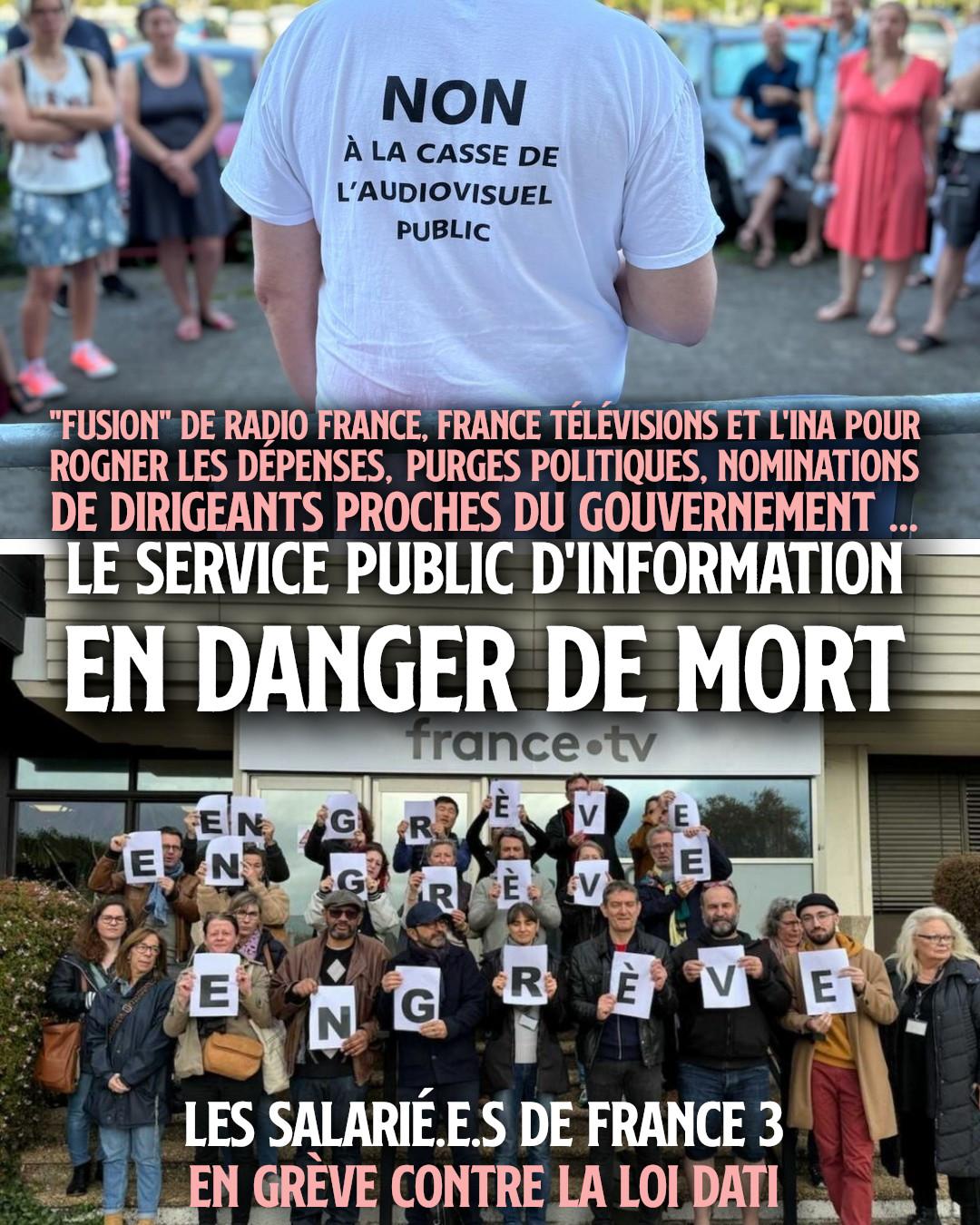C’est un ouvrage qui fait mouche avec l’actualité. Dans le livre « Pour la grève », qui vient de paraître, les auteurs explorent la grève sous sa dimension tactique, sensible, politique et sociale. Des pistes de réflexions à la veille de la grève générale du 5 décembre.

Quelques extraits :
«La grève est un bras d’honneur permanent. Suspendre la production, ne plus perdre sa vie à la gagner, c’est une rupture avec tout le sens qui tient le monde de l’économie. Cette gifle, répétée, affirme que l’économie n’est pas la seule chose qui importe, envers et contre tout. Tout ce qui fait tenir ce monde, c’est que pour ne pas mourir, il nous faut de l’argent. Cette peur sur laquelle s’établit l’exploitation capitaliste, nous l’avons tapie dans les plis de nos affects.
[…]
Chaque refus de ce qui nous entrave s’explique par là et porte les germes d’un antagonisme avec l’économie. Chaque refus est l’affirmation de notre inadéquation, elle est la mise à distance de l’économie, la constitution d’un espace qui s’en dégage : la grève.
Qu’on réclame un meilleur salaire ou une diminution du temps de labeur, qu’on réclame des aides sociales ou moins d’élèves par classe, qu’on refuse une pointeuse ou le fichage policier, qu’on se lève contre la construction d’une centrale à gaz ou contre un projet d’aéroport, dès que l’on s’érige face au lissage économique de toute chose, on fait grève.
[…]
En distinguant la grève du blocage et de l’occupation […] on a construit l’idée que ce ne sont plus des individus qui font grève, mais que seul le « mouvement social » fait grève, que seul il peut bloquer, peut occuper – séparément d’ailleurs. […] On détermine aussi qu’il faut des « représentants du mouvement social », que seul l’État juge comme tels – car il parle la même langue qu’eux – pour décider de ces moyens et de leurs fins. Pourtant cette volonté de réduire le sens de la grève est vaine. Car ce sont toujours des individus qui font grève et qui ensemble peuvent décider de ce qui a lieu.
Ce moment où le pouvoir est entre leurs mains conserve donc nécessairement sa potentialité révolutionnaire : celui de la reprise en main du temps. En témoigne aussi, évidemment, l’incroyable basculement qu’a provoqué le mouvement des Gilets Jaunes. Ou comment tout cet ordonnancement de la lutte s’est trouvé brisé d’un coup de marteau.
[…]
C’est pourquoi suite à une grève, il n’y a pour beaucoup d’entre nous plus de retour à la normale possible. Car, irrémédiablement, le sens que nous donnons à la vie en commun n’a pas place dans ce monde. […] Dans cette fracture qui s’ouvre, nous voyons bien qu’il y a quelque chose de pourri dans l’organisation de la société. C’est cela que l’ordre économique doit réprimer, et c’est cela que porte en germe chaque moment de lutte. […] C’est pourquoi au fond nous lutterons pour la possibilité éternelle de faire grève. Si nous espérons bien parvenir à un renversement de l’ordre en cours, nous entendons bien que toujours se conserve cette possibilité de mettre en arrêt la norme pour la questionner.»
AIDEZ CONTRE ATTAQUE
Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.