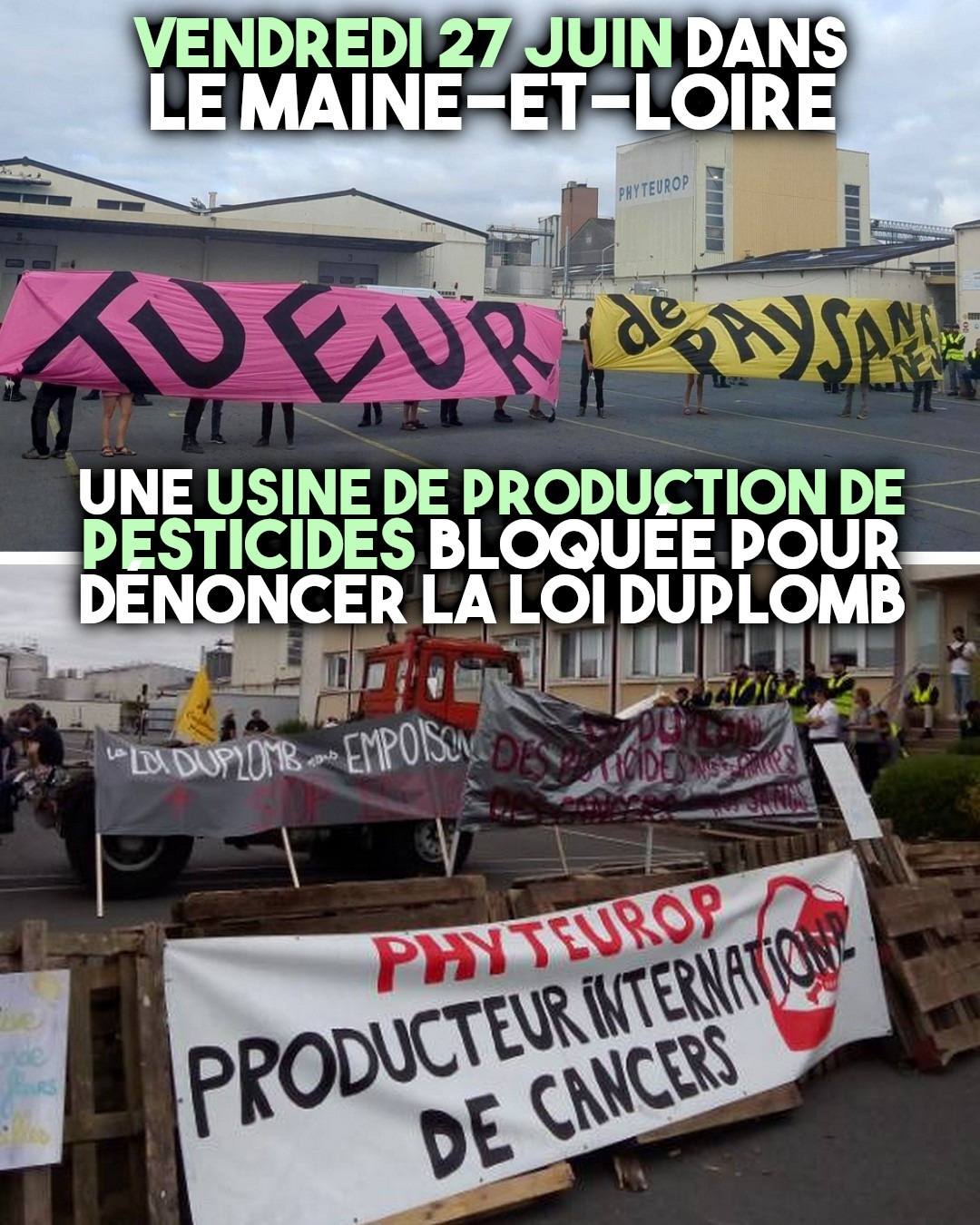INTRODUCTION
Il y a à peine quelques mois, le personnel soignant manifestait pour protester contre le manque de moyens et de personnels chronique dans les hôpitaux, conduisant à des mauvaises prises en charge des patients et à des burn-out de plus en plus fréquents dans les professions de santé. La réponse du pouvoir a été celle qu’il réserve désormais à toute contestation un tant soit peu progressiste, à savoir : le mépris, les coups et les blessures.
Quelques semaines plus tard seulement, la crise du Covid-19 dans le pays révèle que les hôpitaux publics n’ont jamais été doté de moyens suffisants pour faire face à une pandémie. Il fallait s’en doutait, quand les moyens ne suffisent déjà pas en période habituelle. Avec la crise sanitaire, l’ambiance devient dramatiquement surréaliste dans les CHU et particulièrement dans les services de réanimation.
Après avoir annoncé pendant des semaines qu’il n’y aurait pas d’épidémie en France, qu’on ne fermerait jamais les écoles, ou encore qu’il y avait des stocks massifs de masques, le gouvernement, se voit finalement obligé de fermer en catastrophe les bars et restaurants, les écoles mais…. maintient le premier tour des élections municipales. Et 24h après, il prononce le confinement généralisé.
Dès les premiers jours de la gestion de crise, on s’aperçoit qu’il n’y a pas de tests de dépistage en quantité suffisante pour permettre un allègement du confinement. On découvre également qu’il n’y a pas de stocks de masques en quantité suffisante ne serait-ce que pour les soignants, de même que des blouses et autres équipements de protection nécessaires. Dans de très nombreuses entreprises qui continuent de tourner, les protections sont inexistantes ou très insuffisantes (grandes surfaces, Amazon, chantiers navals…).
Pendant que ces scandales apparaissent au grand jour et que nous sommes confinés, donc sans possibilité de réagir collectivement pour demander des comptes, le gouvernement engage des dépenses faramineuses pour… acheter des drones, des grenades lacrymogènes et des paires de menottes ! L’armement du maintien de l’ordre est prioritaire pour l’État.
Pendant que la police poursuit ses méfaits, dans un cadre juridique qui lui donne encore plus de pouvoir (article sur l’état d’urgence sanitaire), notamment dans les quartiers populaires, le gouvernement lui achète des armes et des outils de surveillance et de contrôle, mais ne commande pas les masques nécessaires. Ce sont les grandes surfaces qui sortent de leur chapeau des millions de masques… qu’elles mettent en vente ! Des travailleurs et travailleuses sont ainsi invité-e-s à acheter des masques pour aller bosser. L’absurdité n’a décidément pas de limites.
Le début de déconfinement le 11 mai s’annonce dans la même veine. La reprise dans les écoles, faite pour que les parents retournent au boulot, est un aperçu angoissant du monde dans lequel nous allons évoluer à présent : pas de contact physique, pas de jeux avec objets, distanciation sociale… et les enseignants sont sommés de signaler les élèves qui émettraient un avis en contradiction avec celui du gouvernement.
Une société de la discipline, du contrôle, de la surveillance et de la délation se met en place.
Le pouvoir est plus prompt à mettre en œuvre un maintien de l’ordre extrême qu’à remettre en question sa politique de démantèlement du service public, notamment celui de l’hôpital.
Pourtant, c’est bien par des politiques d’austérité et de privatisations successives que des lits et des postes ont été supprimés, et que les services d’hôpitaux dont la réanimation se retrouvent saturés occasionnant une impossibilité de prendre en charge dignement les patients.
Il faut également remarquer que la crise du Covid-19 et la saturation des hôpitaux a eu pour conséquence que les gens se sont peu rendus chez leur médecin pour consulter, pour des symptômes ou pour leur suivi. Pour le dire simplement : les gens ne vont plus se soigner, par peur de désobéir, de rompre le confinement, de se contaminer, mais surtout, par peur d’engorger encore plus le système de soins. Bon nombre de ces personnes subiront ainsi des pertes de chance ou des retards dans leur prise en charge médicale avec de graves conséquences pour certains.
Comment se fait-il que, dans la 6e puissance économique mondiale, dont les dirigeants louent régulièrement le « meilleur système de soin », une épidémie d’un virus inconnu soit devenue ingérable ?
Ce dossier n’a pas vocation à être exhaustif ni à donner une réponse complète à la problématique. Les facteurs sont multiples et relèvent de la réalité de ce monde dans sa globalité. Les paragraphes qui vont suivre tentent de brosser un tableau général du système de santé publique en France et des réformes récentes ou plus anciennes qui l’ont façonné, ou plutôt asséché.
Outre la compréhension, toujours utile, du phénomène de démantèlement du service public de l’hôpital, on peut également y voir des pistes de réflexion à creuser sur la question du soin, des structures de soins, de l’accès aux soins et d’une organisation de la santé publique égalitaire et radicalement différente de celle d’aujourd’hui.
HÔPITAL PUBLIC : COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ?
Des services de réanimation débordés : c’est la première information des hôpitaux qui nous vient en cette période de crise sanitaire créée par la pandémie de Covid-19. Elle fait peur et à elle seule, elle provoque une grande partie de la peur qui règne de transmettre le virus, d’être responsable d’une nouvelle chaîne de transmission.
Cette crainte est créée par une propagande gouvernementale bien rodée autour de la culpabilisation individuelle, valable dans tous les domaines. Le pouvoir s’est notamment appuyé sur l’objectif affiché de protection des personnes vulnérables pour instiller une auto-responsabilisation dans la propagation du virus. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce discours a porté ses fruits. L’angoisse de transmettre le virus aux personnes âgées a empêché des enfants et des petits enfants de rendre visite à leurs parents et grands-parents, les personnes âgées étant a priori plus vulnérables face à la maladie. Ce qui fait de chaque enfant ou petit enfant venu rendre visite à ses aînés est considéré comme un criminel en puissance qui pourrait les tuer. *
Mais peut-on vraiment se mettre à la place des vieux et vieilles personnes pour décréter que leur vulnérabilité doit les forcer à s’isoler ? Les isoler, n’est-ce pas les rendre encore plus vulnérables ? Et que dire à celles et ceux qui décident de préférer mourir du Covid-19 que de passer leurs vieux jours seuls et de mourir dans la solitude ? Ce n’est pas parce que nos grands-parents sont plus vulnérables qu’ils n’ont pas le droit de décider de ce qu’ils veulent faire de leurs vieux jours. Au contraire, la première des dignités serait de leur laisser la possibilité de prendre cette décision, de prolonger leurs jours ou non, de les passer chez eux ou dans une structure collective, de sortir de leur espace de vie ou d’y rester. Personne n’a le droit de leur enlever le choix de leur fin de vie. Pendant que des résidents dans les EHPAD tambourinaient à la porte de la chambre dans laquelle ils étaient confinés, il paraît indécent de leur dire que c’est pour leur bien et qu’ils n’ont pas le choix. Et le discours du pouvoir qui prétend les protéger n’en est que plus amer.
Car c’est lui qui a confié les EHPAD à des personnes privées qui ne cherchent qu’à en tirer du profit. Quand le personnel des EHPAD manifestait contre les conditions de plus en plus lamentables dans lesquelles il travaille sans parvenir à assurer la mission de soins adaptés et d’accompagnement de fin de vie qui fait le sens de ce métier qu’ils ont choisi, le pouvoir est resté dans son déni habituel et a laissé nos vieux crever au milieu des soignants débordés au bord du burn-out. C’est également lui qui a livré les hôpitaux publics au marché et en a fait une machine qui se doit d’être rentable, au détriment de la santé des usagers. Les lignes qui suivent ont pour but de décrire succinctement les grandes étapes de cette évolution du service public de l’hôpital. Parce que la compréhension est un préalable important à toute lutte ambitieuse.
Au cours des années 1970 et 1980, petit à petit, les collectivités publiques se voient obligées d’emprunter à des banques privées aux taux du marché. Cela concerne les hôpitaux publics. Or, les taux peuvent être très variables et selon les périodes, ils peuvent être très élevés, jusqu ‘à 20 %.
En 1983, le tournant de la rigueur n’épargne pas les hôpitaux. Pendant près de deux décennies, il va être question de déterminer les coûts et les recettes de chaque hôpital.
LE PLAN JUPPÉ
En 1995, le plan Juppé instaure les Lois de financement de la Sécurité sociale (LFSS), qui ont pour but de fixer les orientations de politique de santé publique ainsi que les façons de les financer. Elles ont deux principaux effets : le premier est développé dans un article spécifique sur la sécurité sociale. Le second concerne les enveloppes budgétaires allouées aux établissements.
Chaque enveloppe est fermée : au début de l’année, un certain montant est attribué à chaque établissement (sur des critères que serons décrits plus bas) qui ne doit pas le dépasser. Rien n’autorise d’ajuster ce budget, et dans la mesure où l’État ne cesse de répéter qu’il faut « réduire la dépense publique », le montant alloué est insuffisant à pallier des pics d’activité qui peuvent se manifester dans les hôpitaux pour de multiples raisons. Ce système d’enveloppe fermée, par définition, ne se base pas sur les besoins mais sur une logique économique. L’alliance économie-santé n’est pas compatible, elle n’a pas de sens. La santé n’est pas un bien marchand, elle n’a pas de prix ni de coût. Mais le monde capitaliste a fait de chaque partie de notre corps, chaque morceau de notre esprit, chaque idée sociale et politique, un objet de convoitise susceptible d’être marchandé.
LE « PLAN HÔPITAL 2007 »
En 2003, après la canicule, l’État annonce le « plan Hôpital 2007 », qui ouvre une porte définitive vers la privatisation des hôpitaux.
Ce plan comporte 3 volets :
1) investissement hospitalier :
Ce plan annonce en grande pompe que l’État investira 6 milliards d’euros sur 5 ans (donc 1,2 milliards par an) dans les hôpitaux. Cette déclaration est en fait un piège ; la lecture des conditions précises de cet investissement a rendu amers bon nombre de praticiens hospitaliers. Si une partie est en effet destinée à l’investissement direct, une autre partie n’est en fait qu’une garantie à l’emprunt. Concrètement, l’État donne un matelas par exemple d’un million d’euros, mais ce n’est que pour que les établissements puissent en emprunter 10. Ce dispositif impose donc aux hôpitaux de se plonger dans le système de la dette bancaire.
De surcroît, les établissements sont contrôlés dans leurs perspectives d’investissement. Plus précisément, les Agences régionales d’hospitalisation (ARH, qui intègreront les Agences régionales de santé, ARS, plus tard) décident de la validité ou non des projets des établissements qui doivent donner lieu à emprunt. Sa décision est basée sur des critères de rentabilité et non de besoin des usagers. Un autre critère de choix essentiel est la création de « groupements de coopération sanitaire », qui visent à réunir des établissements publics et des établissements privés. Concrètement, ce qui est encouragé, c’est d’agrandir la structure des établissements publics pour pouvoir y accueillir des établissements privés. Parce que construire un hôpital public est a priori beaucoup plus simple que de bâtir une clinique privée, donc autant aller plus vite et agrandir un hôpital.
En réalité, ce qui semble très logique et prévu dans un souci de la santé des personnes n’est qu’un camouflet très libéral qui a déjà prouvé sa nocivité. Concrètement, ce qui se passe, c’est qu’une entreprise privée (le plan « Hôpital 2007 » impose que le secteur privé soit maître d’œuvre) construit un bâtiment rattaché à l’hôpital public, en assure l’entretien et la maintenance avec ses salariés de droit privé, et l’hôpital lui verse un loyer qui comprend l’entretien et la maintenance.
Il importe de relever que c’est aussi ce qui se passe dans les prisons : Bouygues rafle les marchés pour construire de nouvelles prisons ou en agrandir d’autres, en assure l’entretien et la maintenance, et la direction de la prison lui verse un loyer. Il s’agit donc d’une privatisation en marche.
2) la tarification à l’activité (T2A)
Cela découle d’une décision du ministère de la santé d’allouer les budgets aux hôpitaux non plus en fonction du budget alloué l’année précédente, mais en fonction d’une estimation de l’activité et des recettes. La prise en charge de chaque pathologie et de chaque acte reçoit une enveloppe pré-déterminée. L’an dernier, 300 pathologies X, dont le coût à l’unité est 50, ont été traitées dans tel hôpital ; celui-ci recevra 50 fois 300 euros pour cette pathologie. C’est le cas pour tout les actes et diagnostics, qui sont additionnés pour arriver à l’enveloppe totale pour l’établissement concerné.
Le nouveau principe de gestion qui interdit aux hôpitaux de dépasser le budget alloué limite notamment les durées d’hospitalisation par peur du dépassement de budget (car plus d’hospitalisation = plus d’actes par patient = plus rentable). Par ailleurs, les petits établissements situés dans des régions peu habitées ont fermé, parce que le coût des pathologies était trop élevé du fait de leur petit nombre et donc de l’impossibilité d’amortir leur coût. De la même façon, certains établissements ont cessé de traiter certaines pathologies coûteuses. En d’autres termes, ils ne sont pas suffisamment productifs donc ils coûtent trop cher à l’État donc ils doivent fermer. Au détriment de la santé des habitants, qui devront donc aller plus loin pour se faire soigner ; en réalité ils n’iront pas du tout ou bien trop tard.
L’État a souhaité rassurer le personnel soignant et les usagers en annonçant que, bien sûr, il y aurait des sous en plus pour les établissements qui prennent en charge des activités « d’intérêt général » telles que les urgences, ou des pathologies rares. Cependant, rien de précis n’a été évoqué, et au regard de la situation aujourd’hui, on ne peut que constater que les craintes développées à l’époque par le personnel soignant et certains syndicats sur le fait que ces ajustements ne seront pas du tout suffisants se sont vérifiées.
Les établissements publics sont ainsi entrés en concurrence entre eux en vue de capter les patients les plus « rentables », en délaissant ceux qui « coûtent trop cher ». Par ailleurs, cette concurrence dans le cadre des enveloppes fermées fait que si un établissement parvient à obtenir un budget plus important à un moment, un autre perdra de ce budget, par un effet de vases communicants.
3) la nouvelle gouvernance
Les hôpitaux se sont désormais organisés en pôles : géographiquement et médicalement, ce n’est pas illogique, mais le plan n’est pas relatif à l’organisation géographique des établissements, mais à sa gestion comptable. Concrètement, chaque pôle doit avoir un budget équilibré, et passe « un contrat d’objectifs et de moyens » avec la direction. Celle-ci peut alors décider d’abandonner des pôles pas assez « rentables ».
Les ARH (Agence Régionale d’Hospitalisation, qui seront remplacées par les ARS – Agence Régionale de Santé -, organes de l’Etat pour la gestion de la santé), par le biais des nouveaux « conseillers généraux des hôpitaux », ont un véritable pouvoir de contrôle de gestion des établissements de santé publics. Elles peuvent même en placer sous leur tutelle !
Pour résumer, la T2A a amené à la fermeture de nombreux petits établissements, à l’abandon du traitement de certaines pathologies dans des établissements, à une réduction illogique du temps passé en hospitalisation qui a conduit des patients à revenir plusieurs fois (puisque c’est tarifé au nombre d’hospitalisation)… Les inégalités devant le droit à la santé se sont creusées. Des centaines de milliers de personnes sont mal prises en charge, voire ne se déplacent même pas pour une consultation trop éloignée. Les personnes les plus fragiles financièrement, ainsi que les personnes âgées, sont les premières touchées par ces dispositifs.
Dans le même temps, le personnel soignant est impacté directement : plusieurs milliers de postes sont supprimés chaque année, les CDD se multiplient en lieu et place des CDI et bien entendu les cadences sont de plus en plus dures à supporter.
LA LOI HPST DE 2009
La loi HPST de 2009 (Hôpital, patients, santé et territoires) vient compléter et approfondir la transformation de l’hôpital en entreprise.
Tout d’abord, elle impose des regroupements d’établissements en supprimant le statut d’hôpital local. Ensuite, elle permet aux établissements publics de faire appel à des praticiens libéraux, donc issus du secteur privé, pour venir assurer la permanence des soins. C’est la porte ouverte aux suppressions de postes dans le public. Puisqu’on peut faire appel au privé, pourquoi serait-il ennuyeux de supprimer des postes publics ? En outre, elle permet aux établissements publics de créer des fondations pour la recherche financée par le privé, par l’industrie.
C’est la loi HPST qui crée les ARS (Agences régionales de santé) en les dotant d’un pouvoir très important de contrôle. Ce sont elles qui définissent et mettent en œuvre les politiques de santé au niveau régional, et elles ont pour charge de veiller à ce que tout le système de santé soit efficient et le moins coûteux possible. Le Directeur Général de l’ARS a le pouvoir de nommer des agents pour aller inspecter et contrôler que les objectifs soient bien remplis. On parle évidemment d’objectifs économiques, d’objectifs de rationalisation, et non de santé des populations. Il peut imposer des coopérations entre le public et le privé . Il peut imposer la réorganisation de l’offre de soins.
Les établissements peuvent se voir infliger des pénalités financières s’ils ne respectent pas les objectifs fixés dans le cadre de la politique régionale de santé alors qu’ils sont déjà contraints à des économies absurdes.
La loi HPST transforme également l’organisation interne des établissements, en particulier en donnant beaucoup plus de pouvoir au nouveau Président du Directoire, qui est en fait un véritable patron. Nommé par le pouvoir central, il nomme un certain nombre de personnels, il peut mettre fin aux fonctions de praticiens en cas de restructurations, il détermine les projets d’investissements, les tarifs des prestations, le projet médical… La représentation des personnels est limitée dans les instances de gestion (Conseil de Surveillance). Par ailleurs, le Président du Directoire nomme des chefs de pôle, qui ont pour mission d’assurer le fonctionnement du pôle et d’organisation l’affectation des ressources humaines. On a ainsi le sentiment que ces chefs sortent de nulle part, qu’ils sont là pour gérer la réduction des dépenses de santé et pour faire en sorte que les hôpitaux soient rentables, mais qu’ils sont bien éloignés des préoccupations liées à la santé des personnes et aux soins qu’il convient d’apporter pour cette santé. Le recours aux praticiens contractuels est fortement encouragé, afin de renforcer « l’attractivité » de l’hôpital public.
LA CRISE FINANCIÈRE DE 2008
Dans le même temps, la crise financière bat son plein, et elle n’épargne pas les hôpitaux, notamment ceux qui ont contracté des emprunts. Le rapport de la Cour des Comptes de 2018 s’inquiète du triplement de la dette des hôpitaux en 10 ans jusqu’à atteindre 30 milliards d’euros au moment de la publication du rapport.
Que s’est-il passé ? On a vu que les hôpitaux devaient désormais faire le grand plongeon dans le système de la dette bancaire. Or, en grands gestionnaires, les directeurs d’établissements ont parfois fait des choix très peu stratégiques voire catastrophiques. C’est souvent ce qui finit par se passer lorsqu’on décide de jouer les spéculateurs.
L’affaire DEXIA est emblématique de la situation. DEXIA est la banque privilégiée des collectivités publiques. Son patron pour faire gagner une somme conséquente d’argent à son entreprise, a emprunté à taux très bas et à très court terme sur les marchés… pour ensuite s’en servir pour le prêter aux collectivités publiques sur le long terme ! Seulement, la crise de 2008 assèche les liquidités, et Dexia finit par couler, non sans avoir perçu des dizaines de milliards d’euros de plusieurs Etats européens. Entre la tentative de sauvetage et le coût du démantèlement, ce ne sont pas loin de 90 milliards d’euros qui lui auront été offerts.
Les hôpitaux empruntaient également auprès de DEXIA, plus précisément dans son établissement suisse. Or, le franc suisse a pris de la valeur contrairement à l’euro, ce qui fait que les emprunts contractés ont gagné en valeur, et donc que les établissements publics de santé ont dû payer plus que ce qui avait été décidé au départ. C’est le principe des emprunts toxiques : le taux d’intérêt, de même que la valeur de la monnaie, sont variables, et les collectivités publiques sont toujours perdantes sur le marché, au détriment du contribuable.
Le résultat est très simple : les hôpitaux publics ont été poussés à emprunter eux-mêmes, à des taux élevés, ou, comme dans l’affaire DEXIA, à des taux devenus élevés. Et pour rembourser la dette, ils doivent être rentables, et donc faire payer plus aux usagers tout en réduisant le plus possible les « dépenses », les « coûts ». C’est ainsi qu’on en arrive à des suppressions de lits, de personnels, des cadences impossibles, des conditions de travail dégradées, et donc une offre de soins partielle et de mauvaise qualité.
En 2014, le pacte de responsabilité est dévoilé : l’État prévoit de faire 10 milliards d’économies sur les dépenses de santé en 3 ans. Tout est dit.
En 2016, l’INSEE affirme « Le nombre de décès a fortement augmenté en 2015. Il n’avait jamais été aussi élevé depuis l’après-guerre »
LA LOI SANTÉ DE 2016
La loi santé de 2016 ajoute sa pierre à l’édifice du démantèlement du service public.
Elle instaure notamment le GHT, Groupement Hospitalier de Territoire. Le GHT doit mettre en œuvre, sur un territoire donné, un projet médical unique. Tous les établissements dudit territoire doivent adhérer à un GHT ; ils sont contraints, pour ne pas perdre une grande partie de leurs financements (en d’autres termes, pour rester ouverts), de respecter les obligations posées par le projet médical. En outre, un établissement dit « support » doit se charger des questions administratives, techniques et de logistique. C’est donc une sorte d’externalisation de ces compétences qui est en cours, c’est-à-dire une immense porte grande ouverte vers la privatisation de ces métiers. Cela amène également à une mobilité forcée des personnels concernés. Enfin, l’organisation en « groupements » cache difficilement la conséquence obligée de fermeture de petites structures « non rentables » voire de services entiers qui ne rentrent pas dans le cadre du « projet médical ».
QUELQUES CHIFFRES ET DES RÉSULTATS CATASTROPHIQUES
Tous les ans, les LFSS ( loi de financement de la Sécurité sociale, voir plus loin) imposent de réduire les « dépenses de santé » et un nouveau budget, toujours plus drastique. En parallèle, elles imposent progressivement aux patients de payer plus de leurs poches. Ont ainsi été mises en place des franchises sur des médicaments, sur les transports sanitaires, sur les actes hospitaliers dont le coût est supérieur à 91€… Et c’est le Parlement, qui le vote. Il ne faut pas oublier non plus les dépassements d’honoraires qui se banalisent. La LFSS de 2019 a instauré un plafond pour les dépenses de médicaments onéreux, dont le dépassement coûterait très cher aux hôpitaux.
La LFSS pour 2016 impose une réduction des dépenses de santé de 3,4 milliards d’euros ; celle pour 2017 en demande 4 milliards. Lesdites « dépenses de santé » impactent aussi bien les hôpitaux publics, qui font ainsi face à un manque de moyens pour soigner correctement, et la Sécurité sociale, qui donc rembourse moins les soins (même insuffisants).
En 2016, 20 % du personnel hospitalier, soit environ 200 000 agents, étaient contractuels.
En 2017, 22 000 postes ont été supprimés dans la santé publique.
En 2016, 30 % de la population repousse ou renonce aux soins en raison de leurs coûts.
Entre 2013 et 2018, ce sont environ 17 500 lits d’hospitalisation complète qui ont été supprimés.
Entre 2003 et 2016, ce sont 64 000 lits (13 % du total) qui sont supprimés. A peine un tiers est remplacé par des lits ambulatoires.
Pour justifier ces économies, le gouvernement explique que l’ambulatoire se développe. Les soins en ambulatoire sont des soins médicaux pratiqués sans hospitalisation, c’est-à-dire sans rester à l’hôpital, ou pas plus d’une nuit.
En soi, pourquoi pas : il n’y a pas toujours besoin de rester à l’hôpital. Seulement, l’objectif est de faire des économies, alors il est à craindre que l’ambulatoire ne soit qu’une mauvaise prise en charge des patients. Pour décider de garder une personne ou non, il faut en effet prendre en compte son univers familial, son univers professionnel, la qualité de leur vie et de leur environnement… Si le critère est celui de la nécessité économique de l’établissement, les soins ne seront pas adaptés. Le raisonnement, même dans une logique purement comptable, est illogique : un patient qui se voit administrer des soins puis renvoyer chez lui à la va-vite devra revenir à l’hôpital, ce qui coûte plus cher que si une hospitalisation avait eu lieu. Ou bien il ne reviendra pas du tout et fera partie des 30 % qui ne se soignent même plus ou mal…
Nous sommes dans un État dont le fonctionnement est cynique.
Deux hypothèses : soit il estime que son calcul économique est bon et logique. Il devient alors urgent de le renverser pour son incompétence chronique ;soit il a parfaitement conscience de son erreur et mise sur le fait que les patients ne reviendront pas et se laisseront dépérir en mauvaise santé. Et il est donc aussi urgent de le renverser.
Les dynamiques de rationalisation et de rentabilité imposées à l’hôpital public ont conduit des millions de personnes à renoncer aux soins ou à être mal pris en charge. Et nous ne sommes pas au bout de nos peines. La crise du Covid-19 a fait éclater aux yeux de toutes et tous que les hôpitaux en France n’ont tout simplement pas les moyens de faire face à la diffusion d’un virus inconnu.
Macron nous a parlé du « monde d’après », faisant croire à une prise de conscience.
Mais, au cours de cette période de crise, il a fait des choix tout à fait révélateurs en commandant des drones et des hélicoptères, en distribuant des plus d’amendes que de masques, en achetant des armes pour la police… tandis que des hôpitaux, consternés, font appel aux dons pour s’en sortir. Si, même pendant une telle crise, l’État est incapable de créer les conditions pour que des soins adaptés puissent être administrés à toutes et tous, dans la dignité et l’attention aux patients, il ne peut être à la hauteur de l’ « après ».
Il nous revient, nous, salarié-e-s, chômeurs et chômeuses, blouses blanches, gilets jaunes, gilets noirs et chaque personne qui rêve d’une révolution sociale, d’exiger l’instauration d’une véritable santé publique solidaire et universelle, gérée non par l’État et encore moins par des prestataires privés, mais par une conjonction de patients et de praticiens, qui devra rompre sans concession avec les logiques libérales qui ont détruit la solidarité et l’accès aux soins pour toutes et tous.
LA SÉCURITÉ SOCIALE, HISTOIRE D’UN DÉMANTÈLEMENT
La Sécurité sociale n’est pas un concept contemporain. On peut même remonter au Moyen Âge pour en chercher des vestiges, notamment dans l’action des confréries religieuses auprès des démunis. Mais ce sont surtout les sociétés de secours mutuel, créées par les ouvriers eux-mêmes peu avant la Révolution, qui sont révélatrices. Cependant, elles ne concernent que les ouvriers capables de cotiser, ce qui reste assez limité. Par ailleurs, le patronat, dans un objectif de fidélisation de « ses » ouvriers, met en place quelques systèmes pour couvrir les maladies ou les retraites. L’État intervient très peu dans ce domaine, ce qui tend à créer des inégalités entre les travailleurs, mais aussi entre travailleurs et chômeurs.
Si, en 1910, le gouvernement crée les retraites ouvrières et paysannes, ces retraites sont payées par les ouvriers, ce qui fait bondir la CGT qui crie au vol. En 1930, les lois sur les Assurances sociales adoptées progressivement depuis 2 ans protègent contre les conséquences des maladies, de l’invalidité et du décès, instaurent une indemnité pour la retraite, et, c’est important de le noter, prévoient une indemnisation pour la maternité. Cependant, le système de plafond de salaires fait que tous les salariés ne sont pas bénéficiaires de ces mesures. De surcroît, les sommes allouées sont trop modestes.
Enfin, le système de retraite est celui de la capitalisation, donc pas du tout solidaire. Néanmoins, une avancée indéniable se retrouve dans le fait que l’employeur paie une partie des cotisations. En revanche, un problème majeur se pose dans l’organisation des structures chargées de l’application de toutes ces mesures : il y a trop de structures, ce qui empêche une lisibilité nécessaire à la compréhension, et donc à l’application, des droits.
La Sécurité sociale constitue un pas en avant gigantesque et pallie à tous les problèmes liés aux expériences précédentes.
Tout d’abord, elle est financée par la cotisation, elle-même assise sur la production de richesse et in fine sur le salaire.
Mais l’ambition de la Sécurité sociale est de couvrir tout le monde, et non plus seulement les salariés ; de couvrir tout le monde en fonction des besoins et non en fonction des cotisations versées.
L’idée est également de créer une structure unique qui gère les risques liés à la retraite, à la maladie, aux accidents du travail et à la famille (les « 4 grands risques sociaux »).
Enfin, la gestion de cette caisse doit être confiée aux travailleurs, par l’intermédiaire des syndicats.
Tout ceci va à peu près être réalisé, surtout le dernier point. Il faut bien prendre conscience du caractère révolutionnaire de cette mesure : l’État organise une couverture sociale pour toutes et tous, et ce sont les travailleurs qui la gèrent. La droite a évidemment hurlé et tempêté contre cette proposition, mais l’influence du CNR (Comité National de Résistance, voir ci-après) était encore très importante à ce moment-là et a permis l’adoption du système de sécurité sociale dans son ensemble.
Il y a une exception à ce régime universel : ce sont les régimes spéciaux, dont on entend tant parler. Présentés par le discours dominant comme étant des privilèges injustes parce que plus avantageux que le régime général de la Sécurité sociale, ils revêtent une histoire bien différente.
Tout d’abord, contrairement à l’idée reçue, ils n’ont pas été créés en même temps que le régime général, mais parfois des décennies auparavant. Ensuite, il s’agit de régimes instaurés par des luttes très fortes, qui ont fait céder les patrons non parce qu’ils étaient socialistes, mais pour assurer une stabilité de la main d’œuvre dans des métiers très risqués physiquement (notamment dans les mines et les chemins de fer). Peut-on reprocher aux travailleurs de ces métiers de souhaiter conserver leurs acquis ? Non ; il faudrait que le régime général soit à la hauteur des régimes spéciaux, et non l’inverse. En tout état de cause, décrier ces régimes spéciaux est une façon de mettre en concurrence les travailleurs pour éviter qu’ils ne s’allient tous contre le patronat et l’État.
Au moment de sa mise en place, la Sécurité sociale ne prend pas en compte les travailleurs indépendants et les travailleurs agricoles, ce qui constitue une faille dans sa volonté d’universalité.
Rapidement, le patronat et l’État vont trouver un terrain d’entente naturel : remettre en cause les fondamentaux de la Sécurité sociale.
Le patronat soulève tout un tas d’arguments, certains tout simplement absurdes, d’autres guidés pour leur représentation idéologique de ce que doit être le monde. Il explique par exemple que la Sécu créérait l’inflation, qu’elle coûte cher aux entreprises qui doivent freiner leurs investissements, et même leur productivité, elle fait augmenter les dépenses de soin et encourage les abus… Pour appuyer son discours, il transforme le terme de « cotisations sociales » en « charges sociales », afin de bien faire intégrer à toutes et tous que la Sécu coûte cher aux patrons.
Dès 1958, à l’orée de la Ve République, De Gaulle annonce l’augmentation des cotisations salariales ainsi que l’instauration d’une franchise sur les médicaments. Il est cependant contraint de reculer face à la contestation populaire.
L’ordonnance du 21 août 1967 constitue une attaque d’ampleur contre la Sécurité sociale. Elle rompt avec le système de caisse unique et crée 3 structures distinctes : une pour la maladie, une pour la retraite et une pour les allocations familiales. Dans le même temps, elle enlève du pouvoir aux syndicats qui s’occupaient de la gestion de ses caisses en renforçant la tutelle de l’État et introduisant le principe de la parité, ce qui amène le patronat à mettre son nez dans les affaires sociales. Enfin, elle augmente la cotisation ouvrière.
En 1991 est créée la CSG, qui modifie profondément le financement de la Sécurité sociale, en introduisant l’impôt prévu pour remplacer la cotisation (voir rubrique suivante)
En 1995, le plan Juppé prévoit que chaque année, le Parlement devra voter une Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS), qui détermine les politiques de santé et de Sécurité sociale et leurs modes de financement. Tout d’abord, cette mesure renforce le contrôle de l’État sur les caisses de la Sécu, puisque c’est lui qui planifie son financement. Lorsque seules les cotisations finançaient la Sécu, le régime était à la fois plus simple et plus clair, plus transparent. La LFSS introduit de la complexité et de l’opacité (il faut savoir les lire ces lois !!).
Concrètement, une LFSS est un document budgétaire qui, à partir des rentrées de cotisations sociales, fixe où doivent aller ces deniers : matériel, personnel, remboursement de médicaments, paiement des indemnités en cas d’arrêt maladie, etc.
Ainsi, chaque LFSS détermine ce qu’on appelle l’ONDAM : Objectif national des dépenses d’assurance maladie. Il s’agit d’un moyen de contrôler ces dépenses en les réduisant le plus possible. En d’autres termes, l’objectif est de limiter les arrêts maladie, les remboursements de médicaments et de soins d’une manière générale. Encore une fois, le calcul budgétaire et la volonté de réduction des « dépenses de santé » se font au détriment du soin à apporter aux personnes. Pendant ce temps, les patrons sont de plus en plus exonérés des cotisations sociales !
La LFSS, une fois votée, se base sur un système d’enveloppes fermées : pour chaque point est attribué un montant qui ne peut changer. Ce système figé est parfait pour le gouvernement qui, face aux protestations, ne peut que se contenter de rejeter la faute sur le Parlement qui a adopté cette loi. Un autre effet dangereux de ces enveloppes fermées, est qu’elles poussent les établissements à la concurrence. En effet, d’une part les établissements vont avoir tendance à se battre pour obtenir la meilleure enveloppe, et d’autre part, ce qu’un établissement va gagner sera pris sur le budget d’un autre.
En 2013 est adoptée une loi qui rend la complémentaire santé obligatoire dans toutes les entreprises.
La complémentaire santé est gérée soit par une assurance soit par une mutuelle, la première étant à but lucratif contrairement à la seconde. Elle est prévue pour couvrir les frais qui ne sont pas couverts par l’assurance maladie (la Sécurité sociale), comme les dépassements d’honoraires par exemple. Le fait de rendre obligatoire la complémentaire dans les entreprises permet, dans les faits, aux patrons de ne pas payer de cotisations sociales, puisqu’il permet à ses employés de bénéficier d’une complémentaire (payante pour le salarié évidemment). L’État a donc fait sciemment le choix d’inciter les patrons à ne plus verser de cotisations à la Sécu, mais de les réserver pour des structures privées. Il est à craindre que ce système privé se substitue petit à petit à celui de la Sécurité sociale. Celle ci, issue initialement d’un mixte entre les modèles Bismarckiens et Beveridgien a tendance à se libéraliser. Ce qui aura pour effet, entre autres, de forcer les non salariés (chômeurs, étudiants, retraités, RSAstes et personnes sans aucune ressource) à payer cher pour souscrire une assurance complémentaire.
Les gouvernements, de « gauche » comme de droite, ont adopté le discours du patronat qui se plaint constamment du « poids des charges sociales » pour ne pas avoir à payer sa part juste de cotisations. Tant et si bien que lesdites « charges » ont été fortement réduites pour de très nombreuses entreprises.
A titre d’exemple, en 2019, ce sont 90 milliards d’euros de cadeaux qui ont été faits au patronat, et qui donc n’ont pas été versés à la Sécurité sociale. Gérard Darmanin, ministre des comptes publics, s’est alarmé à grands cris dans la presse que le « trou d’la sécu » s’élève aujourd’hui à 41 milliards d’euros.
Ce sont ces cadeaux aux patrons que l’on appelle des niches sociales. Le déficit de la Sécurité sociale ne vient donc pas d’un excès de dépenses sociales, de « cadeaux aux plus démunis » encore moins de « fraudes » ou d’ « abus », il vient tout simplement des cadeaux offerts aux patrons pendant que les salariés trinquent sur tous les plans.
Néanmoins, un communicant habile du gouvernement pourrait rétorquer que la LFSS pour 2019 a également introduit une diminution des cotisations sociales des salariés, qui donc ne paient pas forcément plus que les patrons. Le gouvernement veut en fait nous amener à dire que nous ne voulons pas payer de cotisations.
Ce raisonnement est un piège aux crocs acérés. Retirer des cotisations sociales n’empêche nullement à l’État de nous faire payer plus d’impôt, comme la CSG. Or, c’est exactement l’inverse qu’il faudrait faire : supprimer la CSG mais maintenir le financement par cotisations.
Par ailleurs, une augmentation de salaire ne signifie pas une baisse des cotisations, mais signifie que le patron verse plus aux employé-e-s. Diminuer les cotisations des salariés n’est en aucun cas une augmentation de salaire. Le discours qui prétend le contraire sert les intérêts des patrons, qui conservent les bénéfices pour eux seuls alors qu’ils devraient les reverser aux salariés et ainsi augmenter leurs salaires. Ceci permettrait de maintenir un niveau juste de cotisations sociales pour que la Sécurité sociale revienne à ses principes mis en place à la Libération et reste sous le contrôle du public. Enfin, il est nécessaire de cesser les cadeaux au patronat et de faire payer aux employeurs la part des cotisations qui leur revient.
LA CSG, IMPÔT VS COTISATIONS : EXPLICATIONS
On a vu que, dès la création de la sécurité sociale en 1945, le patronat n’a eu de cesse que de se démener pour la briser. S’il n’a pas pu s’y opposer au moment de sa création, notamment parce qu’une majeure partie du patronat s’était clairement engagé dans le régime fasciste de Vichy pendant la deuxième guerre mondiale, il a très vite rebondi et a pu s’appuyer sur les gouvernements successifs dont la priorité n’a jamais été la révolution sociale (tout juste la réforme…).
Les ordonnances de 1967, explicitées précédemment, en sont un exemple flagrant. Dans la droite lignée de ces mesures, fin 1990, le gouvernement « socialiste » de Michel Rocard crée la contribution sociale généralisée (CSG), un nouvel impôt qui a pour but de financer la sécurité sociale.
Jusque-là, la Sécurité sociale était financée par un système de cotisation sociale. En effet, les concepteurs de la Sécurité sociale avaient basé son financement sur la production de richesses, qui est exclusivement le fait du travail. La cotisation est donc assise sur le salaire. Ce système, contrairement à celui de l’impôt, permettait que la Sécurité sociale soit gérée par les travailleurs, via les syndicats.
Le gouvernement Rocard change donc complètement la donne en instaurant l’impôt qu’est la CSG. En effet, il permet ainsi à l’État de reprendre en main le fonctionnement de la Sécurité sociale ainsi que sa gestion, en écartant les travailleurs (cette dynamique était déjà en cours avec les ordonnances de 1967). Par ailleurs, le recours à l’impôt ouvre la voie à l’intervention de prestataires privés ainsi qu’à la mise en place de dispositifs individualisés. L’idée de base de la Sécu était au contraire une vraie solidarité, un esprit de collectivité qui fait cruellement défaut de nos jours. Tout le monde en était bénéficiaire. Par une pirouette politique admirable, c’est précisément sur ce point que le gouvernement s’est appuyé pour justifier la création de cet impôt. Il a en effet affirmé que puisque la sécurité sociale est universelle, alors TOUS les revenus, et non plus seulement les salaires, doivent contribuer à son financement. C’est ainsi que la CSG est ponctionnée sur les salaires toujours, mais aussi sur les retraites, le patrimoine, les indemnités chômage, les revenus des jeux et les placements financiers.
Ce que le gouvernement dit un peu moins, mais que le patronat ne cesse de clamer depuis la création de la Sécu, c’est que tous deux se plaignent que les « charges sociales », c’est-à-dire les cotisations sociales que les patrons doivent verser, sont trop lourdes et que ça nuit à la productivité et à l’économie en général. « L’économie serait menacée par les charges sociales » : C’est dans l’objectif de « ne pas nuire à l’économie » que la CSG a été créée et qu’elle augmente très régulièrement. Depuis 2018, elle est même prévue pour financer l’assurance chômage. Les gouvernements successifs ont tant et si bien obéit au patronat qu’en 2017, la part des salariés et des retraités dans le financement de la CSG atteignait 89,7 %, épargnant ainsi très largement les patrons.
Si la CSG est encore minoritaire dans les sources de financement de la Sécurité sociale, elle introduit une brèche colossale dans laquelle tous les gouvernements s’engouffrent pour en finir avec le système solidaire.
Une grande partie de l’héritage de la Sécurité sociale, conquise par le sang des Résistant-e-s, est donc déjà tombée aux oubliettes. La gestion de la caisse par les travailleurs est un lointain souvenir. Son caractère solidaire, collectif, est également très fortement mis à mal. L’avenir de ce legs du CNR est tout tracé : la protection sociale s’oriente vers une privatisation et une individualisation.
Ce n’est bientôt même plus l’État qui gérera ses caisses, mais des prestataires privés. Et les prestations ne seront pas versées en fonction des besoins, mais en fonction des moyens.
La crise sanitaire actuelle est révélatrice de ce côté-là : aux Etats-Unis, où le coût d’une hospitalisation s’élève à plusieurs milliers d’euros au minimum, des milliers de personnes meurent chez elles, dans l’oubli, dans l’indifférence générale et dans l’indignité la plus totale. Parce qu’elles n’ont tout simplement pas les moyens de se soigner. Des familles contractent des emprunts pour pouvoir se soigner ; leur vie n’est alors qu’une longue histoire de dur labeur pour tenter de rembourser ces prêts.
En France, des habitant-e-s, des médecins et des élus locaux ont tiré la sonnette d’alarme au sujet de la sur-mortalité observée au cours de cette crise sanitaire dans le département de Seine-Saint-Denis, l’un des plus pauvres du pays. La précarité y est forte, les infrastructures de soins insuffisantes. Ces deux facteurs constituent les principales causes de la sur-exposition de ses habitants et habitantes au Covid-19. Beaucoup trop n’ont pas les moyens de se soigner. Et les logiques ultra-libérales qui gouvernent la santé publique depuis des décennies ont conduit à des déserts médicaux ou bien à des structures de santé insuffisantes, qui n’ont même pas les moyens de soigner correctement les personnes.
Tout est ainsi lié : déliquescence de l’hôpital public, sécurité sociale en voie de privatisation… Il est urgent de retrouver un mode populaire de gestion de la sécurité sociale et de cesser de faire des cadeaux aux patrons pour « sauver l’économie ».
LA SANTÉ POUR TOUTES ET TOUS : LE CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE, UN PROGRAMME QUI DÉRANGE
Dans les quelques semaines qui précèdent la Libération effective de la France, le Conseil National de la Résistance (CNR), crée en mai 1943, adopte un programme : Les jours heureux.
Le CNR regroupe une grande partie des forces politiques qui s’opposent au régime de Vichy et à l’occupation pendant la deuxième guerre mondiale. S’y retrouvent autant des mouvements de résistance armés que des syndicats et des partis politiques : la CGT et la CFTC, le parti communiste mais aussi la droite républicaine. Il n’est donc pas simple de trouver un accord commun, à peu près autant qu’il a été complexe de réunir la Résistance au sein de ce Conseil. Néanmoins, la période extrêmement difficile vécue fait que par-delà les différences voire les clivages profonds, il était absolument nécessaire de proposer un après publiquement, un après qui brise les murs de la clandestinité. Presqu’un an après sa création, le CNR parvient ainsi à s’accorder sur le programme le 15 mars 1944.
En premier lieu, Les jours heureux est un appel clair à intensifier la lutte armée et à l’insurrection du peuple contre le régime de Vichy. Et même plus qu’un appel, il s’agit carrément d’un plan visant à préparer l’insurrection pour libérer la France.
En deuxième partie, il est question des mesures à prendre dès la libération du territoire.
Le CNR prévoit ainsi de nationaliser un grand nombre de secteurs : l’énergie, les banques, les assurances notamment.
Il préconise également que les salariés participent à la direction de l’économie, que les ouvriers puissent accéder aux fonctions de direction et d’administration de l’entreprise et que l’État doit planifier la production en consultant tous les secteurs de celle-ci
Enfin, il propose un système complet de sécurité sociale qui soit à même d’assurer à chaque citoyen des moyens d’existence décente.
Une grande partie du programme est en effet mise en œuvre, comme nous allons le voir, ce qui constitue indéniablement une victoire, mais est toutefois nuancée par la perte de pouvoir progressive du CNR et par une pression toujours plus forte des lobbys réactionnaires. En d’autres termes, les ambitions fondamentalement révolutionnaires d’une partie de la Résistance ont été mises en échec par des velléités plus réformistes, autant par peur du changement que par conviction idéologique. Toutefois, le soutien populaire dont il jouit ainsi que sa persévérance à maintenir une pression sur les hommes politiques, notamment sur De Gaulle, conduit à l’application quasi complète de son programme.
La réussite incontestable de ce programme tient également en ce que sa préparation de l’insurrection s’est bien réalisée. En effet, quelques semaines avant la Libération, des grèves eurent lieu dans plusieurs endroits, et particulièrement à Paris. En réalité, on peut même affirmer que Paris s’est libérée elle-même, par des grèves insurrectionnelles.
Ainsi sont bel et bien nationalisés les secteurs du gaz, de l’électricité, du transport aérien, des banques, du chemin de fer, des assurances, des combustibles minéraux. Ces secteurs deviennent de fait la propriété de tous les citoyens français.
Des comités d’entreprises sont créés, visant à la participation des travailleurs à la gestion de l’entreprise.
L’ordonnance du 4 octobre 1945 crée la sécurité sociale.
Depuis 1947, la suite de l’histoire n’est qu’une remise en question constante des acquis du CNR et de la Libération. Les banques et les assurances sont désormais des entreprises privées, la SNCF est en voie avancée de privatisation, le gaz et l’électricité sont en très grande partie privatisés…
Les instances de représentation du personnel ont vu leurs pouvoirs décliner, leur faisant perdre contact avec la base salariale de l’entreprise. La loi travail de 2016 est emblématique de la toute puissance du patron pour imposer ses cadences au travail. Et les ordonnances passées sous le régime de l’état d’urgence sanitaire sont encore plus brutales. Le pouvoir s’acharne à faire oublier que la Résistance, armée pour une partie, est parvenue à imposer un changement social d’ampleur dans un contexte où le fascisme européen était encore puissant. L’insurrection du peuple a permis à celui-ci de reprendre une partie de sa vie en main et à être acteur du changement. Mais une fois la Libération et la chute du régime de Vichy et du IIIe Reich advenues, les institutions habituelles ont bien vite repris le dessus.
Ainsi, en juin 1944 est crée le Gouvernement provisoire de la République française, qui commence à remettre en place une organisation politique et administrative sans guère tenir compte de celle qui existe déjà par l’action des résistants. Les Comités départementaux de Libération sont petit à petit remplacés par la nouvelle administration préfectorale. 2 ans plus tard, en octobre 1946, la nouvelle Constitution est promulguée et instaure la IVe République, qui ressemble beaucoup à la IIIe d’ailleurs. Elle sera courte et bientôt la Ve République verra le jour, 12 ans après la création de la IVe. Cette volonté acharnée d’un « retour à la normale » est révélatrice. Il s’agissait tout à la fois de freiner les velléités révolutionnaires de nombre de résistants, de créer un régime stable, de fermer une « parenthèse », de relancer l’économie… Le résultat est multiple et on le voit bien aujourd’hui. Tout d’abord, la mémoire concernant le programme du CNR et la Résistance s’est très vite perdue et est méconnue. D’autre part, aucun pouvoir en place après la libération n’a expliqué que le régime de Vichy était un régime fasciste, ce qui a exonéré la majorité de la population française d’une remise en question légitime. Le régime de Vichy nous paraît lointain, il nous apparaît comme une parenthèse qui a été vite résolue par la résistance armée ou par le débarquement des américains. En revanche, il est moins connu que beaucoup de pro nazis sont restés en poste après la chute du régime et le « retour à la normale ». Cette volonté de revenir aux institutions officielles d’avant, de ne plus parler de toute cette horreur de la deuxième guerre mondiale, a étouffé les voix de celles et ceux pour qui la lutte contre le fascisme ne s’arrêtait pas à faire tomber un régime mais devait se poursuivre dans une révolution sociale d’ampleur. Le CNR aurait pu jouer ce rôle de promoteur de la révolution. Mais sa composition ne s’y prêtait pas : tous les partis politiques n’étaient pas révolutionnaires, loin s’en faut ; en témoigne par exemple le fait que le droit de vote des femmes n’ait pas été inscrit au programme du CNR. En outre, après la Libération, certaines composantes ont reconnu les institutions officielles du Gouvernement provisoire, notamment le Parti communiste. Ce qui empêchait de fait une véritable transformation de l’organisation politique et sociale du pays. La suite le démontrera.
Si les gouvernements successifs ont détruit le programme du CNR avec un certain succès, ils n’ont pas pu éteindre complètement les braises de révolte et d’exigence de justice sociale au fur et à mesure des générations.
Aujourd’hui, le mouvement des Gilets Jaunes a, plus qu’aucun autre mouvement de ces dernières décennies, fait appel à l’héritage du CNR sans le nommer, de façon spontanée et déterminée. Dans la même lignée, les voix qui se font entendre depuis le début de crise sanitaire, critiquant l’action du gouvernement, réclament également ce que le CNR avait imposé : la justice sociale, la liberté, la santé pour toutes et tous quels que soient les revenus, in fine la sécurité sociale universelle, la retraite.
Mais il nous faut aller plus loin et exiger que cet héritage du CNR (hôpitaux, EHPAD, CAF, chômage, les transports, l’énergie…) ne reste pas aux mains de l’État « chef d’entreprise » et grand acteur de la finance.
Pour que cet héritage vive, il faut que les bénéficiaires et les travailleurs de ces structures se l’approprient.
AIDEZ CONTRE ATTAQUE
Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.