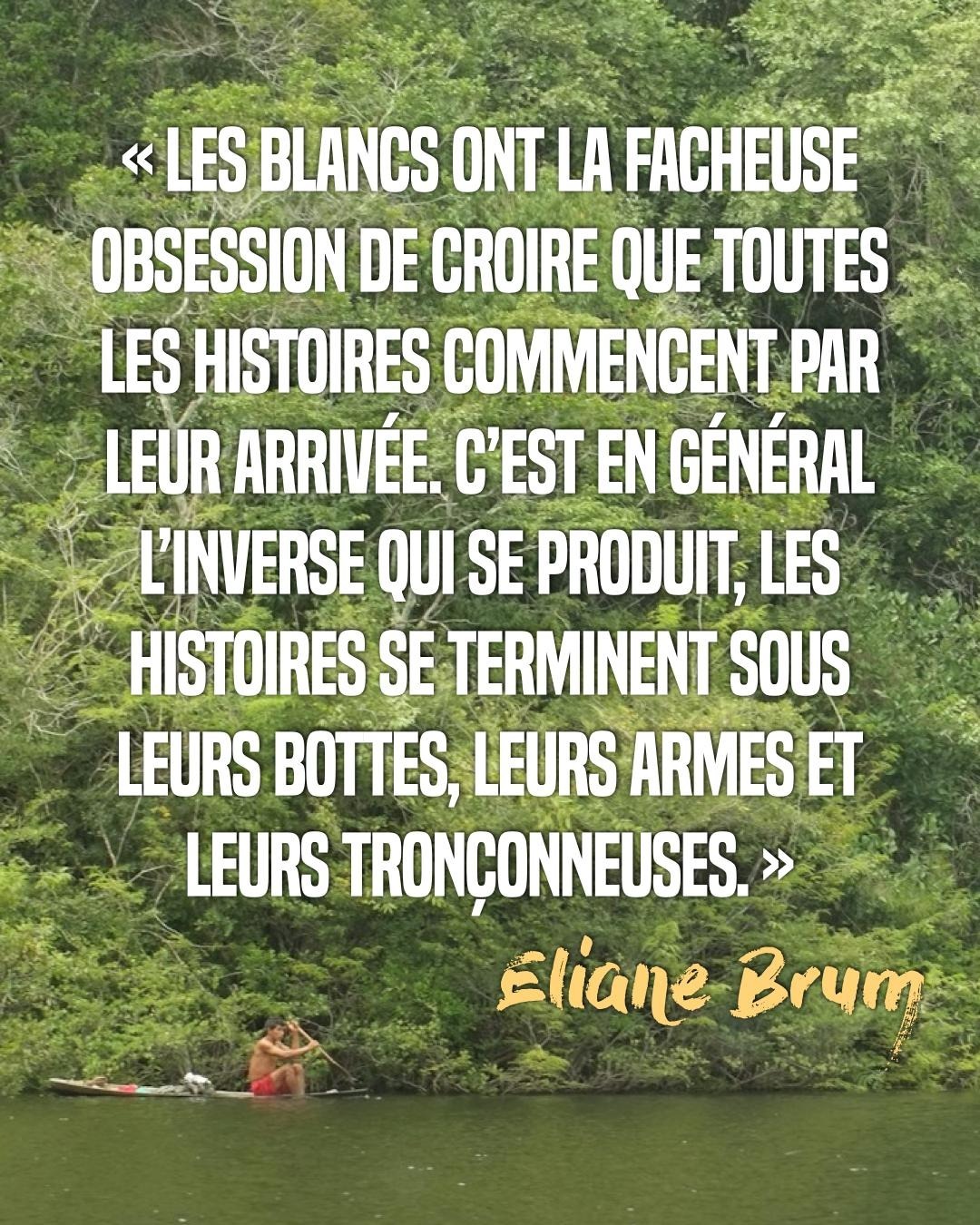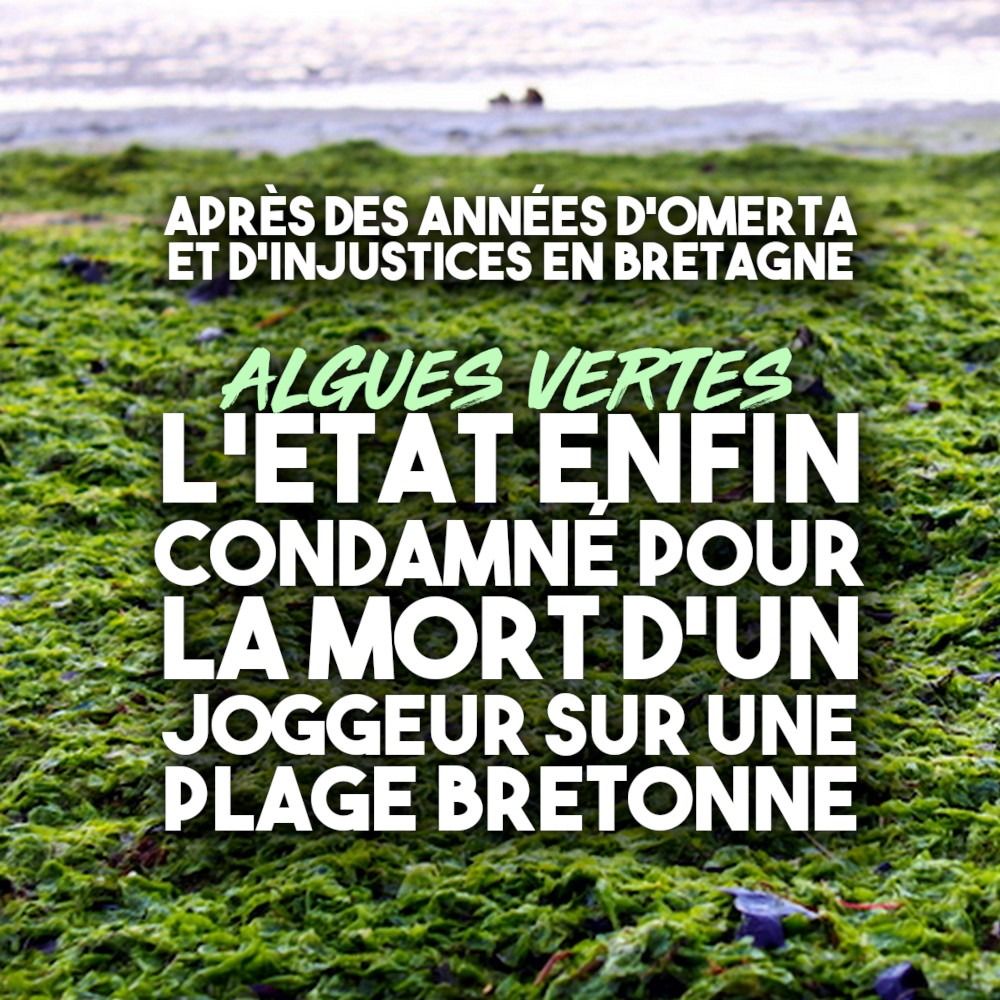L’avocat Raphaël Kempf ose mettre un mot sur une amère réalité qui s’exprime quotidiennement et qui permet, même encourage, la continuité des violences policières. C’est donc un ensemble de mécanismes d’un État policier, dont la justice et la police se trouvent complices, que l’auteur dénonce brillamment dans son ouvrage «Violences judiciaires : La justice et la répression de l’action politique», paru aux éditions la Découverte en septembre 2022.

Tout au long de la procédure pénale, de l’interpellation au placement en garde-à-vue, du déferrement en comparution immédiate au placement en détention provisoire, du contrôle judiciaire à l’assignation à résidence, l’institution judiciaire tente de faire taire toute contestation politique, en abusant des outils de répression de masse qui lui sont confiés, sans limite ni contrôle indépendant.
Raphaël Kempf focalise son analyse sur la répression de l’action militante, dont il est le témoin privilégié en tant qu’avocat de la défense d’activistes et de manifestant-es. L’analyse de cette répression tend ainsi à envisager le pouvoir politique considérable de l’Institution judiciaire, par le biais notamment d’un double processus de «criminalisation de l’action politique et de dépolitisation des infractions commises pour des raisons politiques» dont la finalité se trouve être d’instaurer la peur et de détruire toute contestation.
C’est donc le récit de procureurs soumis aux orientations de politiques pénales du gouvernement qui abusent de leurs pouvoirs pour surveiller et punir en amont de toute condamnation pénale, et donc en violation explicite du principe de présomption d’innocence.
Ces mêmes procureurs qui, sans scrupules, réduisent le traumatisme des victimes de violences policières à un bref classement sans suite (s’ils ne sont pas, avant cela, accusés eux mêmes). Des procureurs qui, si ils ne sont pas l’objet central de cet ouvrage, restent présents tout au long de la démonstration de Raphaël Kempf. Ils sont en effet «le rouage essentiel, sinon capital, d’une justice qui s’attaque à l’action politique et militante» et qui n’ont «de compte à rendre à aucun contre-pouvoir démocratique», de la même manière que la police n’est également «soumise à aucun contrôle effectif de la part de la justice». «J’ai fait le choix de désigner des magistrat-es par leur nom et leur prénom» explique l’avocat, démarche rare dans un univers où l’opacité est la règle.
C’est le récit de la violence d’une justice expéditive, d’enquêtes bâclées et menées à charge, de droits de la défense bafoués et de principes du procès équitable ignorés quotidiennement dans les commissariats, les geôles du tribunal, en détention provisoire, et dans les chambres de comparution immédiate.
Et parallèlement, c’est le récit de meurtres policiers impunis, de choix opportuns des poursuites, de qualifications pénales différenciées, de procédures alternatives et privilégiées pour celles et ceux que le parquet ne considèrent pas comme «ennemis d’État»… en bref, une justice à deux vitesses.
Comme une violence supplémentaire qui s’ajoute aux discriminations et aux inégalités que subissent déjà bien souvent celles et ceux dont le pouvoir étatique voudrait réduire au silence : «les étrangers, les jeunes hommes de quartiers populaires, les personnes les plus pauvres ou précaires, celles qui sont contraintes de vivre dans la marginalité, les travailleuses du sexe, ou évidemment les sans-papiers». Raphaël Kempf donne ainsi une voix à toutes celles et ceux qui subissent ces violences injustement et dans l’indifférence générale. Des violences qui marquent les corps et les esprits, atteignent la dignité et réduisent à néant tout espoir en la notion de Justice.
Peut-on alors encore considérer honnêtement que la violence émanant de celles et ceux qu’on entend être «justes», soit désignée comme légitime ? Elle ne donne que le sentiment d’une violence décuplée, celle à laquelle on ne s’attend pas, celle qui procure une violence sourde et laissée perpétuellement impunie, mais à laquelle il faut aujourd’hui nécessairement se préparer… et face à laquelle il faut lutter !
L’auteur appelle ainsi à «l’abrogation des lois antiterroristes, la suppression des Cours d’Assises spéciales sans jurés, la fin des comparutions immédiates , l’abrogation du délit d’outrage, et la garantie que tous les délits de parole soient poursuivis selon les règles de la loi de 1881 sur la liberté de la presse». Il revendique également la séparation radicale des magistrats du parquet et ceux du siège, la limitation et le contrôle de leur pouvoir mais également la suppression des contrôles d’identités, «sources de discriminations, d’arbitraires et d’arrestations préventives en matière politique».
Mettant en perspective les apports du droit pénal et de la sociologie, mais usant également d’une fine analyse politique, Raphaël Kempf dévoile la face honteuse et discrète de l’Institution judiciaire, que seul-es celles et ceux qui en subissent la violence connaissent, et met en exergue la dimension éminemment politique de la justice et de ses acteurs, «outils au service du maintien de l’ordre».
Une violence judiciaire qui se doit donc enfin d’être nommée… pour être combattue !
Violences judiciaires, La justice et la répression de l’action politique, Raphaël Kempf, Éditions La Découverte, 2022
AIDEZ CONTRE ATTAQUE
Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.