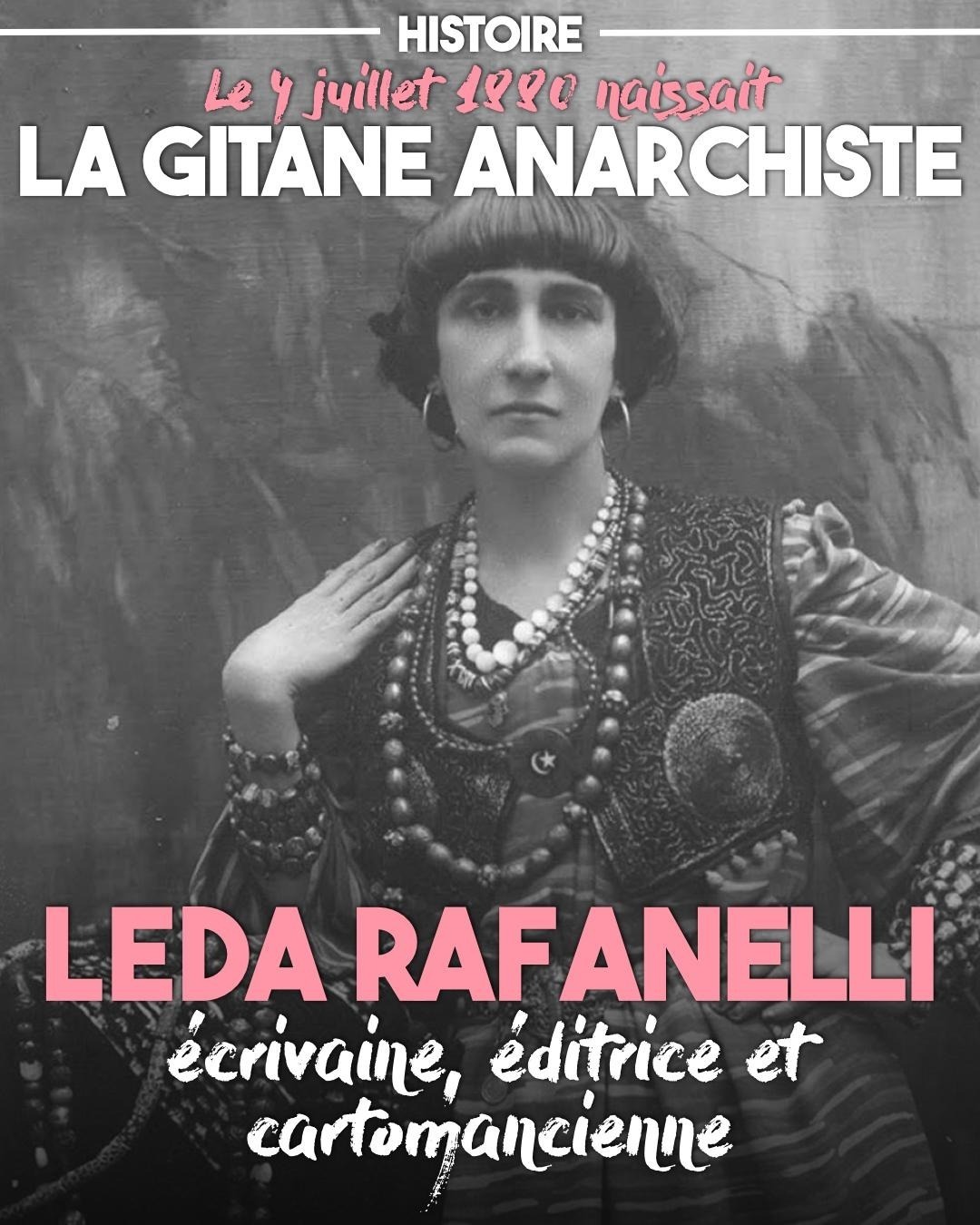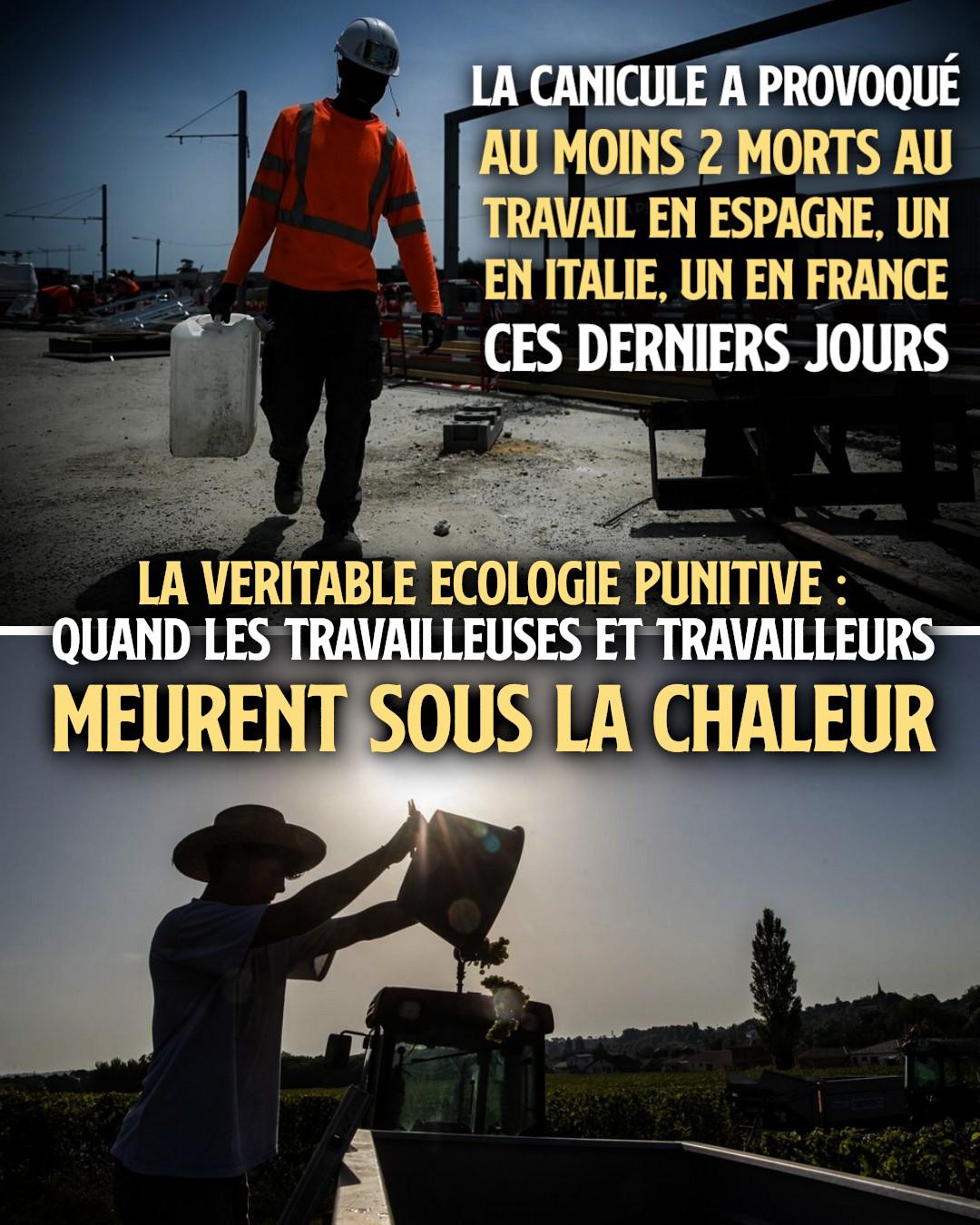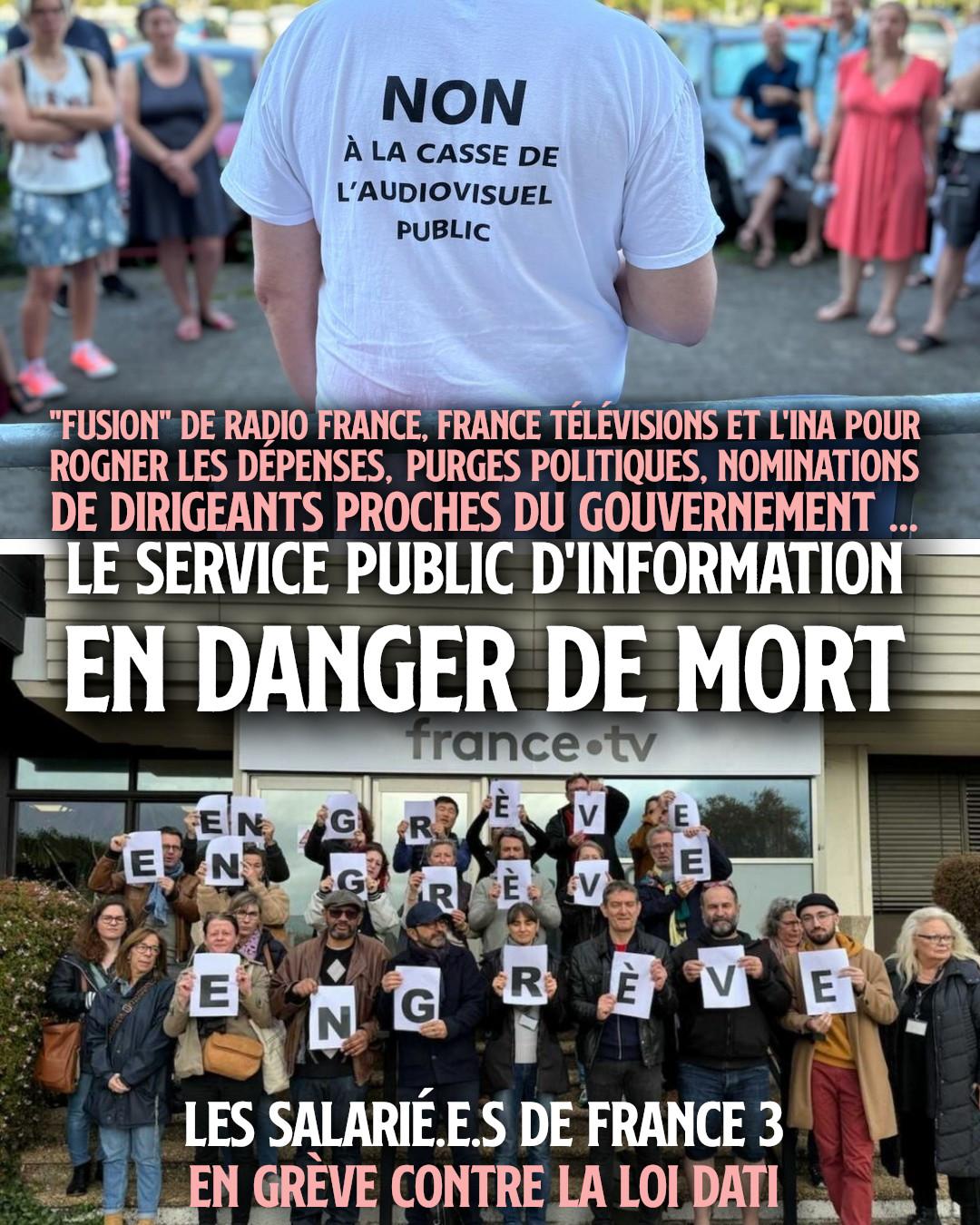En revenant sur le contexte, les textes législatifs et quelques notions de droit, nous développons ici un dossier visant à donner des explications plus précises sur les mesures gouvernementales actuelles. Un dossier publié le 13 avril 2020 qui garde toute sa pertinence.

CONTEXTE
C’est en novembre 2019 qu’un virus inconnu est remarqué en Chine, à Wuhan, dans la province du Hubei. Au cours du mois de décembre, les autorités sanitaires nationales puis l’OMS sont alertées sur la potentielle épidémie qui pourrait advenir. Et en effet, le virus se répand dans la province et autour, mais aussi à l’étranger. À partir du mois de janvier, des cas de covid-19 se manifestent partout autour du globe.
Comment une épidémie peut-elle devenir si vite une pandémie ? Les réponses sont multiples et un seul facteur ne saurait être pris en compte. On ne peut que souligner, néanmoins, que le monde d’aujourd’hui est très mobile. La circulation des personnes à travers les frontières est intense : tourisme, affaires, diplomatie, amitiés politiques, représentent une quantité astronomique de déplacements à travers le monde. Il n’est donc en définitive pas du tout étonnant que le covid-19 se soit répandu à une telle vitesse.
Les réactions des gouvernements n’ont pas été unanimes. Si la Chine a prononcé le confinement au mois de janvier dans les zones touchées, le Royaume-Uni a d’abord compté sur l’immunité collective refusant catégoriquement toute mesure de confinement avant de se raviser.
Bolsonaro, dirigeant fasciste du Brésil, a également complètement nié la dangerosité du virus.
Donald Trump oscille constamment entre une position «Je m’en foutiste» et une injonction à la sécurité sanitaire… tout en s’estimant lui-même au-dessus de telles recommandations. Certains États des USA mettent en place des mesures de confinement.
D’autres chefs d’État estiment que le non-respect des mesures de confinement doit être très sévèrement sanctionné…
Aujourd’hui, 13 avril, pas loin de la moitié de la planète est confinée, et pas un seul pays n’est épargné. Les données concernant le nombre de cas, le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes décédées, sont aisément trouvables sur la toile. Quoique, il faut relever que la plupart des médias préfèrent donner des nouvelles du monde occidental en priorité.
Quoiqu’il en soit, l’ensemble du globe est touché, et, s’il est vrai que les riches risquent eux aussi d’attraper ce virus et même d’en mourir, il n’en demeure pas moins que ce sont les personnes les plus précaires qui sont le plus exposées, qui subissent le plus grand danger, et qui sont les plus réprimées. Soit parce qu’elles n’ont pas les moyens de se faire soigner, soit parce que le système de santé d’un grand nombre d’états est très inégalitaire voire quasi inexistant, soit parce que, à l’échelle locale, il y a peu de structures de santé de proximité. Soit les 3… Et cette inégalité n’est pas prête d’être corrigée par les mesures prises par les pays pour endiguer la pandémie.
En France, ces mesures ont été hésitantes. Alors que, dans un premier temps, le gouvernement avait annoncé que fermer les écoles était hors de question, il revient sur sa position pour annoncer, le jeudi 12 mars, que tous les établissements scolaires seront fermés à partir du lundi 16 mars. La samedi 14 mars, il déclare la fermeture, à partir de minuit, des établissements recevant du public (bars, restaurants, salles de concert etc)… mais maintient le premier tour des élections municipales. Enfin, le lundi 16 mars au soir, il décrète le confinement général à partir du mardi 17 mars à midi.
Des milliers d’entreprises de toutes tailles voient leurs activités baisser, voire réduites à zéro. Certaines ont recours au télétravail. Il en va de même pour les services publics et les
administrations, pour les écoles privées comme publiques. Il n’y a guère plus que l’hôpital qui fonctionne à plein régime. La situation est surréaliste dans ces lieux de soins : alors qu’il se faisait matraquer par la police quand il manifestait contre la casse de l’hôpital public, le personnel soignant se voit aujourd’hui à une place tant redoutée : il doit soigner les victimes d’une pandémie à laquelle l’hôpital public n’a pas les moyens de faire face depuis bien longtemps, en raison de coupes budgétaires drastiques, de suppressions de personnels continues et de réduction du nombre de lits permanentes depuis plus de 20 ans ! Le tout mis en scène dans une héroïsation sournoise.
Parallèlement, le pouvoir s’inquiète de l’état de l’économie, tandis que des millions de salariés et de bénéficiaires des minimas sociaux et du chômage se demandent s’ils vont
pouvoir se maintenir à flots.
Face à cette situation inédite, et pour le moins troublante, l’État a dû adapter l’ensemble des règles qui régissent les institutions ainsi que la vie quotidienne des habitants. Entre la loi du 23 mars 2020 qui instaure l’état d’urgence sanitaire, les ordonnances qui ont suivi, les décrets qui les ont complétés, il est difficile de s’y retrouver. Sans compter une multitude d’outils pratiques tels que les drones ou hélicoptères infra rouge que l’État utilise avec un enthousiasme non dissimulée pour faire respecter le confinement…ou faire régner l’ordre et la discipline.
Les paragraphes qui vont suivre ont pour objectif de clarifier les mesures adoptées par le gouvernement, afin de se faire une idée générale de ce qui change dans l’organisation globale de
nos vies.
Ce dossier n’a pas vocation à être exhaustif, mais seulement à rendre accessible et compréhensible le cadre juridique qui nous régit. Tous les jours, notre média rédige des articles sur les nouvelles ailleurs qu’en France, sur les luttes, sur la situation, sur les sombres actualités mais aussi sur les perspectives de lutte et d’amélioration de notre société.
LA LOI DU 23 MARS 2020 : INVENTION ET INSTAURATION DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
« L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire […] en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population »
L’énoncé de ce type de dispositif peut paraître, dans un certain sens, rassurant : l’État se préoccupe de la santé des citoyens, et prévoit que parfois, des situations sanitaires obligent à modifier en profondeur l’organisation de la vie quotidienne pour protéger la société civile. Par exemple, lorsqu’une usine de produits chimiques explose, un tel dispositif pourrait permettre de protéger les salariés mais aussi la population impactée par cet incident. On pourrait notamment imaginer (ce qui est rendu possible par la loi sur l’état d’urgence sanitaire) que tous les salariés reçoivent une compensation de salaire, via la procédure de chômage technique, au moins égale aux salaires perdus ; on pourrait aussi imaginer que les salariés ainsi que les habitants alentours reçoivent une indemnité conséquente par l’Office d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.
Certaines situations catastrophiques exigent des décisions rapides, exceptionnelles, éventuellement dérogatoires au droit commun, ce qui implique un régime juridique spécial qui doit envisager ce type de situation. Quoique, la question de savoir si, dès le départ, le législateur ne pourrait pas prévoir des scénarios catastrophes au lieu de légiférer dans la précipitation, se pose légitimement. Par ailleurs, la question de l’organisation de nos vies, notamment du travail, et notamment de sa pertinence au vu des alarmes écologiques aujourd’hui, se pose encore plus légitimement. Ceci d’autant plus que la lecture de la loi du 23 mars 2020 qui prévoit le dispositif de l’état d’urgence sanitaire et qui instaure, pour 2 mois, l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire français pour faire face à l’épidémie de covid-19, révèle une volonté non de remettre en question le monde ravageur d’aujourd’hui, mais bien de le maintenir au mépris du bon sens, de la démocratie, des droits des travailleurs et travailleuses et des libertés publiques individuelles comme collectives.
Une première série de mesures peut ainsi être prise par le Premier Ministre :
• Restrictions de déplacement et de circulation que l’on connaît aujourd’hui : il s’agit là d’une mesure générale, qui touche tout le monde (sauf les personnels soignants, les policiers etc)
• Mise en isolement des personnes affectées : il s’agit là de mesures individuelles
• Fermeture des établissements recevant du public : c’est ce qui a été décidé à partir du samedi 14 mars à minuit en France (fermeture des bars et restaurants, salles de spectacles etc)
• Limitation voire interdiction des réunions et rassemblements : selon les départements, des restrictions en termes de nombre de personnes aux rassemblements avaient été prononcées. En l’occurrence, s’il n’y a pas d’interdiction formelle de rassemblement, dans les faits ils sont impossibles légalement puisqu’il faut une bonne excuse pour sortir de chez soi et que l’excuse « j’ai manif » n’est pas dans les motifs de sortie légaux. Il en va de même pour les réunions.
• Réquisition de biens, de services ou de personnes
• Contrôles des prix de certains produits : En période de crise, certains chercheront toujours à tirer le plus grand profit de leur vie ! En l’occurrence, l’État a imposé des prix maximums pour la vente de gel hydroalcoolique par exemple.
• Faciliter l’accès aux médicaments nécessaires : pour éviter que des personnes meurent en raison d’un accès impossible à des médicaments qui peuvent sauver, ce n’est en effet pas idiot de permettre qu’ils soient remboursés par exemple.
• Limiter la liberté d’entreprendre
Toutes ces mesures ne peuvent théoriquement perdurer au-delà de la période d’état d’urgence sanitaire. Avant de passer aux mesures qui peuvent perdurer…
Autant que possible, il est nécessaire de faire un très court aparté : l’état d’urgence sanitaire est prononcé par décret en Conseil des ministres. Il ne peut durer plus d’un mois, SAUF si la loi le déclare pour plus longtemps. C’est le cas de cette loi du 23 mars 2020 qui l’impose pour 2 mois.
Mais il peut être prolongé, et cette fois-ci seule la loi peut le prolonger. À noter que le Conseil des ministres peut prendre un décret pour y mettre un terme avant la fin si cela s’avère nécessaire.
Les mesures de confinement prises aujourd’hui devraient donc disparaître avec la fin de l’état d’urgence sanitaire. Cela semble tout à fait logique : à partir du moment où le danger du virus, de cette crise, est passé, il n’y a pas de raison de forcer les gens à rester chez eux. Dès lors que l’épidémie sera endiguée, nous pourrons à nouveau boire des verres et nous côtoyer à moins d’un mètre, puisque, le virus ne circulant plus ou bien un remède sérieux ayant été trouvé, il n’y a plus de risque d’afflux massif à l’hôpital ni de mise en danger de mort de ses concitoyens. Bien.
Mais une autre série de mesures est rendue possible par cette loi du 23 mars 2020 (appelons-la la loi EUS, par simplicité), et ces mesures, qui concernent plutôt les domaines du travail, de l’économie, du fonctionnement des institutions, de la santé publique, ne sont pas, elles, limitées dans le temps imparti de l’état d’urgence sanitaire. La justification donnée de façon plus ou moins directe, c’est que plusieurs semaines de confinement et de fermeture d’entreprises ont un impact considérablement négatif sur l’économie du pays. En effet, de très nombreuses entreprises ne produisent plus ou presque plus, les frontières se ferment, donc il n’y a plus de ventes (en France ou à l’étranger), donc il n’y a plus de rentrées d’argent. Par ailleurs, les marchés financiers s’affolent, les bourses s’effondrent, les riches ont peur pour leurs vies. C’est pourquoi les mesures prises pour relancer l’économie doivent pouvoir être applicables dans la durée nécessaire à cette relance.
À première vue, cela semble logique : les effets de la pandémie vont très certainement durer plusieurs mois, alors il faut pouvoir s’adapter sur plusieurs mois. À ceci près que la lecture de la loi EUS, confirmée par les ordonnances adoptées par le gouvernement, met en lumière une stratégie étouffante du pouvoir : faire payer cette crise sanitaire à celles et ceux qui paient déjà les incuries du capitalisme et des États-Nations.
Cette deuxième série de mesures visent à autoriser le gouvernement à prendre des ordonnances, dans de très nombreux domaines.
Ensuite, le gouvernement est autorisé à gouverner par ordonnances
Un aparté s’impose : que sont les ordonnances du gouvernement ? Quelle est la différence entre une loi, un décret et une ordonnance ? Quelques explications :
En droit, il existe un principe essentiel qui est celui de la hiérarchie des normes.
En principe, la Constitution est supérieure à la loi, la loi est supérieure au décret (le décret est soumis à la loi), qui lui-même est supérieur aux arrêtés notamment préfectoraux. Le préfet peut donc adopter un arrêté, mais cet arrêté doit respecter ce que dit le décret sur le même sujet. Ce décret, adopté par le gouvernement, doit respecter ce que dit la loi sur le sujet. Et la loi doit respecter la Constitution. Chaque acte juridique (Constitution, loi, décret, arrêté etc) est pris par une institution habilitée pour. Ainsi, la loi ne peut être adoptée que par le Parlement (Assemblée Nationale et Sénat). Les décrets, eux, ne peuvent être adoptés que par le Gouvernement (le Conseil des ministres, réunion de tous les ministres). Les préfets et les maires peuvent prendre des arrêtés : ce sont les arrêtés préfectoraux et les arrêtés municipaux.
Nous allons là nous concentrer sur la loi et le décret, par souci de simplification. Il est tout à fait logique que la loi soit supérieure au décret. Le Parlement est élu. L’Assemblée Nationale est élue au suffrage universel direct : tous les électeurs peuvent voter pour les députés dans leur circonscription. Le Sénat est élu au suffrage indirect : ce sont les élus locaux qui les élisent. Le Gouvernement, lui, est nommé, par le Président de la République lui-même élu.
La loi est votée selon une procédure publique. Il y a même une chaîne de télévision parlementaire qui diffuse tout ce qui se passe au sein de l’hémicycle (ce qui peut être parfois très drôle mais d’ordinaire, c’est mortellement ennuyeux). Sur les sites des assemblées parlementaires (Assemblée Nationale et Sénat), les débats et décisions sont également retranscrits, les amendements proposés sont communiqués, etc. La procédure de vote d’une loi est donc assez visible et rendue publique. Par ailleurs, sauf si le Gouvernement décide d’utiliser une des procédures accélérées (et il y en a plusieurs), elle s’étale suffisamment dans le temps pour que les habitant-e-s aient le temps de suivre cette aventure et de comprendre les enjeux.
En réalité, il faut bien préciser qu’un texte de loi est bien souvent fastidieux et laborieux à lire et à comprendre, et que nous sommes bien heureux que des gens qui s’y intéressent aient à cœur de rendre ces diarrhées juridiques compréhensibles pour toutes et tous. D’ailleurs, le contenu d’un certain nombre de lois en débat, notamment les lois attendues comme la réforme des retraites, est fréquemment révélé par la presse. Tout ceci permet de savoir ce que nous prépare le législateur. Le décret, lui, est adopté de façon beaucoup plus opaque et rapide : le Gouvernement rédige un décret et le vote. Point. La procédure n’est pas publique, ni visible. Il arrive que la presse dévoile par avance le texte d’un décret en cours d’adoption. Mais c’est plus rare. Il importe de préciser que deux types de décrets peuvent être pris par le Gouvernement :
- Les décrets d’application des lois. Dans chaque loi, certains articles disent explicitement «les modalités d’exécution de cette disposition seront précisées par décret en Conseil des ministres». Dans ce cas, le Parlement commande au Gouvernement d’adopter un décret pour que la loi s’applique
- Mais il existe aussi des domaines dans lesquels le Gouvernement peut prendre des décrets de sa propre initiative. L’article 34 de la Constitution fixe les domaines réservés à la loi ; le Gouvernement peut adopter tout décret qu’il juge nécessaire du moment qu’il n’empiète pas sur le domaine de la loi
Mais revenons au sujet initial : les ordonnances.
Alors qu’est-ce que c’est ?

Les ordonnances sont prévues à l’article 38 de la Constitution. Elles permettent au Gouvernement d’adopter des mesures qui relèvent du domaine de la loi. Il s’agit donc d’une dérogation au principe pourtant simple : le Parlement vote des lois, le Gouvernement adopte des décrets qui ne peuvent contrevenir à la loi. La procédure des ordonnances est la suivante :
- Le Parlement, de sa propre initiative, ou bien sur demande du Gouvernement, vote une loi d’habilitation, qui autorise le Gouvernement à utiliser la procédure des ordonnances dans des domaines bien définis
- Le Gouvernement rédige une ordonnance (ou plusieurs bien souvent)
- Le Conseil d’État donne son avis
- Le conseil des ministres adopte l’ordonnance
- L’ordonnance entre en vigueur dès sa publication (elle n’a, jusqu’à la loi de ratification, qu’une valeur réglementaire, donc un simple décret peut la modifier)
- Le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification devant le Parlement
- Le Parlement vote la loi de ratification : l’ordonnance est donc ratifiée et acquiert ainsi valeur de loi
Et voilà, le Gouvernement peut finalement, avec l’aval du Parlement, intervenir dans le domaine de la loi.
La loi EUS du 23 mars 2020 donne ainsi un pouvoir colossal au Gouvernement en lui permettant d’intervenir par la voie des ordonnances dans un nombre très élevé de domaines.
Dans le domaine du droit du travail, tout d’abord. Le Gouvernement est notamment habilité à permettre aux employeurs de modifier le temps de travail, le temps de repos et les cadences des salariés. Il peut également leur permettre de forcer les salariés à prendre maximum 6 jours de congés payés pendant le temps du confinement. Le salarié n’a plus guère de maîtrise sur l’organisation de sa vie, de même en matière de RTT, l’employeur peut dorénavant imposer les jours de récupération et ceux inscrits au compte épargne-temps sans concertation avec le salarié. De manière générale, les secteurs «particulièrement nécessaires» (c’est-à-dire ceux dont la liste n’est pas donnée) peuvent déroger au droit en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire et dominical (soit le travail du dimanche dans des secteurs où il n’existait pas encore).
De façon plus « positive », le Gouvernement peut également prendre des ordonnances pour faciliter le recours à l’activité partielle des entreprises. Il s’agit d’un dispositif qui permet, sous certaines conditions, que l’État verse une aide financière à une entreprise qui est contrainte, par l’effet de la crise sanitaire, de baisser son activité. Cette aide financière vise à payer au moins une grosse partie du salaire des employés qui voient leur nombre d’heures de travail diminuer dans le contexte. La possibilité est laissée au gouvernement de porter atteinte au droit de grève et au droit de retrait en ordonnant la réquisition de biens et de personnels qu’il estime nécessaires tout en prévoyant des sanctions extrêmement sévères contre celles et ceux qui refuseraient de s’y soumettre.
De façon plus générale, le Gouvernement est autorisé à adopter des ordonnances pour permettre à l’État de venir en aide aux entreprises qui connaissent des difficultés financières du fait de leur chute d’activité due à la crise sanitaire.
Pour les TPE (très petites entreprises), il sera possible de reporter le paiement du loyer et des charges. Dans le domaine santé-social, il y a de « bonnes » surprises, même s’il faut attendre les résultats avant de se rassurer… (Voir la partir 4 de ce dossier)
La loi EUS permet au Gouvernement de modifier les règles autour des allocations des minimas sociaux comme le RSA, l’AAH, des prestations familiales, du minimum vieillesse, mais aussi de la prime d’activité… afin «d’assurer la continuité des droits» : il est donc possible que ces maigres droits sociaux soient étendus à davantage de bénéficiaires. En tout cas, l’idée semble être qu’il ne faut pas que des citoyens se retrouvent avec zéro revenus ?
Par ailleurs, dans le même ordre d’idée, des ordonnances peuvent être adoptées pour permettre que les personnes en difficulté : majeurs ou mineurs sous protection, personnes handicapées, personnes âgées…ne soient pas abandonnées et que leur accompagnement puisse être assuré. Par exemple, un établissement pour enfants placés doit pouvoir accueillir des personnes âgées si besoin. Cependant, cela implique de réorganiser les établissements de façon à ne pas surcharger de travail le personnel qui y bosse. Or, rien n’est dit à ce sujet, ce qui laisse craindre une prise en charge minimale et finalement non satisfaisante… En outre, il sera possible d’étendre les règles de remboursement des frais de santé.
Enfin, les titres de séjour divers, les demandes d’asile, les récépissés, devraient être prolongés de plusieurs mois (180 jours maximum). En bref, le législateur a voulu montrer de la bonne volonté en assurant que pour tout ce qui pouvait faire l’inquiétude de la population autour de la santé, des frais médicaux, du salaire etc, notamment pour les personnes les plus dépendantes, soit pris en charge avec sérieux par le Gouvernement, qui est censé faire en sorte que tout le monde puisse se soigner et avoir un salaire.
Ceci étant dit, attendons de voir les résultats avant de se rassurer. Sur la question du maintien des salaires pour les parents contraints de se mettre en arrêt maladie pour garder leurs enfants, la ministre du travail Muriel Penicaud, dans un grand effet d’annonce le 18 mars, avait assuré : « On va obliger tous les employeurs à payer la partie complémentaire jusqu’à 90% ».
Or, dans les faits, si la sécurité sociale a bien versé l’indemnité à laquelle ces salarié-e-s ont droit, les employeurs, eux, n’ont pas versé de complément à celles et ceux dont l’ancienneté est inférieure à un an, comme le droit les y autorise. Le gouvernement, malgré ses promesses, n’a pas jugé utile de légiférer en urgence sur ce point ! Il y a bien l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020, mais elle n’a pas fait l’objet d’un décret… Celui-ci sera-t-il rétroactif lorsqu’il sera enfin publié ? Il est impossible, en réalité, de faire le tour des possibilités pour le Gouvernement de gouverner par ordonnances. Tous les aspects de la vie du pays sont concernés. On peut encore en donner quelques exemples : fonctionnement des collectivités locales (permettre des réunions dématérialisées), modification des règles budgétaires que ce soit dans le public ou le privé (on ne peut pas reprocher, dans la période, des comptes négatifs…), possibilité de report du versement de certaines primes comme l’intéressement ou la participation aux bénéfices…
Dans le domaine judiciaire : là, le bat blesse et laisse craindre un nouveau renforcement permanent des pouvoirs policiers et répressifs en général. En effet, le Gouvernement est autorisé à prendre des ordonnances pour adapter les règles :
• De publicité des audiences : les audiences qui en principe sont publiques pourront donc se tenir à huis clos
• D’organisation du contradictoire : une procédure contradictoire signifie que chaque partie au procès doit avoir la possibilité de discuter les faits, les motifs des décisions, les moyens juridiques soulevés par les autres, et de pouvoir les exprimer.
• De la garde-à-vue : notamment pour permettre l’intervention à distance de l’avocat ! Fini les 30 minutes où on peut sortir de la cellule pour causer avec l’avocat.
• De la détention provisoire : cela veut dire possibilité de l’allonger !
• D’assignation à résidence sous bracelet électronique
• Des délais au cours de l’instruction, etc.
Ces différents points sont détaillés dans la partie 5 de ce dossier.
Il s’agit là d’une remise en cause grave et lourde de conséquences des principes les plus fondamentaux de la justice, à savoir le fait d’avoir une procédure orale, publique et contradictoire. Les droits des prévenus s’en trouvent considérablement amoindris.
Si l’on ajoute à ceci des pouvoirs de police renforcés par la possibilité de sanctionner des personnes pour non-respect des règles de confinement, on ne peut que sombrer dans l’inquiétude quant à l’avenir judiciaire des personnes et à l’avenir répressif du pays.
En effet, le texte est clair : première violation = 135€, récidive dans les 15 jours = 1500€, 3e violation dans les 30 jours = 6 mois + 3750€ + TIG. Il permet même de placer les potentiels contrevenants en garde-à-vue !
La sévérité des peines interpelle et vise à considérer que les premiers responsables de la propagation du virus seraient les gens, ces irresponsables qui sortent. Indépendamment de ce qu’on peut penser du confinement et donc du respect ou du non-respect des règles, il faut qu’une chose soit très claire : les premiers et derniers responsables de ce type de virus sont les Etats et leurs alliés, les grosses entreprises, qui déforestent à tout-va partout autour du globe, qui détruisent les habitats des animaux sauvages, et permettent ainsi à des virus de passer desdits animaux à l’Homme en causant des dommages irréversibles pour ce dernier.
Par ailleurs, il importe de préciser que ces amendes sont infligées au bon vouloir de l’interprétation des agents de police. Cela signifie que la police poursuit ses pratiques antérieures de contrôle discriminatoire. En d’autres termes, les contrôles confinement se font au faciès, dans des zones que la police affectionne particulièrement de réprimer à savoir les quartiers populaires, et avec un surcroît de violence, dont la police macronienne est coutumière. Le fonctionnement de la police ne change pas, elle répond à l’objectif qu’on lui a donné, à savoir le contrôle et la gestion des populations, avec des moyens supplémentaires grâce à la loi EUS.
Si énumérer l’ensemble des domaines dans lesquels le Parlement habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances semble vain, il importe de retenir néanmoins que le Gouvernement a toutes les cartes en main pour modifier en profondeur l’ensemble de la vie du pays. Si certaines mesures paraissent « rassurantes », elles ne sont, en réalité, que la conséquence on ne peut plus logique de la situation. En outre, ces mesures n’auront qu’un temps…
Il est évident que globalement, les salariés, les détenus, et les personnes qui subissent déjà des discriminations systémiques sont les grands perdants de cette loi EUS.
Le pouvoir a saisi l’occasion de la situation pour avancer d’un pas gigantesque dans sa destruction des mécanismes de solidarité, des droits des salarié-e-s et des libertés publiques. Il renforce, une fois encore, l’arsenal répressif et les outils pour discipliner les populations. Il renforce également les pouvoirs des patrons pour leur permettre de sauver leurs biens faramineux.
Cette loi vise à préserver l’économie, quitte à y sacrifier la santé voire la vie d’une partie de la population.
D’ores et déjà, des signes très inquiétants de renforcement autoritaire du pouvoir apparaissent : des couvres-feu, l’utilisation des drones pour surveiller le respect du confinement, des caméras intelligentes qui repèrent les attroupements, qui surveillent le respect des distances de sécurité entre les personnes, qui détectent les intrusions, le traçage des téléphones mobiles…
Tout ceci ne s’arrêtera pas avec la fin de l’état d’urgence sanitaire. L’opportunisme et la volonté de contrôle et de discipline du pouvoir ne semble pas avoir de limite.
ORDONNANCE DU 27 MARS 2020 : ACTIVITÉ PARTIELLE
ET AUTRES MESURES POUR LES DROITS SOCIAUX
En cette période de crise sanitaire, des millions de salarié-e-s ne travaillent pas le nombre d’heures requis pour toucher leur paye complète. La crainte d’une perte de salaire est donc légitimement forte pour beaucoup. Macron a bel et bien annoncé que les salariés concernés seraient indemnisés. En effet, il paraît tout à fait injuste qu’une baisse drastique de l’activité de l’entreprise, pour cause de pandémie donc pour un cas de force majeur très particulier, les salariés voient leur paye réduite à zéro ou quasi. En dehors du cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, il n’est pas normal que les salariés aient à subir cela de toute façon.
Une explication autour du chômage partiel s’impose, que ce soit dans la période actuelle de crise sanitaire mais aussi dans le cadre de la vie courante. S’informer dans la situation actuelle est important, comprendre les mécanismes du droit du travail en général, hors de la lutte contre le covid-19, est également essentiel.
1. LE CHÔMAGE PARTIEL EN PÉRIODE NORMALE
Le chômage partiel, aussi appelé chômage technique ou activité partielle, est un dispositif d’aide de la part de l’État pour les entreprises qui cessent tout ou partie de leurs activités, à condition que les raisons soient les suivantes :
• La conjoncture économique
• Des difficultés d’approvisionnement
• Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel
• La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise
• Toute autre circonstance de caractère exceptionnel
L’aide versée par l’État est faite pour que l’employeur puisse verser aux salarié-e-s contraint-e-s de ne pas effectuer toutes leurs heures de travail prévues, tout ou partie de leur salaire.
En temps habituel, voici la marche à suivre : L’employeur doit demander la mise en activité partielle de son entreprise à la DIRECCTE (Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), mais ceci AVANT la mise en activité partielle de l’entreprise.
Créées en 2010, les DIRECCTE (Il y en a une par région), ont des missions diverses : elles sont censées veiller au respect des dispositions du code du travail (avec les moyens du bord…), mais aussi soutenir le développement économique local, veiller au respect du droit de la concurrence… Globalement, c’est un immense service administratif qui s’occupent de nombreuses questions relatives au commerce, au travail, au tourisme, à la consommation, à la concurrence…c’est vaste.
La Direccte a 15 jours pour répondre à l’employeur ; le silence vaut acceptation. L’employeur doit également consulter les représentants du personnel de l’entreprise. S’il n’y en a pas, il doit informer tous les salariés du projet de mise en activité partielle. Et ce AVANT de déposer la demande auprès de la Direccte. La Direccte peut accorder l’autorisation de mise en activité partielle pour une durée de 6 mois.
Les heures travaillées, elles, sont bien évidemment intégralement payées (par l’employeur et ne font pas l’objet d’une aide de l’État). Les heures chômées, c’est-à-dire celles qui auraient dues être travaillées mais qui, en raison des circonstances exceptionnelles prévues par le code de travail, ne le sont pas, en revanche, sont indemnisées à hauteur de 70% du salaire brut (environ 84% du salaire net).
L’aide de l’État consiste en le fait de payer les heures chômées. C’est bien l’employeur lui-même qui verse la paie, à la date habituelle, mais en soi c’est l’État qui finance le paiement des heures chômées. Concrètement, l’employeur verse le salaire et demande ensuite le remboursement auprès de l’ASP, Agence des Services de Paiement, l’organisme étatique chargé du paiement en l’occurrence. A noter que l’employeur peut tout à fait décider de garantir le versement de l’intégralité du salaire, ce qui implique qu’il prenne lui-même en charge les 30 % restant. Bien entendu, en général, il prend cette décision parce que les salariés l’ont demandé de façon plus ou moins ferme.
2. LE CHÔMAGE PARTIEL EN CETTE PÉRIODE D’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
La situation actuelle est inédite : des milliers et des milliers d’entreprises sont contraintes de baisser leurs activités, voire de fermer temporairement. Si toutes doivent respecter le protocole décrit plus haut, elles risquent fort de ne pas obtenir de réponse et d’être remboursées tardivement. Et, par ricochet, de ne pas verser aux employés les salaires auxquels ils ont droit.
C’est pourquoi, afin de simplifier la procédure, le gouvernement a adopté une ordonnance.
Voici donc le nouveau régime de l’activité partielle : Tout d’abord, il est précisé que pour les salariés dont le temps de travail est soumis au régime de l’équivalence, les heures d’équivalence rémunérées sont comprises dans le calcul de l’indemnité d’activité partielle.
• Le régime d’équivalence : il s’agit d’un régime de décompte et de rémunération particuliers des heures de travail, dû au fait que le salarié a des périodes d’inaction sur son lieu de travail, alors même que sa présence sur le lieu de travail est nécessaire. L’exemple le plus simple est celui des chauffeurs routiers : devant parfois effectuer de longs déplacements, ils ne conduisent pas tout du long, ils sont contraints de faire des pauses. Mais pendant ces pauses, ils sont tout de même sur leur lieu de travail : il s’agit d’une période d’inaction. Cette période d’inaction, aussi appelée temps d’équivalence, est rémunérée selon les règles fixées par la convention collective ou l’accord de branche. Le temps de travail par semaine d’un salarié soumis à ce régime d’équivalence est nécessairement plus élevé que les 35h légales. Mais de toutes façons, les 35h n’existeront peut être bientôt plus …
• Les salariés de droit privé dont l’entreprise est contrôlée en majorité par l’État bénéficient également de l’activité partielle.
• La rémunération : pour les salariés qui touchent le SMIC ou moins, l’indemnité d’activité partielle est de 100% du salaire. Ce qui veut dire que les salariés au SMIC, ou en dessous du SMIC, doivent toucher leur salaire complet.
• Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont également indemnisés, au SMIC.
• Le salarié protégé est d’office placé en activité partielle, sans que son accord soit nécessaire, lorsque TOUS les salariés de l’entreprise ou le secteur ou le service auquel il est affecté sont concernés par l’activité partielle.
• Les employés à domicile et les assistants maternels : Ils peuvent, eux aussi, prétendre au dispositif de l’activité partielle (il faut que la perte de leur rémunération soit due à une cessation d’activité causée par l’épidémie de Covid-19). Le fonctionnement est le même que pour les salariés d’une entreprise, sauf que là, l’employeur qui est un particulier n’a pas besoin d’une autorisation, même implicite, de l’administration. L’employeur doit verser 80 % du salaire net, mais cette rémunération ne peut être inférieure à la rémunération minimale prévue par les conventions collectives qui s’appliquent respectivement aux employés à domicile et aux assistants maternels. Ce n’est pas l’ASP qui verse les indemnités à l’employeur pour le coup, mais ce sont les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales. Le reste de l’ordonnance concerne des cas assez particuliers auxquels le dispositif de chômage partiel est étendu.
Toutes ces dispositions sont applicables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Le décret du 25 mars 2020 ajoute un élément important : le délai au-delà duquel le silence de l’administration vaut acceptation de la mise en activité partielle est de 2 jours (et non plus 15 jours comme c’est le cas en période normale).
Une ordonnance, en date du 25 mars 2020, prévoit la prolongation de droits sociaux :
• Les contrats d’assurance complémentaire santé qui ouvrent droit au crédit d’impôt sont prolongés jusqu’au 31 juillet s’ils sont censés prendre fin avant
• La complémentaire santé est prolongée de 3 mois, pour les personnes dont le contrat arrive à terme entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020
• En principe, la première demande d’aide médicale d’État doit être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie. Mais l’ordonnance permet que cette première demande puisse être déposée aussi auprès d’un CCAS, ou d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, ou des services sanitaires et sociaux du département de résidence, ou d’une association ou autres organismes agrées par l’État. En clair, la première demande d’AME est plus simple.
• L’AME est en outre valable 3 mois de plus si son terme devait arriver entre le 12 mars et le 31 juillet 2020.
• De la même façon, un certain nombre de droits et prestations sont prolongés de 6 mois s’ils devaient arriver à terme entre le 12 mars et le 31 juillet, et pour ceux qui arrivaient à terme avant le 12 mars mais dont la demande de renouvellement n’a pas été faite : allocation adulte handicapé, allocation d’éducation enfant handicapé, carte mobilité inclusion, prestation de compensation du handicap
• Les parcours de « sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle » ainsi que l’aide afférente sont prolongés de 6 mois s’ils arrivaient à terme entre le 12 mars et le 31 juillet 2020
Une autre ordonnance du 25 mars 2020 prévoit de prolonger jusqu’au 31 mai, donc de deux mois (en principe c’est jusqu’au 31 mars) :
• L’interdiction faite aux fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz et d’eau de couper l’accès aux services concernés
• L’interdiction des expulsions locatives
Enfin, une ordonnance du 25 mars 2020 prolonge de 90 jours les documents de séjour qui sont censés expirer entre le 16 mars et le 31 mai 2020. Sont concernés :
• Visas de long séjour
• Titres de séjour
• Autorisations provisoires de séjour
• Récépissés de demandes de titres de séjour
• Attestations de demandes d’asile
NE PAS SE LAISSER BERNER PAR LES « BONNES MESURES »
LE PRINCIPE ET LA RÉALITÉ DU CHÔMAGE PARTIEL
Globalement, une fois n’est pas coutume, on peut être plutôt satisfait de cette ordonnance sur le chômage technique. En effet, elle permet une simplification de la procédure de demande d’activité partielle, elle étend le champ des bénéficiaires, et elle permet que des salariés au SMIC ou moins ne se voient pas amputer d’une partie de leur salaire, bien que la réalité soit un peu différente.
En vérité, c’est logique : les salariés n’y sont strictement pour rien si le capitalisme fait des ravages au point que des virus se transmettent des animaux sauvages à l’être humain.
Par ailleurs, il faut bien prendre conscience que ce type de dispositif n’existerait pas si des luttes sociales très dures n’avaient pas obtenus des victoires vitales, comme la Sécurité Sociale, des congés payés, un salaire minimum, etc. Ce sont des conquêtes sociales, ce ne sont pas des cadeaux de l’État. Et encore moins des patrons.
Par ailleurs, le pouvoir n’est pas altruiste : il sait qu’en accordant plus facilement l’activité partielle et donc, en définitive, un salaire garanti pendant la crise, il s’expose beaucoup moins à une conflagration sociale à la fin du confinement voire pendant. Il assure ses arrières, pour pouvoir dire plus tard « pendant la crise, nous avons fait en sorte de maintenir les salaires, tous les pays ne l’ont pas fait » . Ceci en vue d’alimenter le discours sur le fait qu’on n’est pas si mal lotis en France comparé à d’autres… Ce qui est vrai ; en effet tous les pays n’ont pas de sécurité sociale, tous n’ont pas de salaire minimum comme le SMIC, tous n’ont pas de minimums sociaux comme le RSA… Mais d’une part, c’est justement parce que les pays qui n’ont pas ces dispositifs connaissent des écarts d’inégalités incroyables qu’il importe de conserver ces acquis. Et d’autre part, lorsqu’on revendique des dispositifs de solidarité, des dispositifs de répartition des richesses, ce n’est pas que pour la France : c’est pour tout le monde.
Le pouvoir se sert de ces arguments de comparaison pour nous amener à ne pas trop demander. Or, il nous faut non pas demander, mais exiger, et pas seulement des poussières.
Le principe de verser le salaire complet pour des travailleurs au SMIC se heurte à une triste réalité. De nombreux salariés relèvent en effet que leur paye est moindre que celle qu’ils touchent habituellement en étant payés au SMIC. Ceci peut s’expliquer par plusieurs facteurs.
En premier lieu, il n’est pas rare que l’employeur, en temps normal, ne paye pas toutes les heures effectuées, ne comptabilise pas toutes les heures. Il peut donc tout à fait «oublier» de payer l’ensemble du salaire à ses salariés en chômage partiel. Il peut arguer du fait qu’il ne sait pas s’il va être vite remboursé par l’ASP par exemple.
En second lieu, la situation est particulière pour les salariés à temps partiel… et ils sont environ 5 millions aujourd’hui, très majoritairement des femmes ! En temps normal, une grande partie de ces salariés à temps partiel effectue des heures complémentaires, c’est-à-dire plus que ce qui est prévu par le contrat de travail (c’est particulièrement le cas dans les entreprises de nettoyage et propreté). Ces heures complémentaires sont payées plus que les heures normales : on dit qu’elles sont majorées (d’au moins 10% en principe). Cependant, dans la période actuelle d’état d’urgence sanitaire, les salariés en activité partielle n’effectuent, par définition, pas d’heures complémentaires (On peut estimer que ça doit arriver, mais globalement, beaucoup d’entreprises ont dû drastiquement baisser voire arrêter leur activité. De nombreux salariés ne travaillent ainsi pas du tout ou très très peu). Ce qui implique que, contrairement à la plupart du temps, ils sont payés leur salaire de base qui figure sur le contrat de travail, réduisant la paie par rapport à d’habitude où leur paye comprend les heures complémentaires effectuées. Sur un mois entier, il peut y avoir des variations de plus de 100€ !
Enfin, l’ordonnance qui permet à l’employeur d’imposer des jours de congés, des jours de repos et des RTT a eu pour conséquence de diminuer les revenus à la fin du mois. Ce raisonnement est valable pour les salariés à temps complet qui eux effectuent des heures supplémentaires.
Il faut également souligner que dans plusieurs entreprises, le non renouvellement du contrat des intérimaires en a jeté des milliers dans les bras du chômage. C’est par exemple le cas de Stélia, entreprise du secteur aéronautique. Le temps que les demandes soient traitées, un certain nombre d’entre eux vont avoir bien du mal à payer leur loyer. En tout état de cause, les salariés payés plus que le SMIC (et ce n’est pas un luxe) vont presque tous voir leur paye diminuer pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Or, nombreux sont celles et ceux qui ont contracté un emprunt pour leur logement, qui ont des enfants à charge…et qui ne s’en sortaient déjà pas avant !
SAUVER L’ÉCONOMIE, LE BUT ULTIME
Considérant la situation dans son ensemble, on ne peut que relever que le gouvernement ne cherche pas à changer la marche du monde, à changer la façon d’agir des élites, à modifier en profondeur les façons de faire de la politique. En effet, les ordonnances qui modifient la procédure pénale, ainsi que les règles relatives au temps de travail, de même que les pouvoirs répressifs qui se renforcent, montrent bien que rien ne change, que tout s’aggrave : le but est de sauver l’économie et de renforcer le contrôle des populations.
Il n’est pas de travailler moins et mieux, de garantir des soins adaptés pour toutes et tous, d’abandonner les projets d’aménagement mortels pour l’écosystème, de revenir sur la mondialisation et le libre- échange, de stopper la machine néo-coloniale…
L’objectif des pouvoirs publics est surtout de ne pas changer ce monde néolibéral, source des inégalités les plus cruelles entre individus, entre États, entre groupes de populations.
Ils veulent sauver leur monde, malgré des discours qui semblent faire état d’une prise de conscience que le monde capitaliste a détruit la planète, a provoqué des conditions de vie indignes, a marchandisé la santé.
Il faut se rappeler que la crise économique de 2008 avait conduit à des discours identiques de la part des dirigeants. Nicolas Sarkozy semblait soudainement devenir anticapitaliste. Seulement bien entendu, ces discours n’ont pas été transformés en actes, bien au contraire. L’austérité qui a suivi a été sidérante. La Grèce en a particulièrement fait les frais : à force de coupes budgétaires et d’exigences de rentabilité, ses hôpitaux se sont retrouvés en pénurie de médicaments, les habitants n’avaient même plus les moyens de se soigner et donc mourraient chez eux dans la détresse. Ou se suicidaient sur la place publique. Mais, « il fallait bien redresser l’économie après la crise » !
C’est exactement ce qui risque de se produire dans la période actuelle : passés les premiers temps de la pandémie, lorsqu’il s’agira de retourner au travail pour tout le monde, ce seront aux salariés de bas-étages de payer la crise, de redresser l’économie. Si dès aujourd’hui, il est possible à l’employeur d’augmenter les cadences, de faire travailler plus et plus longtemps, d’imposer la prise de jours de congés et de repos, ce sera encore plus facile demain.
Si, donc, on peut penser se réjouir de cette ordonnance sur l’activité partielle et se rassurer de ne pas perdre de salaire ou pas trop, il ne faut surtout pas perdre de vue que cette illusion de bonne nouvelle sera effacé lorsque l’austérité surviendra. De la même façon, s’il est évidemment heureux que la trêve hivernale soit repoussée de 2 mois, il ne faut pas perdre de vue que les expulsions pourront reprendre début juin, ou peut-être plus tard si la crise perdure.
Ce n’est finalement qu’un répit, qu’un temps où il n’y a pas à craindre de se faire expulser, jusqu’à ce que ce soit de nouveau la norme que d’expulser l’indésirable.
En outre, cela n’a pas empêché l’expulsion de la ZAD de la Dune en Vendée le mercredi 8 avril ; les autorités expliquent qu’il ne s’agit pas d’une expulsion à proprement parler… comment qualifier alors le fait de brûler des cabanes et d’en faire sortir tous les occupants ?
Le même raisonnement vaut pour le prolongement de la durée de validité des documents de séjour. Dans quelques mois, il faudra de nouveau se battre comme jamais pour lutter avec les exilé-es et contre les frontières. Et en attendant, cela n’a pas empêché les pouvoirs publics d’expulser des retenus des CRA vers «leur» pays d’origine.
Si ce pessimisme est regrettable, il est néanmoins nécessaire de prendre conscience du monde d’après et de ne pas compter sur la bonne volonté de nos dirigeants (gouvernants comme patrons) pour améliorer nos vies.
En revanche, on peut compter sur nous-mêmes, sur notre force collective, sur nos cœurs en révolte, pour lutter ensemble et refuser que ce monde perdure.
Il y a 75 ans, à la Libération, des grèves insurrectionnelles amenaient le Conseil National de la Résistance à imposer et créer la Sécurité Sociale, permettant ainsi à toutes et tous, quel que soit le niveau de vie, de pouvoir se soigner sans avoir à payer le coût réel de chaque opération de soins. Aujourd’hui, cet héritage a été largement mis à mal.
Il convient de le retrouver et d’imposer à notre tour la juste répartition des richesses, des services publics pour toutes et tous, la fin du monde marchand qui nous opprime, la socialisation des moyens de production, pour toutes et tous, quelle que soit l’origine ou la nationalité.
LES MESURES RELATIVES À LA PROCÉDURE PÉNALE
La procédure pénale concerne les règles relatives à la garde-à-vue, à la tenue des procès, aux délais de recours, aux demandes de libération, aux aménagements de peines, etc. Dans la mesure où il est d’une facilité déconcertante de se retrouver en garde-à-vue, puis en procès, il ne faut pas sous-estimer l’importance de connaître ses droits en matière de procédure pénale.
Avec le mouvement inédit des Gilets Jaunes, des dizaines de milliers de personne sont désormais directement touchées par la question, et on peut considérer que des centaines de milliers le sont plus ou moins directement en tant que proches des manifestants gardés à vue ou emprisonnés. Une mise au point s’impose donc.
L’ordonnance principale qui modifie certaines règles de procédure pénale fait partie des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence qui ne sont pas forcées de cesser lorsque l’état d’urgence sanitaire prendra fin. Celui-ci, en vertu de la loi EUS du 23 mars 2020, doit durer 2 mois. Mais comme vu précédemment, il peut être prolongé par la loi, c’est-à-dire par le Parlement.
Cette ordonnance, que l’on appellera OPP (ordonnance procédure pénale) par commodité, a elle-même fixé sa durée d’application, qui est d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Les délais de prescription de l’action publique sont suspendus pendant la durée d’application de l’OPP
La prescription de l’action publique, c’est l’extinction du droit des pouvoirs publics, au bout d’un certain temps après la commission de l’infraction, à engager des poursuites contre les auteurs de ladite infraction.
Autrement dit, les pouvoirs publics ont un temps limité pour pouvoir poursuivre les justiciables devant les tribunaux. On dit que l’action est prescrite lorsqu’elle ne peut plus être engagée. Ce temps peut être différent selon les types d’infraction.
Globalement, pour les délits, la prescription est de 6 ans, tandis qu’elle est de 10 ans pour les crimes.
Les délais de prescription de la peine sont suspendus pendant la durée d’application de l’OPP
La prescription de la peine, c’est l’extinction d’une condamnation pénale certes définitive mais dont l’exécution de la peine n’a pas commencé.
Autrement dit, une personne qui a été condamnée à une peine quelle qu’elle soit, mais qui n’effectue pas cette peine au bout d’un certain temps, n’aura jamais à subir cette peine.
Exemple : pour un délit commis en matière de trafic de stupéfiants, la prescription de la peine est de 10 ans. Donc si Mr X est condamné définitivement le 24 décembre 2010 pour trafic de stupéfiants à 6 mois de prison ferme, mais que, le 24 décembre 2020 il n’a toujours pas commencé à effectuer cette peine, il pourra passer un bon réveillon et n’aura jamais à effectuer cette peine.
Les délais pour l’exercice d’une voie de recours sont doublés pendant la durée d’application de l’OPP
Une voie de recours consiste en le fait de formuler une contestation contre une décision, un jugement, un arrêt… Mais on ne peut le faire que dans un certain délai. Passé ce délai, c’est trop tard et la décision contestée devient définitive.
Exemple : le tribunal de grande instance condamne Mr Gilet Jaune à 2 mois de prison avec sursis pour outrage, car il est reconnu coupable d’avoir dit à un agent de police « vous n’êtes que des menteurs et des assassins ». Mr Gilet Jaune, pour des raisons que l’on peut aisément soutenir, n’est pas d’accord avec ce jugement. Il a alors la possibilité de faire appel, c’est-à-dire qu’une Cour d’appel va juger les faits et vérifier si le tribunal n’a pas fait n’importe quoi. Mr Gilet Jaune n’a que 10 jours pour faire appel. Au-delà de ces 10 jours, il ne pourra plus contester et la condamnation de 2 mois de prison avec sursis restera pendant 5 ans. Sous le régime de l’OPP, il aura 20 jours.
À noter qu’en matière civile, c’est-à-dire pour des questions de réparations pécuniaires, donc pour lesquelles ce qui est en jeu est seulement de réparer un dommage à quelqu’un et non d’être puni par l’État, le délai est d’un mois. Également, les demandes et les recours divers peuvent être envoyés par lettre recommandée voire par courriel. Sauf les demandes de mise en liberté et de modification de contrôle judiciaire, qui elles ne peuvent être envoyées par courriel.
La visioconférence peut être utilisée sans avoir besoin de recueillir l’accord des parties.
Et même, si la visioconférence ne fonctionne pas, le juge peut décider d’avoir recours à tout autre moyen de communication électronique… (ce qui comprend le téléphone !)
Cette mesure est parfaitement absurde et soulève de très nombreuses questions : comment relier tout le monde ? En effet, il y a au minimum le tribunal, le prévenu, son avocat qui peut plaider. Et il peut parfaitement y avoir des témoins, plusieurs avocats, une partie civile… Il faut pouvoir être sûr de l’identité des personnes, de leur lucidité, de la confidentialité des échanges entre les avocats et leur client, etc. La situation est ubuesque.
Va-t-on voir bientôt des procès sur Skype ?
La publicité des audiences peut être restreinte voire remplacée par le huis clos.
En principe, tout le monde peut assister à une audience au tribunal, pénal comme civil comme administratif. Ceci uniquement dans la limite des places disponibles, c’est tout. Les audiences sont donc publiques. Si cela peut être gênant pour les prévenus d’être vus et entendus par des personnes inconnues, un tel principe est néanmoins essentiel : en effet, cela permet de ne pas laisser l’arbitraire du juge se déployer. En outre, il s’agit d’une forme de contrôle des justiciables sur l’exercice de la justice (si le juge insulte le prévenu par exemple, s’il coupe la parole aux avocats… etc.).
Les personnes présentes dans la salle peuvent aussi être un appui précieux pour une procédure contre ce juge, ou au moins pour témoigner dans la presse.
Il ne faut cependant pas se leurrer : ce n’est pas parce que les audiences sont publiques que la justice est douce et gentille, raisonnable et sereine. Elle demeure une justice de classe, une justice faite de comparutions immédiates scandaleuses, une justice qui, comme la police, chercher à maintenir l’ordre établi, le contrôle et la discipline des populations.
Néanmoins, la publicité des audiences demeure un rempart à l’arbitraire franc et décomplexé. Or, l’OPP donne le pouvoir au président du tribunal de restreindre la publicité des audiences voire d’en ordonner le huis clos (huis clos signifie personne dans la salle sauf les impliqués). Il peut autoriser la présence de journalistes, même en huis clos.
La composition des juridictions peut être modifiée
Pour beaucoup de juridictions, la formation est très souvent collégiale, c’est-à-dire qu’il y a un juge et des assesseurs, et ils prennent la décision ensemble. Ils peuvent ne pas être d’accord sur la peine, voire sur la culpabilité ou l’innocence du prévenu. Parfois, ils passent vraiment longtemps à débattre du verdict… Là encore, il s’agit d’une garantie contre l’arbitraire du juge : si le juge est seul, il suffit qu’il soit mal luné pour que les peines prononcées soit injustement sévères. Un jugement ne devrait pas reposer sur l’humeur du juge. Cependant, là encore, il ne faut pas se leurrer sur le fait que la justice a pour fonction de punir et qu’elle est de toute façon soumise à des considérations politiques.
Par exemple, les comparutions immédiates qui suivent les manifestations sont toujours sous le sceau de la sévérité et du mépris du prévenu. De la même façon, si la campagne politique du moment est de lutter contre les vols de vélos, un prévenu rendu coupable de cette infraction se verra infliger une peine exemplaire à tous les coups.
L’OPP prévoit la possibilité que les juridictions collégiales (tribunal correctionnel, tribunal pour enfants, tribunal de l’application des peines…) puissent ne plus être collégiales mais être formées par un seul magistrat (le juge déjà prévu pour être président du tribunal ou bien un autre magistrat qu’il désigne).
Les dérogations relatives à la garde-à-vue
• L’entretien avec l’avocat peut se dérouler par un moyen de communication électronique et l’assistance de l’avocat au cours des auditions peut également se dérouler par un moyen de communication électronique.
En principe, si on demande un avocat, il doit se déplacer jusqu’au commissariat où on est gardé à vue. On a le droit à un entretien de 30 minutes maximum avec lui. Puis il reste pendant l’audition.
Le fait de voir une personne autre qu’un agent de police physiquement, de pouvoir parler avec elle, est très important en garde-à-vue. En effet, enfermé-e en cellule, parfois seul-e, le temps est très long. Sortir de la cellule pour voir un visage humain et échanger des phrases est salutaire.
Normalement, en arrivant au commissariat, l’avocat a accès non pas au dossier complet mais seulement aux PV de notification des droits, au PV d’interpellation et au PV de placement en garde-à-vue. Comment peut-il y avoir accès s’il ne se déplace pas ? Par mail ? Comment garantir que ce moyen de communication est sécurisé ?
• La prolongation de la GAV peut être décidée sans présentation de la personne devant le magistrat compétent.
En principe, à chaque prolongation de la GAV, on est présenté devant le procureur. S’il est rare que cela change quoi que ce soit, ce moment peut néanmoins être l’occasion de souligner plusieurs manquements de la police.
Par exemple, si on ne vous a pas donné d’eau ou à manger malgré vos demandes, si on vous a insulté ou si des agents ont été violents avec vous, il est possible de le signaler au procureur. Cela peut permettre de garder une trace de la violation de vos droits, trace qui peut être utile dans la procédure.
Mais l’OPP prévoit que ce n’est pas obligatoire pendant l’état d’urgence sanitaire. Évidemment, le procureur n’est jamais du côté du prévenu, il ne faut pas compter sur quoi que ce soit de positif de sa part (sauf si vous êtes policier). Ainsi, ne pas pouvoir lui formuler d’observations demeure un problème.
Les dispositions applicables aux détentions provisoires
• Les délais maximums de détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) sont prolongés :
> de 2 mois si la peine maximale encourue est inférieure ou égale à 5 ans
>de 3 mois dans les autres cas
En matière criminelle, le délai est même porté à 6 mois.
Il importe de relever que ces dispositions sont valables pour les détentions provisoires en cours. Ce qui signifie que des détenus, placés en détention provisoire depuis quelques mois et qui devaient être libérés par exemple début avril, devront rester en prison jusqu’à début juin, soit 2 mois de plus ! Et ce alors que les prisons sont surpeuplées, que ce surpeuplement est dangereux pour les détenus en cette période de crise sanitaire, et que nos dirigeants insistent tous les jours sur l’importance du respect du confinement, de la distanciation sociale et des gestes barrières !
• Concernant une personne qui est placée en détention provisoire en attendant sa comparution immédiate, c’est-à-dire pour une personne qui n’a même pas encore été présentée à un juge qui lui demandera si elle souhaite un délai : la personne doit comparaître au maximum 3 jours ouvrables après son placement en détention (C’est le juge des libertés et de la détention qui décide du placement en détention provisoire).
Cette situation peut se présenter lorsqu’une manifestation a lieu un jeudi : des personnes sont interpellées, certaines passeront 48h en garde à vue donc jusqu’au samedi. Certaines sortiront, mais il arrive que d’autres passent le reste du samedi, tout le dimanche et une partie du lundi matin en détention, et passent en comparution immédiate le lundi à 14h. L’OPP prolonge le délai de 3 jours pour le faire passer à 6 jours.
• Concernant les comparutions immédiates où l’intéressé-e ne souhaite pas être jugé-e le jour même mais demande un délai : Dans la procédure de comparution immédiate, quand on arrive devant le tribunal, le juge doit nous demander si on souhaite être jugé aujourd’hui ou bien si on souhaite un délai.
Les délais dans ce cas sont tous repoussés par l’OPP.
Plus précisément :
> si on souhaite un délai : En principe, pour des peines encourues de moins de 7 ans de prison, le procès ne peut avoir lieu dans plus de 6 semaines. L’OPP porte ce délai à 10 semaines. Pour des peines encourues de plus de 7 ans, en principe le procès doit avoir lieu dans les 4 mois.
L’OPP porte ce délai à 6 mois.
> si le juge place l’intéressé-e qui a souhaité le délai en détention provisoire : Le jugement doit être rendu dans les deux mois. Pas l’audience (qui elle doit avoir lieu dans les 6 semaines), mais le jugement, la décision finale du tribunal. Il arrive en effet, au cours d’une audience, qu’elle soit interrompue par exemple pour une demande de complément d’information. En outre, il arrive également que le verdict soit rendu plusieurs semaines après l’audience. Il faut donc bien distinguer l’audience (ou la comparution) du rendu (ou du verdict, ou du jugement). Si le jugement n’est pas rendu dans les 2 mois, le prévenu est libéré d’office. L’OPP porte ce délai à 4 mois.
À noter que lorsque la peine encourue dépasse les 7 ans de prison, le délai est en principe de 4 mois, il est porté à 6 mois par l’OPP.
> lorsque l’intéressé-e est condamné-e à de la prison ferme, sans sursis : Le juge peut décider le maintien ou le placement en détention immédiat. Le prévenu, qui est donc détenu, peut dans ce cas faire appel du jugement. Alors la Cour d’appel doit statuer dans les 4 mois.
L’OPP porte ce délai à 6 mois.
> l’appel du placement en détention : Là encore, les délais de traitement des demandes sont prolongés, d’un mois.
Le délai particulier pour le Juge des libertés et de la détention pour statuer sur une demande de mise en liberté est porté à 6 jours ouvrés.
> les pourvois en cassation contre le placement en détention : si la Cour d’appel refuse la remise en liberté, on peut former un pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation. Celle-ci ne juge pas d’après les faits, qui sont laissés à la libre appréciation des juges de première instance et d’appel (qu’on appelle les juges du fond parce qu’ils jugent le fond de l’affaire), mais elle va vérifier si les juges d’appel ont utilisé les bonnes règles de droit, s’ils n’en ont pas oublié une ou plusieurs, et s’ils ont utilisé correctement les règles de droit en question. En temps normal, la chambre criminelle de la Cour de cassation a 3 mois pour statuer sur cette demande de remise en liberté.
L’OPP porte ce délai à 6 mois.
Enfin, les mémoires, c’est-à-dire les arguments de l’avocat en gros, doivent en principe être déposés dans le mois qui suit la formation du pourvoi : L’OPP porte ce délai à 2 mois.
• En prison, qui va où ?
Il existe plusieurs types de prison :
- La maison d’arrêt : y sont incarcérées les personnes placées en détention provisoire, les personnes condamnées 2 ans fermes ou moins, et les personnes à qui il reste 2 ans ou moins à purger.
- Les établissements pour peines : ils sont eux-mêmes divisés en 3 catégories : les maisons centrales (y sont enfermées les personnes condamnées à une longue peine et les «personnes à risques».), les centres de détention (y sont emprisonnées les personnes condamnées à plus de 2 ans de prison mais qui ont des perspectives de réinsertion sociale) et les centres de semi-liberté (y sont placées des personnes qui peuvent sortir pour travailler, suivre une formation, ou un projet de réinsertion. Elles doivent y revenir quand elles ne sont pas occupées ainsi).
L’OPP prévoit que les personnes emprisonnées, quel que soit leur statut, peuvent être transférées n’importe où, quel que soit le type de prison.
Cette disposition peut être appliquée si par exemple, dans une prison, le virus circule trop et est donc présent sur toutes les surfaces. Afin d’éviter une contamination générale, il est considéré qu’il est préférable de transférer les détenus. Néanmoins, ce transfert peut être très dure pour des détenus qui sont transférés loin de leurs proches pour une durée indéterminée (qui peut donc durer après la fin de la suspension des parloirs), perdent leurs repères qui peuvent être essentiels à la survie en prison, et doivent se ré-adapter dans une autre prison… Par ailleurs, cette mesure peut être appliquée à des fins politiques contestables.
Ainsi, le mercredi 8 avril à Nantes, deux détenus ont été transférés l’un vers Rennes l’autre vers Le Havre, accusés de «profiter du confinement pour faire monter la tension en détention». N’y a-t-il plus le droit d’avoir des opinions politiques en prison ? Ni de s’inquiéter de la santé de l’ensemble des détenus et de tenter d’en parler avec eux ?
• L’application des peines :
Au cours de la détention, on peut formuler plusieurs demandes qui relèvent du domaine de l’application des peines : des réductions de peines, une liberté conditionnelle, un aménagement de peine, une libération sous contrainte…
> les procédures deviennent écrites, alors qu’en principe, ces procédures sont orales : chaque partie présente ses arguments en face-à-face, l’intéressé-e peut s’exprimer, puis le juge d’application des peines (JAP) décide en conséquence. L’OPP transforme cette procédure orale en une procédure écrite. Cela implique que le JAP ne voit personne et lit simplement les documents envoyés par les parties. Plus précisément, l’OPP mentionne que la procédure est écrite si un moyen de communication audiovisuelle n’est pas possible. Mais comme vu plus haut, il est très compliqué de réunir les parties dans un système de vision conférence déjà sur exploité.
> En ce qui concerne les réductions de peines, l’OPP apporte de manière inespéré des mesures plus satisfaisantes : les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir, si le parquet est favorable, il n’y a pas besoin de l’avis de la commission d’application des peines. L’OPP se fend également de quelques légères réductions de peines (2 mois) pourraient être accordées plus facilement. Pour des personnes condamnées à 5 ans ou moins, à qui il reste 2 mois ou moins à effectuer, le procureur, sur proposition du directeur du SPIP, peut les faire sortir pour le restant de leur peine… mais ils sont tout de même assignés à résidence pendant ce temps. Par ailleurs, un certain nombre de détenus sont exclus de cette disposition : les condamnés pour crimes, mais également ceux qui ont pu participer, de près ou de loin, à une manifestation en prison !
• En ce qui concerne les mineurs : Les mesures de placement peuvent être prolongées, par le juge des enfants, pour 4 mois maximum. Les autres mesures éducatives peut être prolongées de 7 mois maximum. Ceci sans audience.
EN PRISON, UNE SITUATION DE PLUS EN PLUS INQUIÉTANTE
L’ordonnance de procédure pénale fait tout pour qu’il soit possible de garder des personnes en détention, provisoire ou non. L’état d’urgence sanitaire semble être une sorte de parenthèse dans le temps…mais ce temps n’est pas le même pour la justice comparé à celui des détenus. Si la prolongation de tous ces délais arrange bien les juges, elle est passablement difficile pour des personnes emprisonnées. En outre, il est nécessaire de soulever le fait que l’accès aux soins en prison est fortement diminué par rapport à celui des personnes libres. En cette période de crise sanitaire, les détenu-e-s sont clairement plus en danger face au coronavirus que les personnes en liberté. Cette crise sanitaire ne fait que confirmer ce qu’on pouvait voir : les prisonniers sont considérés comme des humains moins importants que les personnes libres. Ils peuvent être sacrifiés.
LES PARLOIRS SUSPENDUS : SUPPRESSION DU SEUL CONTACT AVEC L’EXTÉRIEUR
Dès le début de la crise, les parloirs ont été suspendus. Pour des dizaines de milliers de détenus, le parloir est le seul moment où ils peuvent parler à quelqu’un de libre, à quelqu’un qui leur est proche. C’est le seul contact autorisé avec l’extérieur.
En effet, à l’intérieur des murs, les détenus n’ont pas de téléphone, pas de télé, pas de radio. En tout cas pas automatiquement. Pour bénéficier de tels outils, ils doivent cantiner, c’est-à-dire payer de leur poche. Or, ils n’ont pas accès à leur compte en banque. Le seul moyen pour eux d’obtenir de l’argent est de recevoir un mandat envoyé par des personnes libres. Cependant, s’ils reçoivent plus de 200 euros par mois, l’administration pénitentiaire en prélève une partie.
Or, tout coûte très cher en prison, beaucoup plus cher que dans la vie en liberté. Par exemple, l’accès au téléphone coûte jusqu’à 70 euros par mois, pour 20 minutes d’appel quotidien vers des téléphones fixes. La location d’un frigo coûte environ 7,50 euros par mois, celle d’une télé coûte environ 14 euros par mois. Les repas ne sont pas satisfaisants sur le plan de l’équilibre alimentaire, mais là aussi les denrées «supplémentaires» coûtent cher.
En d’autres termes, les détenus mangent mal, s’ennuient dans de minuscules cellules parfois partagées avec un co-détenu, et ne peuvent prendre l’air dans la cour de la prison qu’une heure par jour. S’ils parviennent à obtenir de façon illégale un téléphone portable, ils savent qu’ils risquent gros si un maton s’en aperçoit.
Sans les parloirs, la vie est encore plus difficile.
LA RÉALITÉ MÉCONNUE DE LA VIE EN PRISON
Il est difficile de se rendre compte de la réalité de la vie en prison. Il faut dire aussi que les pouvoirs publics font en sorte que les murs soient infranchissables et qu’on ne sache pas ce qui s’y passe. Le résultat en est que globalement, les prisons sont un univers flou, oublié, comme s’il s’agissait d’un monde parallèle auquel on ne préfère pas penser.
Au cours des dernières semaines, des mutineries ont éclaté dans de nombreuses prisons, en France mais aussi en Italie, et sans doute un peu partout dans le monde. Des milliers de prisonniers ont manifesté dans les établissements pénitentiaires, notamment pour protester contre la suspension des parloirs, parloirs qui constituent leur seule possibilité de contact régulier (et légal) avec l’extérieur, qui leur permet de ne pas perdre le fil de leur vie.
Ces manifestations ont également mis en lumière la grande difficulté d’accès aux soins en détention, ce qui fait craindre aux détenus une mortalité très importante parmi eux. Une crainte balayée par les pouvoirs publics. Seuls des détenus à qui il reste moins de 2 mois à purger, et qui ont été condamnés à moins de 2 ans de prison, peuvent bénéficier d’une libération.
Mais cette libération est conditionnée à une assignation à résidence ; par ailleurs elle ne concerne que les détenus qui se sont bien comportés pendant leur détention. Cette dernière condition est tout à fait révélatrice de l’esprit de contrôle et de discipline du système répressif français. Une « récompense » (si toutefois on peut appeler ainsi une libération avec assignation à résidence) ne saurait être accordée à quiconque conteste l’autorité, transgresse les règles, se détache des normes.
Cette distribution de bons et de mauvais points évoque les époques les plus sombres de l’histoire. Une telle mesure vise à s’assurer de la fidélité, ou, a minima, de la docilité, des personnes, et, à l’inverse, à sanctionner celles et ceux qui expriment un désaccord avec l’ordre établi.
Les récentes mutineries vont priver bon nombre de prisonniers des maigres droits qui pouvaient leur rester.
Elles montrent également la détresse et la colère de milliers d’individus oubliés, négligés, qui risquent leur vie, ou à tout le moins leur intégrité face aux ERIS (la police des prisons), pour conserver le peu de lumière à laquelle ils peuvent avoir droit. La violence des ERIS peut se déployer sans crainte : il n’y a pas de caméras pour les filmer. S’il arrive qu’un détenu filme avec un téléphone, c’est assez rare et il risque gros. Déjà que dans la vie courante, même sous le feu des projecteurs, la police fait preuve d’une violence inouïe, fait usage de ses armes dangereuses de façon tout à fait décomplexée, alors il faut imaginer ce que ça peut donner dans des prisons où il n’y a pas de caméras et où les détenus auront bien du mal à témoigner parce qu’ils ont peu de contacts avec l’extérieur !
DES CRA ENCORE PLUS EXPOSÉS
La vie dans les Centres de rétention administrative est encore moins enviable.
Les étrangers qui y sont enfermés n’ont commis aucune infraction, ils ont seulement le malheur de ne pas être français et de ne pas avoir de papiers en règles.
On y retrouve les mêmes aberrations que dans les autres prisons : un accès aux soins très limités, un isolement extrême, des gardiens hostiles et racistes… Et les personnes qui y sont enfermées ne ressortiront que pour monter dans un avion ou un train pour se faire expulser !
Depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, l’État n’a pas cessé les expulsions, ni pris la moindre mesure en faveur des retenus. Ceux-ci ont fait part de leur détresse et de leur colère d’être ainsi maltraités dans une période où leur vie est encore plus exposée que d’habitude.
De façon manifeste, l’État n’accorde pas aux étrangers qualifiés d’illégaux la même valeur qu’aux «bons citoyens français». Cela ne l’empêche cependant pas de vanter les mérites de ces étrangers lorsqu’ils travaillent dans les exploitations agricoles.
Cet attachement à la nationalité pour juger de la valeur d’un individu mène aux plus grandes inégalités, et surtout aux pires extrémités. D’une façon générale d’ailleurs, échelonner la valeur des individus sur quelque critère que ce soit pour en faire le tri est un élément fondamental du système dans lequel nous vivons, et doit être aboli. Peu importe pour quelle raison les détenus sont emprisonnés. Détenus ou non, ils devraient bénéficier des droits les plus élémentaires, comme le droit à la santé et le droit de se défendre.
L’un et l’autre sont gravement mis à mal en cette période de crise. Les prisonniers seraient-ils des sous-hommes ? Parce qu’ils ont commis un délit ou un crime, même grave, doivent-ils être considérés comme négligeables ? Si l’on raisonne ainsi, si on considère que les prisonniers sont moins importants que les autres, alors où est la limite ?
Personne ne doit pouvoir décider de la vie ou de la mort de qui que ce soit. Car c’est ce qui se joue sous nos yeux en cette période de crise sanitaire, et ce sera de plus en plus manifeste : le pouvoir s’arroge le droit de décider qui doit être sauvé en priorité, et qui peut mourir sans dommages «pour la France», «pour l’économie». À l’opposé de ces logiques de tri et de hiérarchie de valeur entre les individus, nous devons affirmer celle de la valeur égale de chaque personne qui compose ce monde, celle de la vie et de la révolte vivante face à des dirigeants machiavéliques et mortifères.
LES MESURES CONCERNANT LES CONGÉS PAYÉS, DURÉE DE TRAVAIL ET JOURS DE REPOS
Une introduction s’impose sur la hiérarchie des normes en droit du travail : Comme vu en deuxième partie de ce dossier, le droit en général est régi par un principe essentiel : celui de la hiérarchie des normes. En droit du travail, une telle hiérarchie existe également, mais elle a été sévèrement reconstituée par la loi travail de 2016. Il est nécessaire, pour la compréhension des droits des salariés, d’expliciter sommairement l’organisation des normes en droit du travail.
Il existe une immense variété de métiers, de types de métiers, d’entreprises, en fonction de leur taille, de leurs objectifs, de leurs activités etc. C’est pourquoi tous les domaines ne sont pas organisés de la même façon. Par exemple, un magasin de vêtements n’a pas du tout le même type d’activité qu’un débit de boissons en ville. Concrètement, un débit de boissons en ville est souvent ouvert en soirée, alors qu’un magasin de vêtements est ouvert en journée. Ce qui implique des règles différentes, le travail de nuit n’est pas le même que le travail de jour. Afin que chaque salarié soit soumis à un cadre juridique précis, qui corresponde aux objectifs de l’entreprise, il a été décliné les normes du droit du travail selon une nomenclature spécifique :
• Il y a, sous le niveau de la loi (codifiée dans le code du travail), la convention collective. Elle s’applique à tous les salariés d’un même secteur d’activité.
Ex : Convention collective nationale des entreprises de propreté
• Puis juste en dessous, on trouve l’accord de branche : il n’est pas obligatoire. Il s’agit d’un accord entre les entreprises du même secteur d’activité car le secteur concerné par la convention collective peut être plus large que celui concerné par l’accord de branche.
Ex : il existe la convention collective du personnel des cabinets médicaux. En dessous, on trouve un accord de branche entre les entreprises de radiologie. Ceci s’explique par le fait que les cabinets de dentistes, par exemple, qui font partie des cabinets médicaux et qui sont donc soumis à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, ne font pas de garde. Au contraire des cabinets de radiologie, qui font aussi partie de la même convention collective du personnel des cabinets médicaux, mais dont le personnel a des gardes de nuit à effectuer.
Le législateur a donc estimé qu’il était nécessaire de mettre en place réglementation précise au sujet de ce travail de nuit, en termes de salaires, de nombre d’heures de travail consécutives possibles, du temps de repos qui doit suivre, etc.
• Ensuite, il y a l’accord d’entreprise, qui ne s’applique qu’à l’entreprise concernée.
• Et enfin, il y a le contrat de travail, qui lui ne s’applique qu’au salarié qui le signe.
Les conventions et accords doivent être signés par les patrons ET par les syndicats représentatifs dans le secteur ou la branche.
Jusqu’en 2016, chaque accord situé en-deçà de la loi ne pouvait pas prévoir des règles moins favorables aux salariés que ce que prévoyait le code du travail. La loi travail de 2016, complétée par les ordonnances travail de 2017, revient sur cette règle et autorise les conventions et accord à déroger défavorablement au code du travail en ce qui concerne les conditions de travail des salariés. Ce qui brise tout le principe de hiérarchie des normes. Retenons alors que la hiérarchie des normes demeure un principe, mais que ce principe peut souffrir d’un certain nombre d’exceptions, exceptions qui, bien entendu, arrange toujours les plus puissants au détriment des plus opprimés.
À présent que ce cadre est sommairement posé regardons de plus près l’ordonnance de l’état d’urgence sanitaire. Dans la poursuite des mesures antisociales et sécuritaires, cette aménagement de la loi permet la casse du code du travail. Une stratégie du choc.
En premier lieu, l’ordonnance permet à l’employeur d’imposer au salarié de poser des jours de congés payés ou de modifier ses dates de congés payés ; cela ne peut concerner que 6 jours de congés payés. L’employeur doit prévenir le salarié au moins 1 jour en avance.
Il peut également fractionner les congés payés sans recueillir l’accord du salarié. Dans un souci de précision, il importe de préciser qu’en réalité, l’ordonnance ne permet pas directement à l’employeur de procéder ainsi, mais permet qu’un accord d’entreprise ou un accord de branche permette à l’employeur d’agir de cette façon. L’employeur doit avant tout modifier les règles qui régissent son entreprise, à savoir l’accord d’entreprise ou l’accord de branche applicable. Ceci est valable jusqu’au 31 décembre 2020.
En deuxième lieu, l’employeur peut cette fois-ci déroger à la convention collective ou l’accord en dessous, en imposant des dates de jours de repos ou en modifiant ces dates si le salarié en avait déjà posés. Il doit prévenir le salarié 1 jour avant. Il peut faire de même dans le cadre d’une convention de forfait. Il peut également imposer que les droits qui figurent dans le compte épargne-temps d’un salarié soit utilisés comme jours de repos, dont il peut imposer les dates. Tout ceci ne peut concerner plus de 10 jours de repos. Ceci est aussi valable jusqu’au 31 décembre 2020.
«Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale» (elles seront déterminées par décret pour éviter les confusions), plusieurs règles élémentaires peuvent être imposées :
• Le temps de travail quotidien maximal peut être de 12h (au lieu de 10h maximum)
• Le temps de travail quotidien maximal DE NUIT peut être de 12h (au lieu de 8 heures maximum), le temps de repos qui suivra doit être augmenté du nombre d’heures de travail au-delà de 8h effectuées.
• La durée minimale de repos quotidien peut être de 9h (au lieu de 11 heures)
• La durée maximale de travail par semaine peut être de 60h (au lieu de 48h)
• La durée maximale de travail par semaine, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, peut être de 48h (au lieu de 44h). Pour les entreprises ayant une production agricole, la durée maximale de travail par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs, peut être de 48h.
• Pour le travail de nuit, la durée maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives peut être de 44h (au lieu de 40h)
• Le repos peut être donné un autre jour que le dimanche
• En matière de protection des salarié-e-s le gouvernement autorise les employeurs à ne pas respecter l’exercice des missions de la médecine du travail (c’est vrai que c’est le moment !) et à ne pas respecter les délais de consultation des représentants du personnel.
Il est possible de reporter des visites médicales et des interventions dans les entreprises de la médecine du travail (ordonnance du 1er avril 2020).
• Un certain nombre de professions en particulier voient leur activité maintenue par ordonnance, ce qui revient à interdire le droit de grève et de retrait à ces salarié-es : les assistantes maternelles (en augmentant au passage le nombre d’enfants qu’elles peuvent garder), les salarié-e-s s’occupant des handicapés et des personnes âgées, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté. Ces mesures sont valables jusqu’au 31 décembre 2020.
Ces mesures, associées aux avantages fiscaux, facilitent donc l’exploitation des travailleurs, pré-mâchent la casse du code du travail et permettent simplement aux patrons et aux grandes entreprises de conserver leurs fortunes.
POUR SAUVER L’ÉCONOMIE : TRAVAILLER PLUS ET SUPPRESSION DES DROITS
L’ordonnance rédigée est rêvée pour les employeurs. L’ordonnance prévoit par exemple un temps de travail « maximal » augmentant de 2h seulement par jour. Ajouter 2h de travail par jour est énorme. Il faut bien se rendre compte que cette moyenne sur un temps assez long fait considérablement augmenter les cadences.
En 1968, des affiches «stop aux cadences infernales» étaient placardées dans les rues. Aujourd’hui, les rues ne sont plus occupées que par des agents de police qui font la chasse aux contrevenants, pendant que des travailleurs et travailleuses vont se tuer à la tâche pour soit disant « sauver l’économie ». La très très large majorité des gens respectent le confinement et restent chez eux, à regarder le monde sombrer dans une frénésie sécuritaire et économique.
Ces mesures permettent en réalité aux entreprises d’éviter le recours à l’activité partielle. En effet, en jouant avec les jours de repos forcés et les horaires de travail, elles peuvent mettre en place des équipes tournantes et ainsi maintenir l’activité de la meilleure façon possible pour elles.
DE 2008 À NOS JOURS, RIEN N’A CHANGÉ
De la même façon que la crise de 2008 avait amené les gouvernants à sauver le capitalisme en injectant des milliards dans les banques et en matant les grèves et les manifestations, la crise sanitaire de 2020 produit sensiblement la même chose : sur le plan sécuritaire, on voit apparaître des drones et des hélicoptères infra rouges pour trouver les contrevenants, on voit la police chasser dans les quartiers populaires de façon encore plus décomplexée qu’auparavant, on voit cette même police coller des amendes à des personnes sans domicile, pendant que le préfet de Paris Didier Lallement affirme sans complexe que les malades du covid-19 en réanimation sont responsables de leurs malheurs dans la mesure où leur contamination signifie qu’ils n’auraient pas respecté le confinement.
Pour «sauver l’économie», le pouvoir n’a aucun scrupule à permettre aux patrons de maintenir l’activité de leurs entreprises, et donc de faire travailler les salariés, peu importe si les conditions sanitaires élémentaires ne sont pas mises en place. Si, contrairement à 2008, des dispositifs tels que le chômage partiel, ou bien l’extension des ARE (Allocation chômage d’aide au retour à l’emploi) et des minimas sociaux, ont été adoptés pour éviter que la moitié des travailleurs se retrouvent à sec, cela n’empêche nullement que tout est fait pour que le patronat ne perde rien, ou disons le moins possible, dans cette période. Le code du travail pourra bientôt être relégué au rang de souvenir lointain. Les patrons ont toute latitude pour ne rien laisser au choix des salarié-e-s, en termes de temps de travail, de temps ou de jour de repos.
Nos vies ne comptent plus, seules celles des entreprises doivent être prise en compte. C’était déjà le cas en 2008. Alors qu’on aurait pu penser qu’une telle crise économique remette en question le mode de production frénétique du capitalisme et de la finance, les années qui ont suivi ont montré que rien n’avait changé : les banques ont été sauvées, l’économie aussi, les licenciements ont été massifs, le recours au travail temporaire s’est multiplié, les professionnels de l’aménagement ont continué de bétonner des milliers d’hectares chaque année, et les inégalités se sont creusées. Les salariés, tout comme les détenus, les personnes âgées, les personnes sans domicile et les exilé-e-s, sont sacrifiées pour que ce monde mortifère continue de vivre.
Plutôt que de se poser la question basique «mais comment en est-on arrivé là ?», les dirigeants préfèrent faire tout leur possible pour maintenir ce monde moribond en vie, pour garder leur place et leurs privilèges, pour que l’organisation sociale, l’organisation de l’exploitation, ne changent pas d’un iota. Et qu’on enlève à ces salariés, potentiellement agitateurs et empêcheurs de tourner en rond, toute possibilité de se révolter. Ils iront au travail, quitte à ce qu’ils y laissent la santé voire la vie.
DES ENTREPRISES SANS SCRUPULES
Ainsi, dans les entrepôts d’Amazon, grand gagnant de cette crise, les salariés sont contraints de travailler dans des conditions qui ne respectent absolument pas les mesures d’hygiène préconisées. Les masques, gants, lunettes de protection et gel désinfectant sont aux abonnés absents. Tout au plus un distributeur de gel hydroalcoolique a été installé à l’entrée de la cantine dans certains sites. La règle générale dans Amazon consiste à rendre responsable le personne des contaminations sur les sites. Par ailleurs, la multinationale vend de tout et non pas seulement des produits essentiels. Alors que les pouvoirs publics pointent du doigt les « contrevenants irresponsables » qui sortent en famille dans des endroits publics, Amazon peut poursuivre ouvertement son activité économique très lucrative au mépris de la santé des salarié-e-s.
D’autres entreprises non essentielles continuent de tourner, au détriment des salariés. Chez l’entreprise Stelia, qui fabrique des structures d’avion pour Airbus, la production a certes ralenti mais une activité partielle est maintenue. Sur le site de Saint-Nazaire, les délégués syndicaux n’ont pas le droit de se rendre sur place pour veiller au respect des conditions de travail ! Et ce au nom de la protection sanitaire ! Chez Airbus, la production a partiellement repris sur plusieurs sites dans le monde.
En France, un accord a été signé entre la direction et certains syndicats visant à imposer aux salariés de prendre 10 jours de repos forcé pour remplacer leurs «heures perdues» ! Dans un grand nombre de grandes surfaces, les caissiers n’ont pas de masques ni de gants ni de gel. Si, après quelques semaines, une partie a fini par accorder ces protections à ses salarié-es, il n’en demeure pas moins qu’il est parfaitement irresponsable de les avoir laissés tout ce temps exposés à la maladie. Encore aujourd’hui, toutes n’ont pas été très zélées dans la protection des salariés : parfois, il n’y a qu’un simple plexiglas placé entre la caisse et le client… Or, en déterminant la liste des entreprises qui doivent rester ouverte, le gouvernement empêche de fait l’exercice du droit de grève et du droit de retrait pour les salarié-e-s qui y travaillent. Nombreuses sont les entreprises à maintenir une activité, même partielle, dans le seul but de perdre le moins de chiffre d’affaires possible.
Alors même que des activités ne sont absolument pas nécessaires du point de vue sanitaire ni pour l’approvisionnement en denrées alimentaires, elles sont autorisées à tourner pour «éviter une récession trop importante». Et pour qu’elles produisent vraiment, ces entreprises, les patrons privent les salariés d’un certain nombre de droits : empêchement d’exercer correctement un mandat syndical, restrictions de l’usage du droit de retrait dans les faits… Avec un risque important de licenciement pour faute grave, il est à craindre que les salariés n’osent pas dire «non». Ceci d’autant plus que l’inspection du travail, de même que les Conseils de Prud’hommes, ont perdu tant de prérogatives et de moyens d’agir qu’ils ne pourront pas examiner rapidement toutes les situations. Ces structures vont se retrouver débordées, si ce n’est pas déjà le cas.
Cette crise aggrave encore les conditions de travail des salarié-e-s.
Dans la droite ligne des réformes du code du travail telles que la loi travail de 2016 et les ordonnances travail de 2017, le patron a de plus en plus de marge de manœuvre pour assouplir toutes les règles du travail dans son entreprise, au détriment des salariés qui voient leurs conditions de travail se détériorer sévèrement tout en perdant leurs droits et possibilités de contester vraiment
LA QPC RENDUE INEFFICACE POUR LA LUTTE CONTRE LE COVID-19
Dans les dossiers précédents, nous avons résumé la loi qui prévoit le dispositif d’état d’urgence sanitaire adoptée le 23 mars 2020 pour deux mois sur la totalité du territoire français. Mais ce même jour, une loi organique a également été adoptée. Celle-ci, dans un article unique, suspend dans les faits les Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) jusqu’à la fin du mois de juin.
Dans cette partie du dossier, nous allons nous pencher plus massivement sur les institutions qui contrôlent notre société.
BREF HISTORIQUE
La Constitution actuelle a été adoptée en 1958 par un référendum. Le projet a été élaboré par Charles de Gaulle, puis il a été soumis pour avis à un comité consultatif constitutionnel composé de membres du Parlement et au Conseil d’État. On pourrait penser que le référendum est une base de démocratie importante. En réalité, si l’on peut apprécier le fait que le peuple ne soit pas complètement tenu à l’écart du processus constitutionnel, dans la mesure où une Constitution est le texte fondateur d’un régime, qui régit la façon dont fonctionnent les institutions qui nous dirigent, il ne faut pas non plus tomber dans le piège simpliste qui consiste à associer le référendum à la démocratie pleine et entière.
En 1958, la IVe République s’est lamentablement effondrée après une dizaine d’années d’existence, des militaires français fomentent un coup d’État en Algérie encore sous la coupe française, et le gouvernement français tombe tout seul. De Gaulle revient en héros, en sauveur du régime, et le référendum qui approuve la Constitution est un plébiscite. Mais cela importe guère, tant qu’il y aura du pouvoir il y aura des Constitutions d’une manière ou d’une autre.
Toute modification de la Constitution doit répondre à une procédure particulière et doit être approuvée soit par référendum soit par le Parlement qui doit voter aux 3/5e pour que le projet soit validé. Il ne peut y avoir de procédure accélérée.
La loi, quant à elle, est votée par le Parlement. Il y a deux assemblées parlementaires : l’Assemblée Nationale, qui est élue au suffrage universel direct juste après les élections présidentielles. Et le Sénat, qui lui est élu au suffrage universel indirect : il est en fait élu par les élus locaux réunis en collège de grands électeurs. Les deux élections se font par circonscription électorale : il y a un nombre de parlementaires x ou y à élire dans une circonscription. La loi doit respecter la Constitution.
Le décret, lui, est adopté par le Gouvernement, et il doit respecter la loi. Le Gouvernement est composé des ministres qui eux sont nommés par le Président de la République, lui-même élu (avec plus ou moins de conviction)
Il existe certains mécanismes de contrôle, donc le contrôle de la constitutionnalité des lois que nous allons à présent détailler. Spoiler : les mécanismes de contrôle n’empêchent évidemment pas le régime autoritaire d’arriver. Simplement, il peut être important de les connaître, car ils constituent parfois des rempart à l’arbitraire sur lesquels s’appuyer.
LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS
Il existe 2 types de contrôle de conformité des lois à la Constitution: le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. C’est-à-dire le contrôle avant que la loi ne soit promulguée (la promulgation signifie la signature de la loi par le Président de la République pour que la loi puisse entrer en application) et le contrôle après la promulgation qui peut même intervenir des années et des années après. Jusqu’à la réforme constitutionnelle de 2008, seul le contrôle a priori était prévu.
• Le contrôle a priori : lorsqu’une loi est adoptée par les deux assemblées parlementaires, le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour jeter un œil sur cette loi. Plusieurs personnes ont ce pouvoir : Le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Depuis 1974, cette possibilité est également ouverte à 60 députés ou 60 sénateurs.
Globalement, on imagine assez mal les quatre personnalités mentionnées mettre des bâtons dans les roues de la marche du pays : la majorité parlementaire leur est acquise de facto depuis que la cohabitation n’est plus possible. En effet, en instaurant le quinquennat et en faisant se succéder l’élection présidentielle et l’élection législative, l’État français a empêché que la couleur politique de l’Assemblée nationale soit différente de celle du Gouvernement. Quant à la nouvelle possibilité instaurée par la loi de 1974, si elle est heureuse et a en effet été souvent mise en application, elle est parfois difficile à envisager, notamment en cas de procédure accélérée.
Mais, en tout état de cause, réunir 60 députés ou 60 sénateurs de l’opposition est assez simple en principe, sauf qu’ils profitent juste de leurs indemnités qui s’élèvent à quasiment 10.000 euros par mois. Avec le rythme effréné auquel les lois sont votées, il est évident que des centaines de textes législatifs passent entre les mailles du filet. Tant de lois sont votées à la va-vite qu’il est tout simplement impossible de toutes les contrôler. C’est pourquoi une nouvelle procédure de contrôle de constitutionnalité des lois a vu le jour en 2008 : la QPC.
• le contrôle a posteriori : la fameuse QPC. Lorsque, au moment d’une instance en cours devant une juridiction (c’est-à-dire pendant un procès, ou pendant une demande de libération conditionnelle, ou à l’occasion d’une demande dommages et intérêts au civil, ou encore devant les prud’hommes…), une des parties estime qu’une disposition législative, applicable à l’occasion de l’instance, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle peut poser une QPC. Cela signifie qu’elle souhaite que le Conseil Constitutionnel examine la conformité de la disposition en question à la Constitution.
Le tribunal concerné par l’instance regarde si la question est pertinente. Si elle l’est, il envoie la question pour avis au Conseil d’État ou à la Cour de Cassation qui a 3 mois pour vérifier si la question est sérieuse ; si oui, il la renvoie au Conseil Constitutionnel. Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne se prononce pas dans les 3 mois, le Conseil constitutionnel est saisi d’office. Tant que le Conseil Constitutionnel ne s’est pas prononcé, l’instance en cours ne peut pas reprendre. C’est « grâce » à cette procédure que la réforme de la garde à vue a eu lieu et que désormais, la police est « obligée » de nous proposer le recours à un avocat. Car avant la réforme de la garde à vue de 2010, on pouvait être enfermé sans avoir vu un avocat une seule fois.
Cette QPC donne un droit supplémentaire aux justiciables. Seulement, les membres du Conseil constitutionnel sont tous nommés par le pouvoir en place : 3 par le Président de la République, 3 par le Président de l’Assemblée nationale et 3 par le Président du Sénat. Le reste des membres sont les anciens Présidents de la République. Si les juristes assurent que le Conseil Constitutionnel est indépendant, il ne faut pas se leurrer : il répond à des impératifs politiques, à des événements d’actualités, à des circonstances politiques momentanées. Il n’est pas une instance purement juridique neutre. Le droit n’est pas neutre, l’exercice du droit n’est pas neutre, son application non plus, par qui que ce soit d’ailleurs.
Mais alors, finalement, le contrôle de constitutionnalité est-il si important pour la démocratie ? Indépendamment de la question de savoir si nous sommes ou non en démocratie, on peut y apporter une réponse positive, tout en se disant que ce n’est pas le Conseil constitutionnel qui va faire la Révolution, que ce n’est pas lui qui empêche le renforcement des pouvoirs répressifs, ni qui va empêcher qu’on revienne sur les 35h, ni qui va empêcher qu’on expulse des étrangers
Néanmoins, le contrôle des actes juridiques par une autre institution que celle qui les adopte permet quelque part d’ériger un petit rempart à l’arbitraire, et permet également une procédure plus visible, plus lisible par les justiciables.
Ce ne sont pas tant des objectifs de bonté, d’humanisme et de démocratie qui animent le législateur, que des objectifs de politique politicienne de bonne image, de satisfaction de l’opinion publique et de visées électorales.
LA QPC SUSPENDUE DE FAIT
La loi organique du 23 mars 2020 est cependant inquiétante (une loi organique est une loi qui précise les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics ; elle est obligatoirement transmise au Conseil Constitutionnel pour un contrôle de conformité à la Constitution).
En réalité, elle ne suspend « que » partiellement les QPC. En effet, elle suspend :
- Le délai de 3 mois pendant lequel le Conseil d’État ou la Cour de Cassation doit transmettre au Conseil Constitutionnel
- Le délai de 3 mois pendant lequel le CC doit encore se prononcer ensuite Ceci en arguant du fait que les institutions ne peuvent pas se réunir en formation collégiale pendant l’épidémie.
Effectivement, cela n’empêche pas du tout le justiciable de poser sa question au cours d’un procès. MAIS les délais ne courront qu’à partir du mois de juillet. Le message n’est donc pas «taisez-vous, on ne veut pas de vos QPC», mais plus exactement «causez toujours on verra ça plus tard». Concrètement, cela signifie que les ordonnances EUS ne seront pas remises en question pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.
En effet, on a vu que l’audience ne peut reprendre, et le jugement ne peut être rendu, qu’à partir du moment ou le Conseil Constitutionnel s’est prononcé (et que la procédure a été respectée bien entendu). Les délais repoussés, le Conseil Constitutionnel se prononcera plus tard. Mais cela n’empêche pas les mesures contestées de continuer à s’appliquer. Il est donc hors de question de toucher juridiquement aux ordonnances.
Mais que se passe-t-il si, dans 6 mois (voire plus), le Conseil Constitutionnel déclare certaines mesures contraires à la Constitution ? Ça nous fera une belle jambe n’est-ce pas ? Pourra-t-il y avoir une forme d’indemnisation pour des personnes qui auront souffert par la faute de ces mesures, par exemple celle qui prévoit la possibilité de travailler 60h par semaine ? Que vaut une indemnisation pécuniaire après s’être tué à la tache pendant des mois ?
Cette période est très inquiétante. Sous prétexte de faire face à la crise, et en appelant à l’unité nationale, le pouvoir ne fait que renforcer ses attributions tout en supprimant les droits les plus basiques de contestation juridique des individus.
En réponse, il nous faut renforcer les liens de solidarité et les volontés collectives, pour que cet état d’urgence ne devienne pas la clef de la toute-puissance qui nous étouffera définitivement.
COVID-19 ET MAINTIEN DE L’ORDRE, UNE FRÉNÉSIE SÉCURITAIRE
L’état d’urgence sanitaire, inventé et instauré pour deux mois par la loi du 23 mars 2020, est certainement plus un «état d’urgence» qu’il n’est «sanitaire».
DES POUVOIRS DE POLICE ACCRUS
La loi accorde de nombreux pouvoirs à la police. Celle-ci étant chargée de faire respecter le confinement, elle prend sa mission tant à cœur qu’elle a procédé, sur tout le territoire, à plusieurs millions de contrôles et dressé des centaines de milliers d’amendes. Plus que le nombre de gens testés pour le Covid-19 ! C’est colossal.
Dans ce cadre, la police ne change pas ses habitudes : elle se concentre sur les quartiers populaires et exerce des violences intolérables envers la jeunesse des cités. Or, les possibilités de réagir à ce pouvoir exorbitant et à cette violence quotidienne sont amoindries par le seul fait du confinement.
S’il est possible de contester une amende dans les 40 jours, personne n’est dupe : il s’agit de la parole d’un policier contre celle d’un individu lambda ; la parole du premier vaut plus que celle du second. En outre, la contestation de l’amende n’a aucune incidence sur le fait que la 2e verbalisation soit une récidive et qu’au bout de 4 verbalisations en 30 jours, c’est directement la case prison ! Une dérive autoritaire alarmante. La sévérité de la peine est incroyable, surtout alors que les prisons sont surpeuplées, et alors que l’accès aux soins en détention est très limité. Enfermer plus de personnes ne fera pas réduire le risque sanitaire, au contraire, il l’aggravera considérablement dans l’enceinte même des établissements pénitentiaires.
Pendant que le virus circule, le système répressif s’accélère…
DES MOYENS DÉMESURÉS POUR RENFORCER LA SURVEILLANCE
Outre les agents de police sur le terrain, les pouvoirs publics usent des grands moyens pour veiller au respect du confinement. Mais aussi, pour faire passer ceux qui ne respecteraient pas le confinement strict comme des irresponsables qui remplissent les lits de réanimation par leur incurie. Le préfet Didier Lallement a bien résumé la pensée du gouvernement…
C’est ainsi que dans plusieurs villes (Paris, Nice, Nantes, Limoges, Metz, Lyon, Rennes…), les autorités ont eu recours à un drone équipé de hauts-parleurs, pour permettre à la police de savoir où intervenir pour verbaliser. Un drone se déplace vite et peut donc visionner toute la ville en quelques heures. Les drones ont déjà été utilisés pour visualiser des manifestations, sur la ZAD par exemple, mais également à Saint-Nazaire au cours d’une manifestation des Gilets Jaunes. Leur utilisation actuelle en vue de réprimer les contrevenants au confinement laisse craindre une banalisation à venir de leur usage, et ce pour toutes sortes d’événements : des matchs de foot, des manifestations, mais aussi dans la vie quotidienne, comme ça, sous prétexte de sécuriser les villes. Rien de si étonnant lorsqu’on sait que le général Lizurey, qui avait expulsé la ZAD de Notre-Dame des Landes avec une violence inouïe, a été nommé responsable de la lutte contre le coronavirus.
Dans le même ordre d’idées, à plusieurs reprises les pouvoirs publics ont utilisé un hélicoptère avec vision infra-rouge ou un détecteur de chaleur, la nuit, pour traquer les contrevenants. Plusieurs heures de vol pour verbaliser quelques personnes, l’État a décidément les moyens !
Alors que les hôpitaux ont cruellement besoins de lits et de postes supplémentaires, le gouvernement préfère dépenser des dizaines de milliers d’euros dans des gadgets pour surveiller la population. Si il prétend que ce n’est que pour favoriser le respect du confinement dans un objectif sanitaire, il est certain qu’après la crise, d’autres raisons seront invoquées pour faire perdurer ces moyens.
Et l’hôpital public après la crise, aura toujours besoin de plus de moyens, en vue a minima d’éviter une situation aussi catastrophique de se reproduire, et, on l’espère, en vue d’assurer un véritable accès aux soins adaptés pour toutes et tous.
Par ailleurs, le traçage des smartphones a été mis en place. L’arrêté du 24 mars 2020 «fixant la tarification applicable aux prestations effectuées par les opérateurs de communication électronique» révèle en effet deux choses :
• Le gouvernement a déjà demandé, ce qui a été réalisé, la production de «marqueurs techniques», qui peuvent déclencher une «alerte» et permettre d’identifier la personne qui détient ou utilise l’appareil concerné.
• Le gouvernement a commandé aux opérateurs que soient transmises tout un tas de données techniques lorsqu’il y a une alerte : ces données techniques doivent permettre d’identifier l’origine de la communication, l’utilisateur ou le détenteur de l’appareil utilisé, le chemin effectué par la communication, la date, l’horaire, le volume de la communication… Il est probable également que les caméras intelligentes se développent.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, elles pourraient détecter les regroupements de personnes (interdits), détecter le non-respect des distances entre les individus, détecter les intrusions dans des commerces dont l’activité n’est pas autorisée… Encore une fois, l’excuse du confinement deviendra l’excuse de la sécurité en général. Toute période d’exception est suivie de la banalisation de ses effets. L’état d’urgence déclaré en novembre 2015 est entré dans le droit commun 2 ans plus tard.
S’il semble complexe d’introduire absolument toutes les mesures de l’état d’urgence sanitaire dans le droit commun dans l’immédiat, il est certain que, pour éviter que ne se reproduise une situation économique pareille, l’esprit de la loi EUS perdurera sur deux plans. En premier, sur le plan du droit du travail : il faut permettre que dans n’importe quelle situation, l’entreprise soit sauvée, l’économie n’entre pas en récession et maintienne sa croissance ; pour cela il faut bien adapter les conditions de travail tout en supprimant les obstacles que constitue notamment l’organisation collective des salariés face au patronat. En second, sur le plan sécuritaire, répressif : il faut empêcher toute contestation, pour cela il faut surveiller, punir, angoisser la population, l’encourager à se dénoncer.
Tout cela a très largement commencé. Il n’y aura pas de retour en arrière pour le pouvoir. Celui-ci a bien vu que 3 semaines d’arrêt quasi total de la production faisait entrer l’économie en récession pour tout un trimestre. Ce qui signifie que quelques semaines de grève des travailleurs et travailleuses peut déboucher sur des victoires politiques conséquentes.
Si le gouvernement souhaite ardemment prolonger les effets de l’état d’urgence sanitaire, il peut aisément en être empêché par un vaste mouvement de lutte qui doit redéfinir les bases d’un monde désirable, véritablement égalitaire, aux antipodes du monde actuel fait de concurrence, d’écrasement de l’autre, et de loi du plus fort.
AIDEZ CONTRE ATTAQUE
Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.