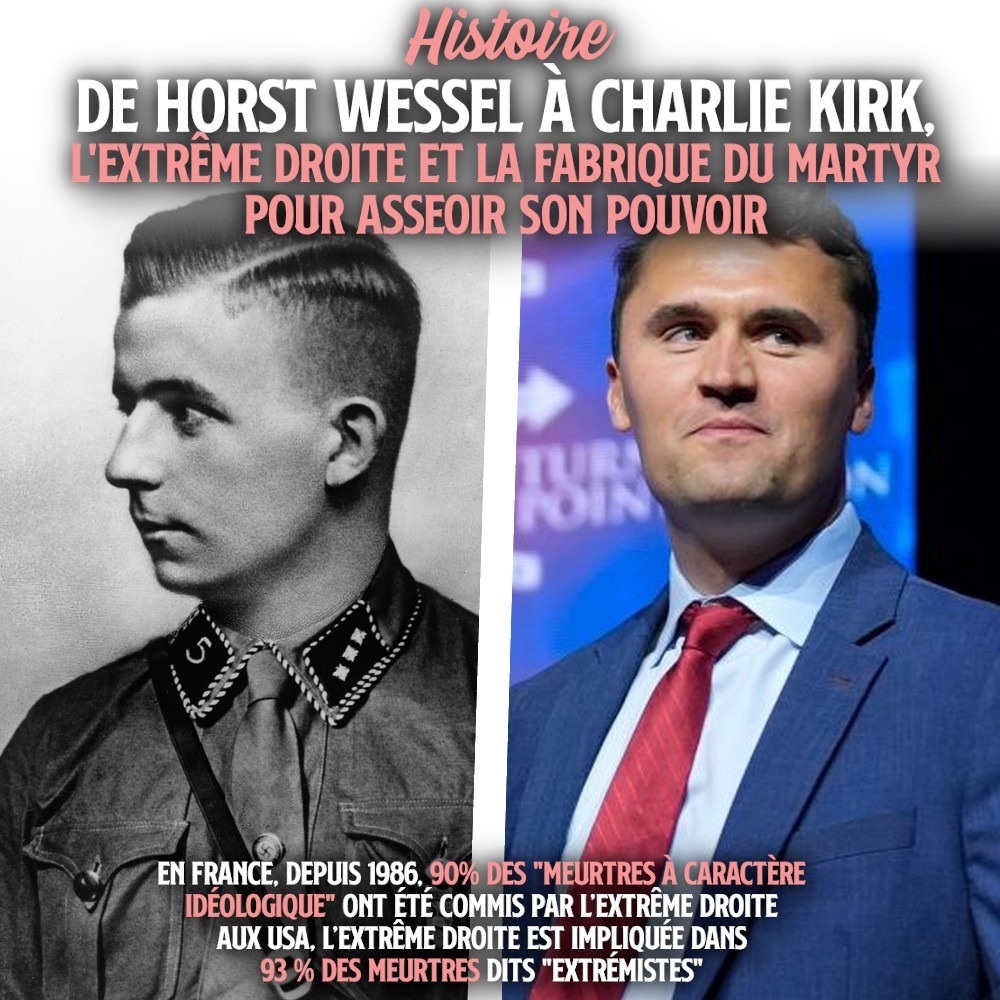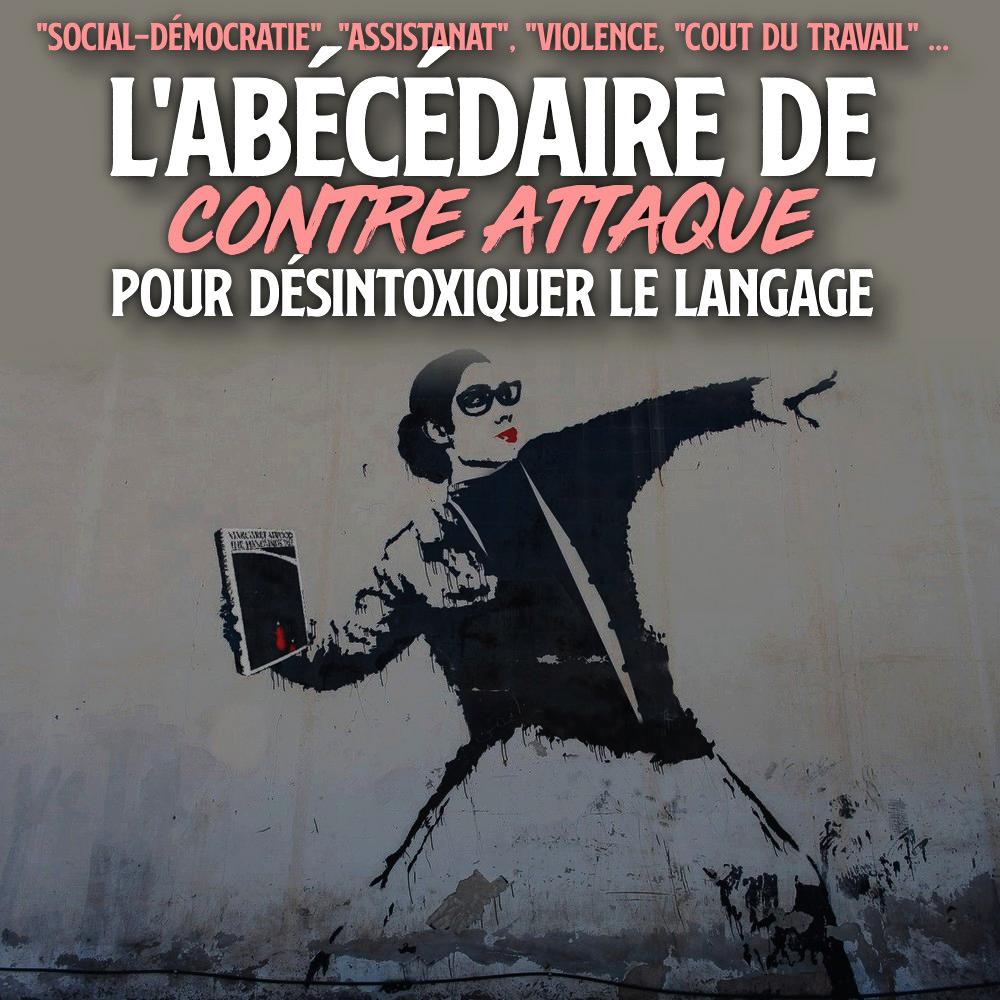Une histoire personnelle de l’ultra-gauche, Serge Quadruppani, éditions Divergences

« Ultra-gauche » est un terme continuellement brandi par les médias, dans des articles racoleurs, dès qu’il s’agit de jeter le discrédit sur les contestations sociales – tel un « spectre qui hante le pouvoir » (cf. Spectres de l’ultra-gauche, l’État, les révolutions et nous de Michel Kokoreff, éditions l’œil d’or). Mais que sait-on réellement des divers courants qui caractérisent l’ultra-gauche et qui ont traversé toute l’histoire du XXème siècle ? Il s’agit pourtant d’une histoire politique riche et créative, qui a fourni de nombreuses réflexions théoriques, qu’il importe de connaître et de questionner pour nos expériences collectives à venir.
D’un point de vue historique, l’ultra-gauche trouve son origine dans les conseils ouvriers, dans les années 1920, opposés aux organisations syndicales réformistes, aux logiques centralistes d’un parti ainsi qu’au pouvoir parlementaire de la sociale-démocratie. C’est donc la base qui est au cœur des courants de l’ultra-gauche. Une base qui souhaite s’organiser de manière autonome et qui se démarque rapidement des conceptions de Lénine et Trotsky, par exemple, pour développer ses propres moyens d’action et de réflexion. Serge Quadruppani, né en 1952, a rencontré l’ultra-gauche alors qu’il n’avait que 14 ans et n’a cessé depuis de participer aux mobilisations sociales et de contribuer à la pensée critique, notamment grâce à la rédaction de différentes revues (La Banquise, Mordicus).
Pour qui veut participer à améliorer nos conditions d’existence – ce qui est de l’ordre de la nécessité pour maintenir la planète habitable – l’histoire de l’ultra-gauche a des choses à nous apprendre. Ses divers courants nous fournissent des bases solides dans lesquels puiser : la critique du travail et du salariat, le refus de la marchandisation, la recherche d’auto-organisation en-dehors des formes que sont les partis et les syndicats, la volonté de construire une société sans État dans laquelle le commun aura toute son importance.
« Une fois qu’on s’est détaché des pittoresques mœurs de minuscules groupuscules (leurs fâcheries, leurs ragots, leurs chefaillons, leurs pathologies), on peut nouer de profitables rapports d’amitié critique avec ce qui demeure de l’ultra-gauche historique : des textes, des réflexions, des concepts toujours stimulants et féconds. Une boîte à outils forgé dans quelques-unes des plus massives et intenses expériences révolutionnaires du XXème siècle. De bons vieux outils dont plusieurs n’ont pas échappé à l’usure, dont quelques-uns sont carrément hors d’usage, mais qui, dans l’ensemble, auront bien servi pour comprendre le monde et ce qui peut encore le changer. »
Loin de s’enfermer dans une nostalgie du passé, au risque de tomber dans le « c’était mieux avant », Serge Quadruppani pose un regard critique sur les pratiques révolutionnaires de l’ultra-gauche et leurs différentes théorisations pour appeler à les dépasser. En parcourant ses expériences, de Mai 68 et des années qui ont suivi, il nous offre une histoire politique très personnelle bien plus enrichissante qu’une histoire qui se voudrait objective. Faisant preuve de recul, il aborde également des aspects moins glorieux (le collectif La Vieille Taupe, devenu négationniste, René Lefeuvre) et revient sur l’expérience de la revue La Banquise (années 1980) qui a fait l’objet d’attaques virulentes. Ses observations nous poussent à réfléchir et on se prend à imaginer la discussion avec un plus vieux camarade qui en a vu et qui a des choses à nous transmettre.
C’est peut être là que se trouve l’un des enjeux de notre génération : savoir écouter sans juger et apprendre au contact des autres. En somme, remettre au premier plan les relations sociales, avec toutes les complexités que cela implique, tisser des liens dans la vie réelle (aussi impure soit-elle) et se laisser surprendre.
En définitive, « Qu’il s’agisse de l’impossibilité d’utiliser les institutions parlementaires et étatiques pour une transformation sociale réelle, ou de l’inanité de la morale du « moins pire » (et notamment lors des échéances électorales où, de moins pire en moins pire, on ne cesse d’aller vers le pire), les quarante dernières années n’ont cessé de montrer la justesse des rejets qu’incarnaient ces courants. À quoi peut bien servir l’ultra-gauche ? À cela au moins : nous débarrasser des réalismes mortifères. »
AIDEZ CONTRE ATTAQUE
Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.