Alors qu’Israël fait exploser méthodiquement le Liban dans une impunité totale, revenons sur la révolution libanaise qui fête aujourd’hui ses 5 ans.

Il est difficile d’imaginer, dans le contexte actuel, qu’il y a cinq ans jour pour jour soufflait un vent d’espoir et de révolte sur le Liban et sa population. Aujourd’hui, les braises de la révolution d’Octobre 2019 sont éteintes depuis longtemps, laissant le pays au bord de l’abîme.
Un contexte social explosif
Comme dans la plupart des pays du Sud global, l’eau potable est un luxe au Liban. Celle qui coule des robinets est souvent trop salée, contaminée par des plastiques, des matières fécales et des métaux lourds. L’électricité nationale, quant à elle, ne fonctionne que quelques heures par jour, forçant les personnes qui en ont les moyens à se tourner vers des générateurs privés de quartier. Ainsi, pour avoir un semblant de confort, les foyers doivent souvent payer deux factures d’eau et deux factures d’électricité dont le montant total, compte tenu de l’inflation suite à la dévaluation de la livre nationale, dépasse parfois nettement le montant même du loyer !
À cela s’ajoute un système de santé qui privilégie largement le privé : en 2019, le pays comptait 30 hôpitaux publics contre 138 privés, représentant respectivement 15% et 85% des lits disponibles. Dans un pays où le système de sécurité sociale est quasiment inexistant, se soigner correctement nécessite donc de débourser des sommes importantes ou de renoncer aux soins.
Ce modèle se retrouve aussi dans le système éducatif, où les Libanais·es les plus aisé·es peuvent accéder aux meilleures écoles, tandis que les autres se voient contraints de s’endetter pour offrir à leurs enfants une éducation de qualité. Souvent, cet investissement se traduit par le départ des jeunes dans des pays capables de leur offrir davantage et où ils et elles pourront s’épanouir. Dans ce cercle vicieux entraînant une « fuite des cerveaux » et des déchirements familiaux, très peu de libanais·es expatrié·es choisissent de revenir habiter au Liban. Pour la jeunesse libanaise, quitter son pays et vivre en exil n’est pas souvent un choix délibéré, mais contraint.
C’est dans ce contexte et dans un pays où la corruption gangrène la bureaucratie comme l’économie (138e rang sur 180 États) selon Transparency International, que le ministre des Communications a proposé ce fameux jeudi 17 octobre 2019 de devenir le premier pays au monde à taxer la messagerie WhatsApp… La suite est magnifique.
«Kellon yaané kellon»
3 millions de libanais·es sont descendu·es dans la rue en scandant «Kellon yaané kellon !» (« Tout le monde, ça veut dire tout le monde ! ») pour dénoncer l’ensemble de la classe politique libanaise comme responsable de la situation du pays, ou encore «Thawra» (Révolution).
Pour la première fois de son histoire, toutes les communautés religieuses du Liban se sont rassemblées sous un seul et même drapeau : celui du Liban. Aucun groupe n’a épargné ses dirigeants, y compris la communauté chiite, pourtant réputée pour sa cohésion et dominée par le puissant Hezbollah, seule faction à maintenir une milice armée redoutable. Hassan Nasrallah s’est même opposé à la démission du gouvernement qui était acquis à sa cause.
Les jeunes et les moins jeunes envahissent alors les rues et convergent place des Martyrs, les universités sont fermées, les routes sont coupées. Tout un pays s’arrête et s’unit pour freiner d’urgence, éviter le gouffre et prendre une nouvelle direction. Là où il n’y avait plus que de la fatalité, l’espoir renaît et se lit de nouveau dans tous les yeux. Une chaîne humaine de plus de 170 km est formée du nord au sud.
Le street art joue un rôle essentiel dans la révolution au moment où le monde à les yeux tournés vers le Liban, faisant passer des messages d’espoir et des slogans assassins envers la classe politique corrompue. Les murs de Beyrouth et des agglomérations sont recouverts de graffitis et de slogans révolutionnaires, teintés d’un humour piquant propre à la culture libanaise.
Les femmes ont joué un rôle crucial dans la révolution libanaise, faisant face à une double injustice. En plus des problèmes touchant toute la population, elles subissent des lois discriminatoires : elles ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants, et les affaires matrimoniales, régies par le droit religieux, les désavantagent souvent. Les féminicides, qui ont fait au moins 37 victimes en deux ans, révèlent l’ampleur du problème. Sur le marché du travail aussi, elles continuent de subir des inégalités particulièrement fortes.

L’une des images fortes du soulèvement fut celle de Malak Alawiye Herz, qui a repoussé un garde armé d’un ministre en lui envoyant un coup de pied bien placé sur les organes génitaux, devenant ainsi une icône surnommée la «Marianne libanaise».
Les Libanaises ont également servi de médiatrices, formant des chaînes humaines pour calmer les tensions entre manifestants et forces de l’ordre. Elles ont organisé des discussions, distribué de la nourriture et apporté un soutien logistique et médical, jouant un rôle indispensable au cœur du soulèvement.
De la répression au désastre
Mais le gouvernement n’hésite pas à réprimer cette colère à coup de lacrymogène et de LBD, fournis par les maîtres dans le domaine du maintien de l’ordre : la France. Les militants du Hezbollah s’en mêlent aussi à coup de menaces et d’agressions à la barre de fer, afin de diviser le mouvement populaire et de dissuader les gens de descendre dans la rue.
Les manifestations se prolongeront jusqu’à janvier 2020 avant d’être brutalement interrompues par la pandémie de covid-19. Elles reprendront brièvement en juin de la même année, avant l’explosion du port de Beyrouth survenue le 4 août 2020, ce qui achèvera de mettre à genoux une population déjà étranglée par l’inflation et la crise économique sans précédent que subit le pays depuis 2019.
En l’espace de cinq ans, le Liban est passé de l’espoir retrouvé à une situation où sa survie est menacée par son voisin génocidaire. La monnaie a perdu plus de 99% de sa valeur et le taux de pauvreté absolue (moins de 1,90$/jour) dépasse les 50% de la population. La jeunesse rêve d’exil et aspire à un avenir meilleur, ou au moins à un emploi qui permet de subvenir aux besoins de la famille restée au pays…
L’effervescence culturelle et politique unique qui animait le pays du Cèdre, a laissé place aujourd’hui à l’incertitude, au désespoir et aux stratégies d’adaptation et de survie. Le pays n’a plus de président depuis deux ans et ses amis d’autrefois le laissent mourir aux yeux de tous face à la folie meurtrière et sans limites d’Israël, qui s’applique à détruire ce qu’il reste d’un pays au destin tragique.
AIDEZ CONTRE ATTAQUE
Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.

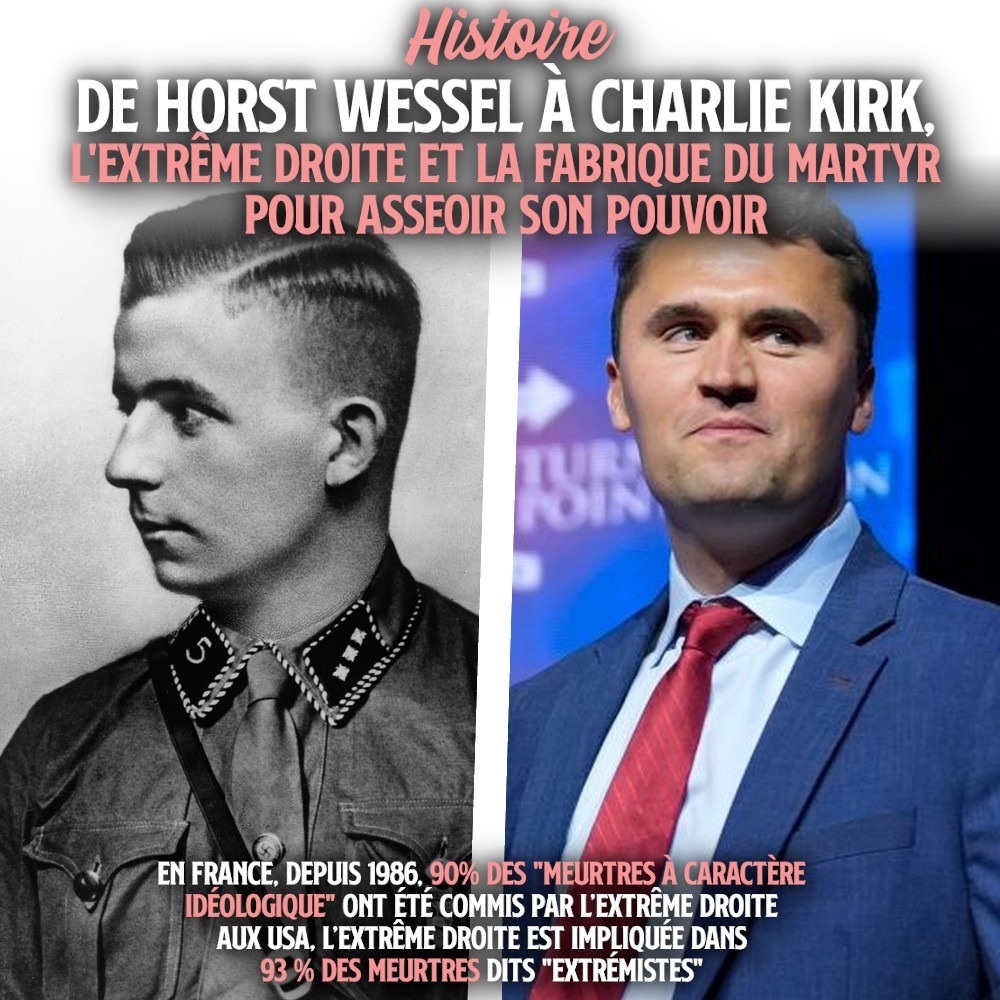


Une réflexion au sujet de « Histoire : il y a cinq ans, l’espoir de la jeunesse libanaise inondait les rues de Beyrouth »
En 1933 la bourgeoisie sortait Hitler du placard capitalo-coloniale et en 2023 la bourgeoisie a sortie (du même vestibule à idées ordurieres) un autre dégénéré d’extrême droite : Netanyahou