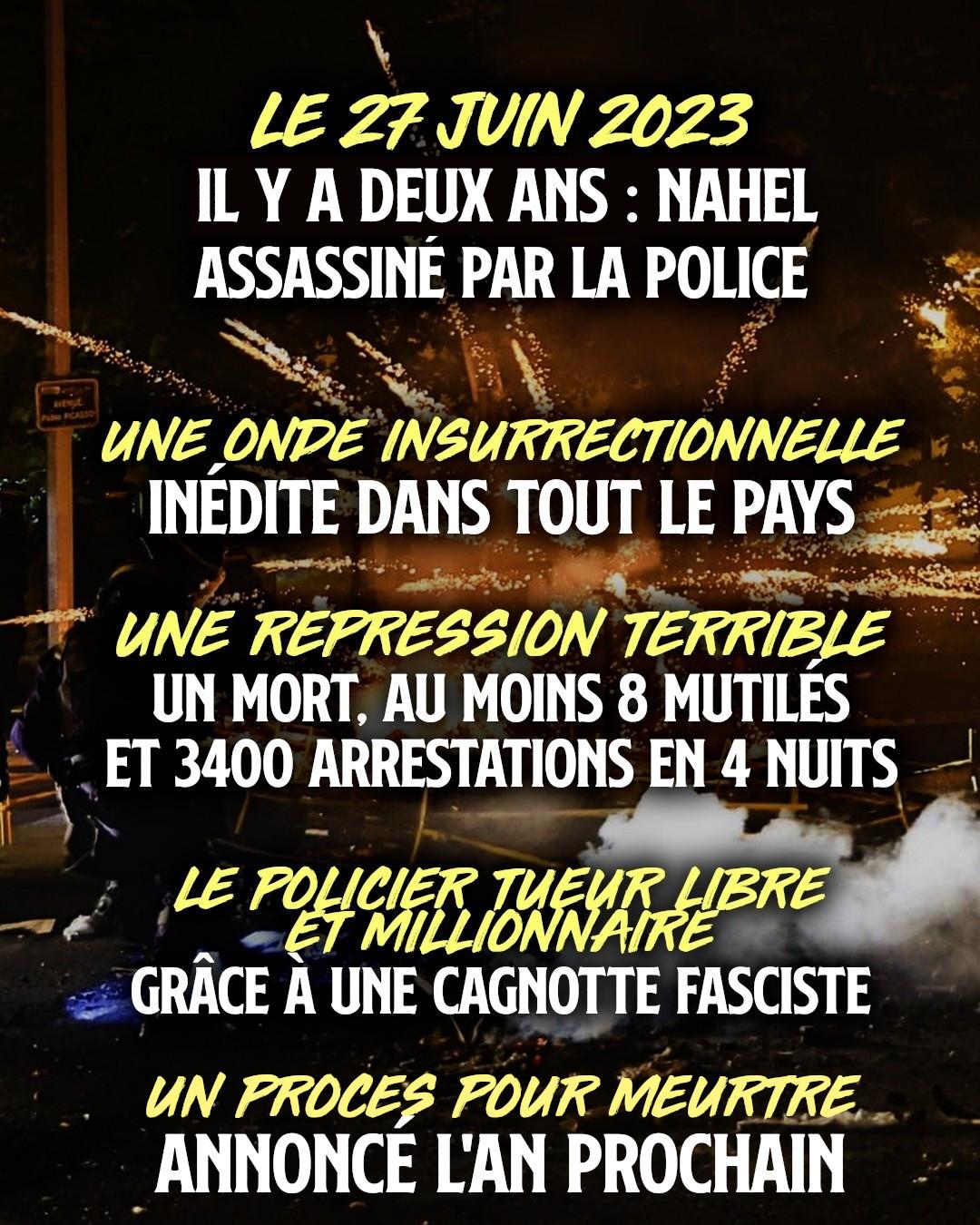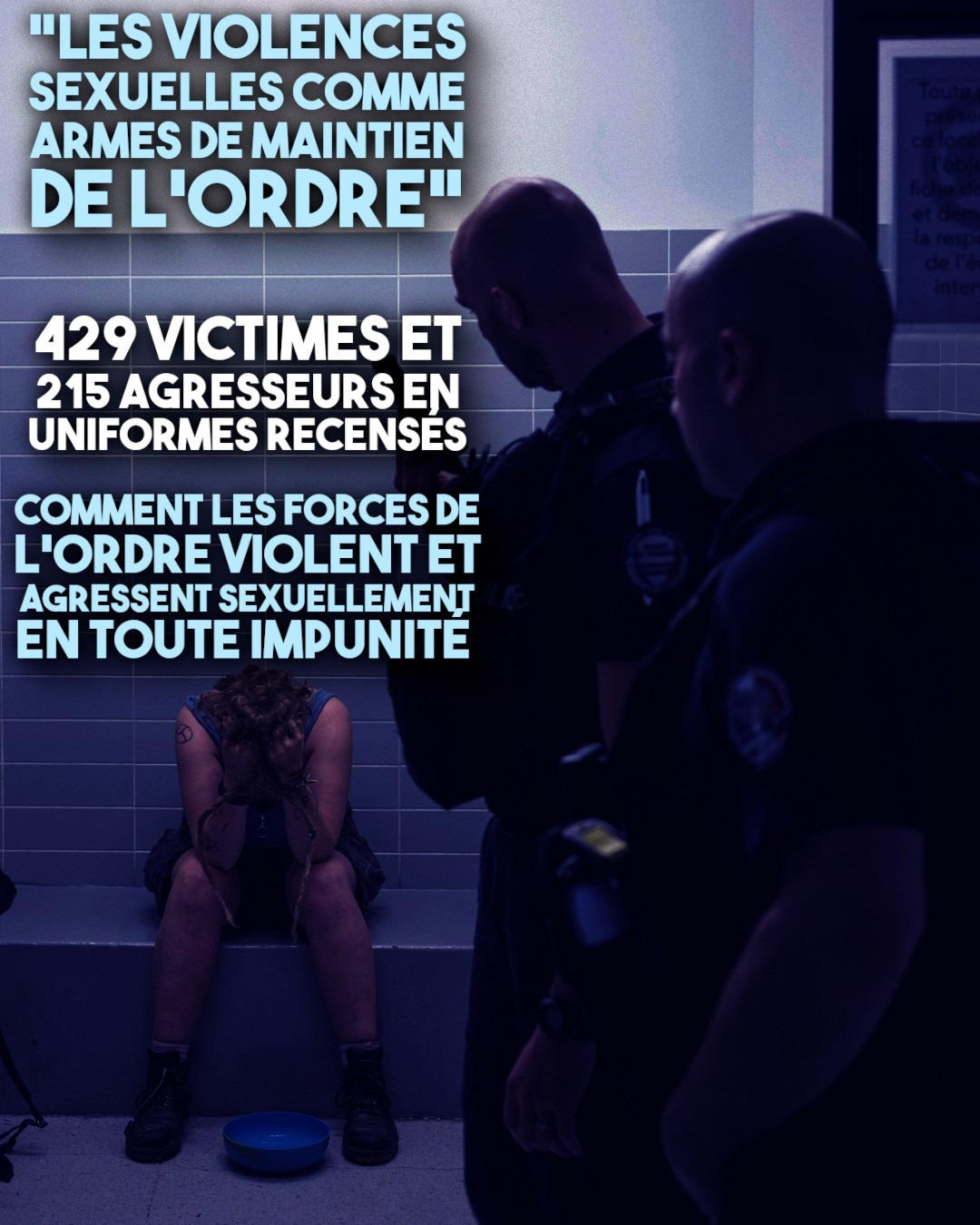«Une étude juridique est en cours pour encadrer de façon plus stricte la diffusion des vidéos»

« Pour faire disparaître un problème, faisons disparaître les preuves », c’est la logique du régime en place. Il y a quelques années, Macron faisait passer la loi sur « le secret des affaires », visant à sanctionner les lanceurs d’alerte au sein des entreprises, interdisant de fait de diffuser les preuves de délits financiers et patronaux.
Plus récemment, Macron supprimait « L’observatoire de la pauvreté », alors que celui ci pointait l’explosion des inégalités en France.
Aujourd’hui, alors que des violences policières sanguinaires, répétées chaque semaine, sont sur le devant de la scène, Médiapart révèle que le gouvernement veut faire disparaître les vidéos de violences.
Pas de preuve, pas de problème : gouvernement mafieux.
L’article de Médiapart :
« Castaner veut contrôler les vidéos de violences policières
Cédric Chouviat filmait des policiers. Cela les a insupportés. Il est mort quelques minutes plus tard. À la demande des syndicats, le ministère conduit une étude juridique pour restreindre les modalités de diffusion des vidéos.
Filmer des policiers peut déboucher sur un drame. La mort par asphyxie de Cédric Chouviat, à la suite de son interpellation, le 3 janvier, en est l’illustration la plus terrible. Les images de ce livreur de 42 ans plaqué violemment au sol par quatre policiers viennent rallonger la liste déjà longue des vidéos montrant des violences policières. Ces enregistrements, diffusés sur les réseaux sociaux puis relayés par les médias, débouchent parfois sur l’ouverture d’enquêtes judiciaires. Et rendent absurde le discours du gouvernement consistant à nier ces violences. Les forces de l’ordre, pour empêcher que soient montrées des violences, en viennent à violenter ceux qui les documentent : plusieurs vidéos que nous avons sélectionnées le démontrent. Dans leur sillage, le ministre Christophe Castaner envisage lui aussi de contrôler la diffusion des vidéos. Selon des informations recueillies par Mediapart auprès de la Direction générale de la police nationale (DGPN), une étude sur des « évolutions juridiques » est actuellement menée pour rendre notamment obligatoire le floutage de tous les agents. L’exemple de Cédric Chouviat est emblématique. En filmant son interpellation et sans en imaginer l’issue tragique, l’intention de Cédric Chouviat était bien celle d’enregistrer une preuve du comportement des policiers lors de ce contrôle. De fait, parmi les récents éléments versés à l’enquête, que Mediapart a pu consulter, une vidéo extraite du portable de la policière révèle des échanges tendus entre le livreur et les policiers, lesquels, n’appréciant pas d’être filmés, le bousculent à plusieurs reprises. « Il nous a dit : “Je vais vous filmer.” Il a sorti son portable et a commencé à nous filmer. […] Le contrôle a continué, toujours dans cette ambiance de provocation », a déclaré à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) la policière ayant participé au contrôle.
Auditionnée par la police des polices, une femme de 36 ans, témoin de l’interpellation, explique avoir été « surprise » par « le fait que [la policière] saisisse le téléphone », alors que Cédric Chouviat était au sol. « Je l’ai vue effectuer une manipulation d’environ trente secondes […] avant de le jeter au sol », précise-t-elle, sans comprendre pourquoi une telle « violence » était déployée pour ce qui lui semblait être une « histoire de téléphone ». « En voulant lui prendre son téléphone, ils lui ont ôté la vie. » Dans les premières heures suivant l’hospitalisation de Cédric Chouviat, l’avocat de la famille, Arié Alimi, a lancé un appel à témoin. « Face à la communication officielle souvent mensongère, c’est déterminant de le faire pour éviter la perdition, voire la dissimulation de preuves, précise-til. Récolter ainsi des témoignages est une pratique inspirée du mouvement américain d’initiative citoyenne Black Lives Matter, né pour dénoncer l’impunité policière à l’égard des Noirs américains (voir le papier sur les violences policières filmées aux Etats-Unis). Cédric Chouviat filmait parce qu’il estimait son contrôle injustifié. En réaction, les policiers ont eu des gestes de violence contre lui et l’ont violemment interpellé », conclut Arié Alimi. La police n’apprécie pas d’être filmée. Pourtant, la loi autorise tout citoyen à le faire dans l’espace public et à diffuser également ces enregistrements, dans un but strictement informatif, sans diffamation ou injure. Dans certains cas, lorsqu’il y a un risque d’atteinte à la dignité de la personne, au secret de l’enquête ou encore si les policiers filmés appartiennent à des services spécifiques comme l’antiterrorisme ou la lutte contre le grand banditisme (listes des services concernés dans l’arrêté du 27 juin 2008), il est obligatoire de flouter le visage des policiers ou celui des personnes interpellées.
Le 23 décembre 2008, le ministère de l’intérieur met ainsi en garde l’ensemble des policiers, dans une circulaire qui sert encore de référence : « La liberté d’information, qu’elle soit le fait de la presse ou d’un simple particulier, prime. Les policiers ne peuvent s’opposer à l’enregistrement de leur image lorsqu’ils effectuent une mission. Il est exclu d’interpeller pour cette raison la personne effectuant l’enregistrement, de lui retirer son matériel ou de détruire l’enregistrement ou son support. » Circulaire du ministère de l’intérieur sur le droit de filmer les policiers, 23 décembre 2008. Loin de rappeler aux policiers leur obligation de respecter le droit de filmer, certains syndicats, dont Alliance, contestent vigoureusement la réalité que montrent les vidéos, dès lors qu’elles mettent en cause l’un des leurs. Dans un courrier du 5 novembre 2018 adressé au ministre de l’intérieur Christophe Castaner, le syndicat de police Alliance demande qu’il soit interdit de filmer les policiers, « très préoccupés par l’existence d’abus du droit de capter leur image lorsqu’ils se trouvent sur la voie publique ou dans un espace public dans l’exercice de leurs fonctions ». Selon le syndicat, « au-delà de la question du droit à l’image des policiers, l’enjeu est leur sécurité », la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux les exposant à « être reconnus et à être, eux-mêmes ou leur famille, victimes de représailles ». Non seulement cette interdiction, qui passe par « une modification législative de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et d’expression », doit concerner les « policiers en intervention », mais aussi, « et par extension, les forces de l’ordre ».
Contacté par Mediapart, Stanislas Gaudon, secrétaire général adjoint du syndicat, détaille : « Christophe Castaner nous a répondu en février 2019. Le ministre émet des réserves sur la possibilité de revoir le droit de filmer mais il nous a affirmé qu’une étude juridique était en cours pour encadrer de façon plus stricte la diffusion des vidéos. Il serait question de rendre obligatoire l’anonymisation des policiers lors de la diffusion des vidéos, en les floutant par exemple. » Interrogé sur les violences policières, le syndicaliste estime que ces films ne montrent « qu’une partie des interventions et ne permettent pas d’avoir une vision globale du contexte ».
Le secrétaire général du syndicat Unsa Police, Philippe Capon, a un avis bien différent et l’a fait connaître, le 8 janvier 2020, lors des vœux en présence du ministre de l’intérieur, du secrétaire d’État et du préfet de police de Paris. « La France est touchée depuis l’automne 2018 par les manifestations des gilets jaunes […], conséquence d’un dialogue social déficient avec les corps intermédiaires, ce qui a abouti à gérer une crise majeure par le maintien de l’ordre […], mais n’est pas spécialiste du maintien de l’ordre qui veut. […] Trop de membres des forces de l’ordre ont été blessés, mais trop de manifestants aussi », a-t-il déclaré. « L’État dans cette gestion porte des responsabilités, a-t-il ajouté. Je pense au manque de formation des policiers, à l’utilisation parfois hasardeuse du LBD. »
Contacté par Mediapart, Philippe Capon part du principe qu’il « est utopique de penser qu’il serait possible d’interdire de filmer » mais souhaite que « les visages des policiers soient floutés lorsque les vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux ou dans les médias ».
« En filmant l’action de la police, les citoyens sont devenus le principal agent de transparence »
La première affaire de violences policières révélée par une vidéo est celle de l’interpellation d’Abdoulaye Fofana, 20 ans, habitant la cité des Bosquets à Montfermeil (Seine-Saint-Denis). Dans la nuit du 14 octobre 2008, à la suite d’un jet de pavé et d’un tir de mortier de feu d’artifice sur une voiture de police, les forces de l’ordre interviennent dans l’immeuble de cet étudiant, l’accusant à tort d’avoir participé à ces violences. Menotté, il reçoit plusieurs coups de matraque et un coup de crosse de pistolet, scène enregistrée par un voisin, le réalisateur Ladj Ly, auteur depuis du film Les Misérables, inspiré notamment de cet événement. Dans leurs procès-verbaux, les policiers avaient omis de signaler les coups portés à Abdoulaye Fofana, poursuivi pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Relayée par le site d’information Rue89, cette vidéo inverse les poursuites et déclenche l’ouverture par le parquet de Bobigny d’une enquête préliminaire confiée à l’IGS (Inspection générale des services) pour « violences par personnes dépositaires de l’autorité publique ». Huit ans plus tard, les deux policiers sont condamnés en appel à quatre mois de prison avec sursis et 3 600 euros de dommages et intérêts. « En 2009, certains membres de l’IGPN comprennent qu’il y a quelque chose qui est en train de changer avec les vidéos, sans envisager pour autant la révolution que ça allait représenter. À l’époque, c’est surtout une question de violences dans les banlieues, de violences cachées », explique le sociologue Sebastian Roché, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des rapports entre la police et la population. L’évolution technologique des téléphones et la multiplication des réseaux sociaux marquent un tournant dans la diffusion des vidéos des violences policières, en particulier lors de mouvements sociaux comme les manifestations contre la loi Travail, en 2016 (nous avions alors sélectionné 21 de ces vidéos).
« Les mobilisations de 2016 puis celles des gilets jaunes, avec l’unité de temps, de lieu et le nombre de manifestants, donc de témoins potentiels, marquent une véritable révolution », poursuit le sociologue, qui définit ce phénomène comme « une contribution majeure au contrôle de la police, d’autant plus lorsque les systèmes institutionnels qui en ont la charge sont insuffisants. En filmant ainsi l’action de la police, les citoyens sont devenus le principal agent de transparence, un acteur aussi important que le Défenseur des droits ou que le contrôle parlementaire ». Sebastian Roché rappelle par ailleurs la faiblesse des commissions parlementaires pour contrôler la police, qui se cantonnent trop souvent à « l’audition de syndicats de police qui font part de leur manque de moyens ». Le sociologue met néanmoins en garde : « Filmer la police est pour l’instant protégé par la loi. Mais comme toute liberté, elle est fragile et il y a toujours une possibilité de la rogner, d’autant que les velléités pour le faire sont nombreuses, en premier lieu du côté des syndicats de police. »
Selon Sebastian Roché, la volonté des policiers de masquer leur identité, en ne portant pas leur RIO (numéro d’identification) ou en dissimulant leur visage, est une pratique qui n’est pas seulement liée aux enregistrements dont ils sont la cible, mais s’inscrit dans une dynamique antérieure : « Tout cela renvoie au même modèle, celui d’une police qui veut travailler à l’écart de la société, alors que les policiers anglais portent leur nom sur leur uniforme. En France, ils ne sont toujours pas dans le modèle de la police démocratique du XXIe siècle, celle qui va rechercher la confiance. Or comment peut-on faire confiance à un homme masqué qui porte un LBD ? » Mais pour autant, même filmés, les policiers n’ont pas changé leur comportement. « Ce n’est pas un corps qui est préparé à réfléchir sur lui-même. Nombre de syndicats de police se plaignent qu’on questionne la police. L’idée d’avoir à se justifier, c’est une idée avec laquelle ils ne sont pas familiers et on le voit largement dans la police française », conclut le directeur de recherche au CNRS. L’absence de transparence de la police nationale a rapidement amené des collectifs (Urgence notre police assassine, Stop violences policières, Désarmons-les !) à inviter tout un chacun à filmer les violences policières pour les dénoncer et soutenir les victimes. « Surveillons ceux qui nous répriment. Servons-nous de caméras vidéo, d’appareils photo pour nous protéger des violences policières » : le site Copwatch, sur le modèle du mouvement citoyen américain né dans les années 1990, a été l’un des premiers à dénoncer publiquement les abus des forces de l’ordre. Les photos des fonctionnaires y défilent mais très vite, après une plainte du ministre de l’intérieur Claude Guéant pour « injures et diffamations envers des fonctionnaires de police », le site Copwatch Nord-Île-de-France est interdit par la justice le 4 octobre 2011.
D’autres initiatives prennent la suite en prenant garde de ne pas tomber dans la diffamation ou l’appel à la haine. C’est le cas du collectif Désarmons-les !, créé en 2012 pour informer sur les dangers des armes du type lanceur de balles de défense, grenade de désencerclement ou GLI-F4, et qui, depuis 2014, soutient également les victimes de violences policières, notamment dans leurs démarches juridiques. « L’usage de la vidéo au sein de notre collectif était initialement controversé, précise l’un de ses fondateurs, Ian. Parce que dans des mobilisations, il peut y avoir des actes de révolte légitimes de la part de manifestants et donc les filmer peut aussi leur porter préjudice. Mais la vidéo est devenue incontournable. » En cela, Ian soutient le copwatching : « Notre position est de se réapproprier les moyens d’enquête et, de ce point de vue, filmer la police permet d’en dénoncer les violences et d’en avoir les preuves. Mais ensuite, les vidéos ne suffisent pas toujours à faire condamner les policiers, qui se cachent derrière la légitime défense. Et lorsque des peines sont prononcées, elles restent légères. Il s’agit souvent de sursis sans inscription au casier. Ce qui est aussi très significatif de l’impunité dont ils peuvent jouir et de la proximité des magistrats et des policiers. » Les vidéos permettent parfois d’identifier le policier auteur de violences et, dans certaines affaires, elles ont joué un rôle prépondérant. Hervé Gerbi, avocat grenoblois spécialisé dans l’aide aux victimes, intervenant sur les violences policières, rappelle que « selon le code de procédure pénal, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. La preuve est libre et les vidéos en sont donc naturellement ». Mais « l’usage de la vidéo pose la question de la loyauté dans la preuve : les vidéos restent en effet sujettes à interprétation et il faut donc essayer d’avoir l’avant et l’après pour recontextualiser l’événement litigieux et démontrer que le contexte ne justifiait pas l’emploi de la force ou qu’elle était disproportionnée », nuance l’avocat.
« Dans mon malheur, j’ai eu de la chance », explique Laurent Théron, syndicaliste de SUD Santé, éborgné par un éclat de grenade à main de désencerclement (GMD), le 15 septembre 2016, alors qu’il manifestait contre la loi Travail. « Sans les vidéos, je ne sais pas si l’enquête aurait pu aboutir. D’autant qu’au début, lorsque l’IGPN est venue me voir à l’hôpital, ils ont émis l’hypothèse que j’avais pu être éborgné par une grenade artisanale lancée par des manifestants », affirme Laurent Théron, qui n’a pu reprendre son poste de secrétaire médical qu’en septembre 2019. Son avocat, Me Julien Pignon, précise que deux vidéos de témoins, champ et contre-champ, ont permis d’identifier le CRS et la grenade utilisée. « Les images ont démontré que le contexte ne justifiait pas l’emploi de cette arme, explique Julien Pignon. Et le lancer n’était pas conforme, puisque le CRS la lance par-dessus l’épaule et non au sol. C’est tout à fait exceptionnel et les vidéos ont permis à une enquête impartiale d’être menée. » Le 20 mai 2019, près de trois ans après les faits et à l’issue de l’instruction, le CRS a été renvoyé aux assises pour « violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente par personne dépositaire de l’autorité publique ». Son avocat Laurent Franck-Lienard a fait appel de cette décision.
Encouragés par les récentes directives qui prescrivent un dispositif plus musclé envers les manifestants et conscients des risques d’être filmés, les policiers usent de tous les stratagèmes pour se trouver hors champ des objectifs, quels qu’ils soient. Souvent violemment, ils interdisent aux manifestants de filmer et tentent de détruire parfois leurs téléphones, faits passibles de poursuites disciplinaires (selon le code de déontologie de la police et gendarmerie nationale) et judiciaires (relevant notamment de la dégradation ou destruction d’un bien d’autrui).
« Les policiers n’ont manifestement pas connaissance du droit ou n’ont pas compris ou intégré la règle de la liberté des citoyens de les filmer, estime l’avocat Slim Ben Achour, qui se bat notamment contre les contrôles au faciès. Ce déni du droit leur permet de légitimer leur travail et de les protéger dans leurs mauvaises actions, voire leurs comportements illégaux. »
« Que ce soit dans les banlieues ou dans les manifestations, le constat est le même : non seulement la formation des policiers pose problème mais également la culture de l’impunité. Et les vidéos ont un rôle essentiel pour lutter contre cette culture », constate Slim Ben Achour. « Mais collecter autant de preuves et de témoignages est hélas difficile, voire impossible dans les quartiers populaires, où les interpellations peuvent tout aussi mal se passer que lors des manifestations, mais à l’abri des regards. D’ailleurs, concernant les violences policières que je traite, essentiellement dans des quartiers populaires ou en dehors des manifestations, je n’ai quasiment jamais les vidéos permettant d’apporter la preuve des abus des policiers », poursuit-il, rappelant le travail décisif du journaliste David Dufresne lors des mouvements des gilets jaunes (à lire ici). David Dufresne explique : « Ma référence est l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme, selon lequel “la garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous”. Il y a donc la nécessité de la publicisation, poursuit-il. C’est la caméra qui a rendu possible l’observation des pratiques policières. Et si on veut une force publique, il faut qu’elle soit sous le regard de celui qu’elle sert : le public. » Filmer, « c’est une garantie pour les citoyens mais aussi pour les policiers », soutenait le ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve, le 8 mai 2016, avant de légaliser, un mois plus tard, le recours à des caméras-piétons, sanglées sur l’uniforme des agents et visant à minimiser les tensions lors des interpellations, mais aussi à retracer le comportement de chacun.
Leur usage a depuis été étendu aux opérations de maintien de l’ordre, notamment pour retracer et recontextualiser les tirs de lanceur de balles de défense (LBD). « Le problème est que ces caméras fonctionnent mal, voire pas, et ne sont pas adaptées aux manifestations », commente le secrétaire général du syndicat Unsa Police. C’est ce qu’a d’ailleurs rappelé son syndicat à Christophe Castaner, dans un courrier daté du 23 octobre 2019 (évoqué par Le Canard enchaîné du 22 janvier). Il y alerte ainsi le ministre : les caméras mises à disposition de la police nationale sont « inadaptées », notamment en termes de « fixations », trop fragiles, et de faible « autonomie » (leur batterie permettant deux heures d’enregistrement, alors que des modèles existent avec une autonomie de plus de dix heures). Le syndicat regrette au passage le choix du « fabricant “made in China” ». « Le constat est affligeant […], la police nationale est lamentablement en retard », conclut-il. Réponse de la Direction générale de la police nationale (DGPN) le 30 décembre 2019 : « Le nouveau marché des caméras-piétons a été notifié en avril 2018 à la société Allwan pour un produit de la société chinoise HiK Vision. Si ce produit n’a pas obtenu la meilleure note technique lors de son analyse des offres […], cette société a remporté le marché public en proposant un meilleur prix. » Confirmant les dysfonctionnements, le directeur général de la police apporte surtout un éclairage jusqu’à présent démenti par la communication officielle du ministère concernant son intention de doter les porteurs de LBD de caméras : « Si le port de l’arme individuelle était systématiquement associé au port de la caméra, le nombre de 10 400 caméras en dotation dans la police nationale serait insuffisant pour équiper tous les policiers. De plus, l’instruction relative à l’emploi des caméras ne liste par les cas d’utilisation de la caméra, afin de laisser aux policiers de terrain une certaine autonomie d’appréciation concernant son utilisation. »
En somme, les porteurs de LBD peuvent choisir à leur guise de porter une caméra ou pas. Contactée par Mediapart, la Direction générale de la police nationale affirme qu’une « expérimentation sur deux modèles de caméra » doit être conduite, sans apporter plus de précisions sur le calendrier. Certains syndicats de police comme Alliance risquent de grincer des dents à cette annonce. Le secrétaire général adjoint d’Alliance, Stanislas Gaudon, ne souhaite ni que les policiers soient filmés ni qu’ils soient munis de caméras sur leurs LBD. « Il y a beaucoup d’exagération avec les LBD. Si l’on considère le nombre de tirs durant les mouvements des gilets jaunes et le nombre de blessés, il y a de quoi relativiser », estime-t-il, avant d’ajouter que « plutôt que de fixer des caméras sur les LBD, il serait préférable d’investir dans des protections pour les policiers ou dans leur armement ». »
AIDEZ CONTRE ATTAQUE
Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.