Un lecteur assidu, qui avait déjà poussé son coup de gueule sur le langage du pouvoir, nous fait parvenir ses réflexions sur le contrôle social par l’imaginaire policier

L’envers des histoires
Quand j’étais petit, j’aimais beaucoup Batman. Lorsque j’aperçois dans la rue un policier, je me demande parfois : avons-nous au moins cela en commun ? Sous l’armure, le casque, la mine renfrognée, y a-t-il quelque part un enfant qui regardait les mêmes dessins animés que moi ? Ceux-ci ont-ils influencé, d’une manière ou d’une autre, son choix de carrière ? Je l’imagine, levant fièrement son petit poing devant une télé cathodique, jurant qu’il consacrera sa vie à la protection de ses concitoyens. L’image me fait sourire. Comment se sent-il désormais, croisant le miroir de sa salle de bains après une journée de manifestation, la matraque rougie du sang de celles et ceux qu’il avait promis de défendre ? Lui qui voulait pourchasser des criminels, le voilà réduit à commettre le plus pathétique des larcins : le vol de casserole. Je me demande si l’ironie de tout cela l’effleure. Probablement pas. Pour réduire la dissonance cognitive, le cerveau rationalise sans cesse ; il se raconte des histoires.
Les histoires, justement, sont l’objet de cet article. Leur fonction première n’est pas d’amuser les enfants, comme on l’imagine parfois, mais de transmettre des expériences. Les fables de La Fontaine et les contes de Charles Perrault contiennent une morale, véhiculent des leçons : ne suis pas les inconnus chez eux, ne t’aventure pas seul en forêt, arrête d’échanger toutes nos vaches contre des haricots. La fiction est un outil social puissant, qui instruit en divertissant. Si la droite dure monte au créneau dès que Disney introduit un personnage homosexuel, c’est qu’elle craint que la jeunesse ne soit pervertie. Or, à ses yeux, on devrait plutôt utiliser le médium pour inculquer des valeurs conservatrices à nos têtes blondes. Si Bolloré s’est construit un empire médiatique ce n’est pas pour une autre raison.
Même devenu adulte, chaque fois que j’ouvre un livre ou vais au cinéma, je suis destinataire d’un message, d’une certaine vision du monde. L’influence subtile de la culture n’a pas échappé aux états : Hollywood constitue l’un des vecteurs majeurs du soft power américain depuis la guerre froide. Film après film, on voit de valeureux soldats étasuniens déjouer coups d’État et attentats terroristes au péril de leur vie. Peu à peu, l’image infuse, et on soupçonne moins la CIA d’être responsable de la dernière tentative de déstabilisation en Amérique latine (le cas échéant, on lui prêtera au moins de bonnes intentions). Sous nos latitudes, le matraquage du bourgeois gaze nous conduit insidieusement à épouser leur perception du monde.
Le rôle pas si anodin des histoires étant établi, il reste à constater que notre société entière est fondée sur des mythes. Selon notre lieu de naissance, on intègre le «Pays des Droits de l’Homme» ou le «Rêve américain» sans que l’un ou l’autre ne corresponde à une quelconque réalité. Jadis, notre roi héritait de son titre et de sa richesse non en tant que fils de son père, mais en tant que fils de Dieu. Les rois du Maroc et de la Jordanie, plus humbles, descendent seulement du prophète. Des mythes si puissants qu’ils justifient l’ordre social. Une nation, apprend-on au collège, désigne un peuple qui possède (entre autres) une unité culturelle et historique — autrement dit, des gens unis par les histoires mêmes qu’ils ont choisi de se raconter.
Résumons : les mythes sont constitutifs de l’organisation humaine, tout en exerçant un pouvoir invisible sur nous. Penser librement implique donc d’identifier puis questionner leurs enseignements, et le cas échéant de s’en défaire. Au moins les grecs anciens avaient-ils l’intelligence de formaliser les mythes et de leur attribuer explicitement cette fonction particulière comme l’explique Paul Veyne.
Bruce Wayne, plus mec classe qui lutte que lutte des classes
Revenons-en à Batman. Depuis sa création en 1939, le personnage a connu de multiples déclinaisons, refontes, univers parallèles — mais un trait revient toujours : il s’agit de ses incroyables talents d’investigation, qui lui valent le surnom de «plus grand détective du monde». Si ce personnage a connu une telle longévité, c’est qu’il constitue le meilleur représentant d’un mythe bien particulier : celui de l’enquêteur. Quel que soit le crime commis, il n’est de coupable que Batman ne puisse retrouver, d’injustice qu’il ne puisse réparer. La noirceur particulière de son univers rend le triomphe plus éclatant : même si les institutions de Gotham City sont défaillantes, même si sa police est incompétente, voire corrompue, le mal finit toujours par être puni. On meurt d’envie d’y croire. Batman véhicule l’idée d’une justice omnipotente, infaillible. D’une manière ou d’une autre, si vous faites un pas de travers, quelqu’un vous retrouvera : la police, un type en collant, le jeune garçon avec lequel il entretient une amitié suspecte, un méchant encore pire que vous, peu importe. Vous ne l’emporterez pas au paradis.
Le mythe a été critiqué bien sûr. Dans le magazine de la lutte des classes, on soulignera cette vision curieusement néolibérale dans laquelle un multimilliardaire s’érige en saint protecteur des classes laborieuses — palliant de l’autre main la gestion catastrophique des finances publiques locales à travers ses œuvres philanthropiques. Comment ? La richesse crasse serait un superpouvoir !? Le récit en propose un autre : le mépris de l’état de droit. Souvent en filigrane, parfois explicitement, Batman suggère que les forces de l’ordre ne peuvent pas mener leur tâche à bien s’ils restent dans le cadre de la loi. Les mandats de perquisition arrivent toujours trop tard, le juge des libertés et de la détention fait du zèle, et à la fin un avocat véreux fait annuler toute la procédure pour vice de forme, c’est épuisant tout de même. Si les méchants ne respectent pas les règles du jeu, il n’y a pas de raison que les gentils y soient tenus. À l’aune de cet éthos très autoritariste, je repense à mon policier de l’introduction et me corrige : oui, les soirs de manif, il croise son miroir et sourit, hoche la tête avec approbation. Il est le héros que la France mérite. Quand le JT rediffuse les images choquantes de ses exploits, son cœur se gorge de fierté, car il a eu le courage d’outrepasser ses prérogatives pour endiguer le mal qui nous menaçait tous. L’opprobre ingrat qu’on lui jette, il le porte comme un badge d’honneur qui scelle son sacrifice. Le policier attend le prochain Batman avec impatience, parce que Batman parle de lui. C’est moi qui n’avais rien compris.

Pourquoi tout le monde aimait la police
On pourra me reprocher, à ce stade, de me focaliser sur un personnage certes populaire, mais parfaitement anecdotique au regard de l’étendue du paysage culturel. Certes. Oublions donc Batman : ce qui compte, c’est l’archétype qu’il incarne. Sherlock Holmes, Sam Spade, Hercule Poirot ou Détective Conan ne sont que les différentes faces de ce même dé. Donnez un masque de chauve-souris à Jack Bauer et personne ne s’apercevra de la supercherie. Les programmes télé sont complètement noyés sous les séries procédurales bâties autour de ce mythe : Luther, The Mentalist, Bones, Castle, Lie to Me, White Collar, Elementary, Criminal Minds. Il y en a un peu plus, madame, je vous le mets quand même ? NCIS : Enquêtes Spéciales ou Les Experts et leurs innombrables spin-offs, The Blacklist, Dexter, Numb3rs, Veronica Mars, True Detective, Les Enquêtes de Murdoch. Puis-je vous proposer un produit local ? Section de Recherches, Candice Renoir, Julie Lescaut, Profilage, Commissaire Moulin, PJ ou, en cours de diffusion, le consternant HPI1 sur TF1.
Le décor change, le degré d’ambiguïté morale aussi, et pourtant c’est toujours la même histoire qu’on raconte : la police fait de son mieux, et si jamais un dossier s’avérait trop difficile pour elle, quelqu’un prendra le relais pour faire éclater la vérité — unité spéciale, franc-tireur excentrique mais génial, détective privé, avocat, asperger doué de mémoire eidétique, petit neveu de la boulangère qui a reçu une loupe avec le dernier numéro de Picsou Magazine, peu importe. Épisode après épisode, les coupables seront rattrapés.
Quand les protagonistes appartiennent aux forces de police, ils sont traités avec la plus grande bienveillance. Le (ou la) flic de série est à l’écoute, opiniâtre, dévoué, infatigable. Le cliché, épuisé jusqu’à la moelle, veut qu’il n’ait que deux nœuds narratifs à délier : être tellement investi dans sa mission qu’il devient un mauvais parent et un pire conjoint, et porter la culpabilité de ne pas avoir su élucider une vieille affaire, laquelle trouvera sa conclusion en fin de saison 3. On croirait un entretien d’embauche où le candidat, à une question affligeante de banalité, répondrait que le perfectionnisme est son seul défaut. L’actualité rend parfois le thème des violences policières incontournable. Alors le cop show se résout, la mort dans l’âme, à mettre en scène des égarements individuels aussitôt sanctionnés. Les regards outrés de tout le commissariat restaurent la virginité morale du corps policier, comme on placarderait un bandeau #NotAllCops sous un live BFMTV.
Même lorsque la dramaturgie impose que les relations entre le personnage principal et la police soient conflictuelles (il faut bien que Lestrade soit antipathique pour qu’on savoure davantage la victoire de Sherlock), l’institution en elle-même n’est jamais mise en cause. Elle est en sous-effectif, manque de matériel, a une approche trop scolaire, étouffe sous la bureaucratie ou abrite quelques mauvais éléments imbéciles ou malfaisants. Mais où sont les épisodes sur le racisme systémique ? Sur le lien entre surarmement et interventions qui dégénèrent ? Le recrutement à 7/20, le maquillage des chiffres de la délinquance, la répression brutale des mouvements sociaux, les lieux de détention à l’insalubrité abjecte, la surveillance de militants écologistes mâtinée de procès-verbaux frelatés ?

Il faut se rendre à l’évidence : nous sommes bombardé-es de produits culturels fondamentalement pro-police. Comme souvent, la mise en place de cette propagande relève moins de la conspiration que du phénomène structurel. Le monde de la culture appartient à des milliardaires conservateurs, vit de subventions publiques dont le processus de distribution peut inciter à l’autocensure. Les réalités matérielles d’un tournage rajoutent un niveau de complexité : besoin de figurants en képi, de voitures avec gyrophare, d’un consultant issu des forces de l’ordre ? La police peut vous prêter tout cela, mais avant elle demandera à lire le script. In fine, sans que le message ait besoin d’être coordonné, il opère. Les primomanifestant-es enfilant un gilet jaune eurent affaire à la police pour la première fois de leur vie et l’écart avec l’imaginaire qu’on leur avait construit les sidéra. Au contact de la réalité, la fiction implosait soudain.
1 Tiré du synopsis officiel de la série : «Morgane, 38 ans, 3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 160 de QI et une bonne dose d’insoumission, va voir son destin de femme de ménage chamboulé lorsque ses capacités hors norme sont repérées par la police qui lui propose un poste de consultante». Être femme de ménage n’est donc pas une situation sociale mais un «destin». Une fulgurance qui frôle elle aussi les 160 de QI.
Thug life
Mais le mythe de l’enquêteur produit des effets qui dépassent la simple image de la police. Pour les illustrer, voici une anecdote relatée par un individu qui enfreignait la loi pour la première fois. Il est question d’une dégradation de mobilier urbain — si vous voulez tout savoir, un radar automobile dont on me pria de croire qu’il l’avait bien mérité, à une époque où les neutraliser relevait du sport national. Cette personne prend la voiture en pleine nuit, rejoint la route de campagne où trône la machine infernale, se gare. Une quinzaine de minutes plus tard, son méfait est accompli — le monstre de métal a rendu son dernier PV. Le perpétrateur s’immobilise. Sa conscience coupable devrait le pousser à quitter les lieux au plus vite, pourtant il n’en est rien. Au bord de la route, la forêt plongée dans l’obscurité dort paisiblement. Le vrombissement lointain d’un moteur retentit puis s’éteint. Une brume translucide glisse sur le bitume à pas de velours. Il regarde tout autour. Pas de sirènes.
L’évidence de la situation le foudroie : personne ne le retrouvera jamais. Comment pourrait-il en être autrement ? Le premier commissariat doit se trouver à des dizaines de kilomètres, personne ne l’a vu, le téléphone qui aurait permis de le géolocaliser est resté chez lui. Il croyait éprouver un sentiment de justice accomplie, c’est une sensation de liberté qui l’envahit. Pourquoi s’étonne-t-il de cette impunité déjà acquise ? Il découvre sa croyance limitante à l’instant même où elle se désagrège.
Contrairement à ce que laissent penser les séries, dont la formule impose qu’une affaire soit bouclée à la fin de chaque épisode, les taux d’élucidation de la police n’ont rien de mirobolant : sur la période 2017-2021, ils ne dépassent pas les 8% pour certaines catégories d’atteintes aux biens (vols sans violence, cambriolages, etc.) et se détériorent globalement. L’aura de la police empêche sans doute plus d’infractions que la police elle-même. C’est l’auto-contrôle qui nous empêche réellement de faire déborder la marmite. « La meilleure des polices, c’est tout ce qui te fait marcher droit avec ton propre consentement » chantait La Rumeur.
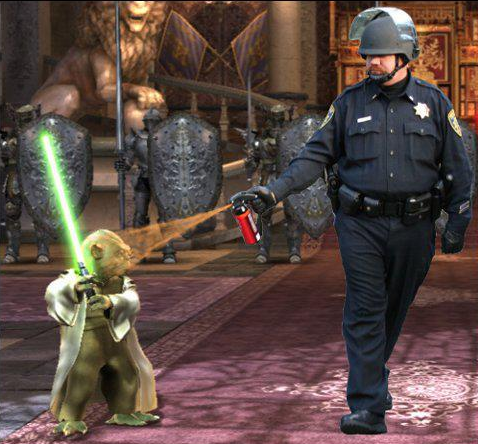
Désobéissance
Notre capacité de rébellion est prise en étau. D’un côté, le mythe de l’enquêteur instille la peur d’une répression toute puissante. De l’autre, celui des superhéros (32 films Marvel en 15 ans !) nous apprend que les problèmes de ce monde ne peuvent être solutionnés que par des êtres d’exception — mutants, extra-terrestres, victimes d’expériences scientifiques. Surtout pas par nous. La pop culture, si divertissante qu’elle soit, nourrit notre sentiment d’impuissance, nous démobilise. L’objectif n’est pas d’appeler au boycott, seulement de révéler ses effets. Les messages qu’elle porte ne peuvent opérer que dans notre inconscient, ils ne résistent pas à l’examen des faits. Aussitôt exposés au grand jour, ils sont neutralisés.
L’autodéfense intellectuelle s’acquiert, s’entraîne. Dans son Petit éloge de l’anarchisme, James C. Scott suggérait des travaux pratiques, sans lesquels le cerveau s’abandonne à la paresse de l’obéissance : «Chaque jour, si possible, enfreignez une loi ou un règlement mineur qui n’a aucun sens, ne serait-ce qu’en traversant la rue hors du passage piéton. Servez-vous de votre tête pour juger si une loi est juste ou raisonnable». Nous sommes bien plus fort-es que nous le croyons.
La police n’est pas totalement incapable : lorsqu’elle dicte les termes de la confrontation, qu’elle s’arroge comme à Sainte-Soline l’avantage du terrain et de l’armement, elle peut déployer une force brute à laquelle nul ne peut résister. Pourtant, que ferait-elle si demain, après-demain, une nuit prise au hasard parmi les six prochains mois, deux ou trois militant-es décidaient de revenir saboter les mégabassines ? Rien. Strictement rien. Gageons que si cela se produisait, de honte, elle se garderait bien de le signaler. La répression ne peut prospérer que parce que nous acceptons ses règles, auxquelles seules des fables viennent prêter de la force.
Mais le château de cartes s’effondre
AIDEZ CONTRE ATTAQUE
Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.

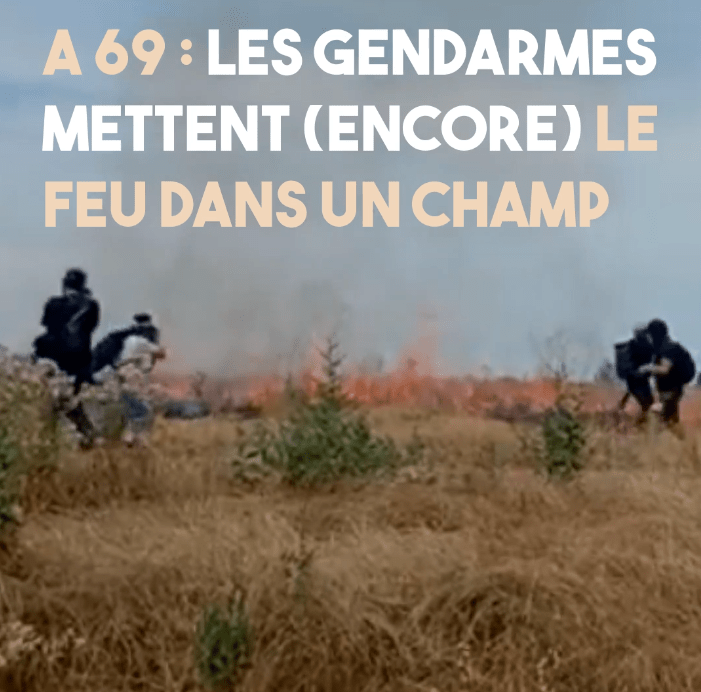
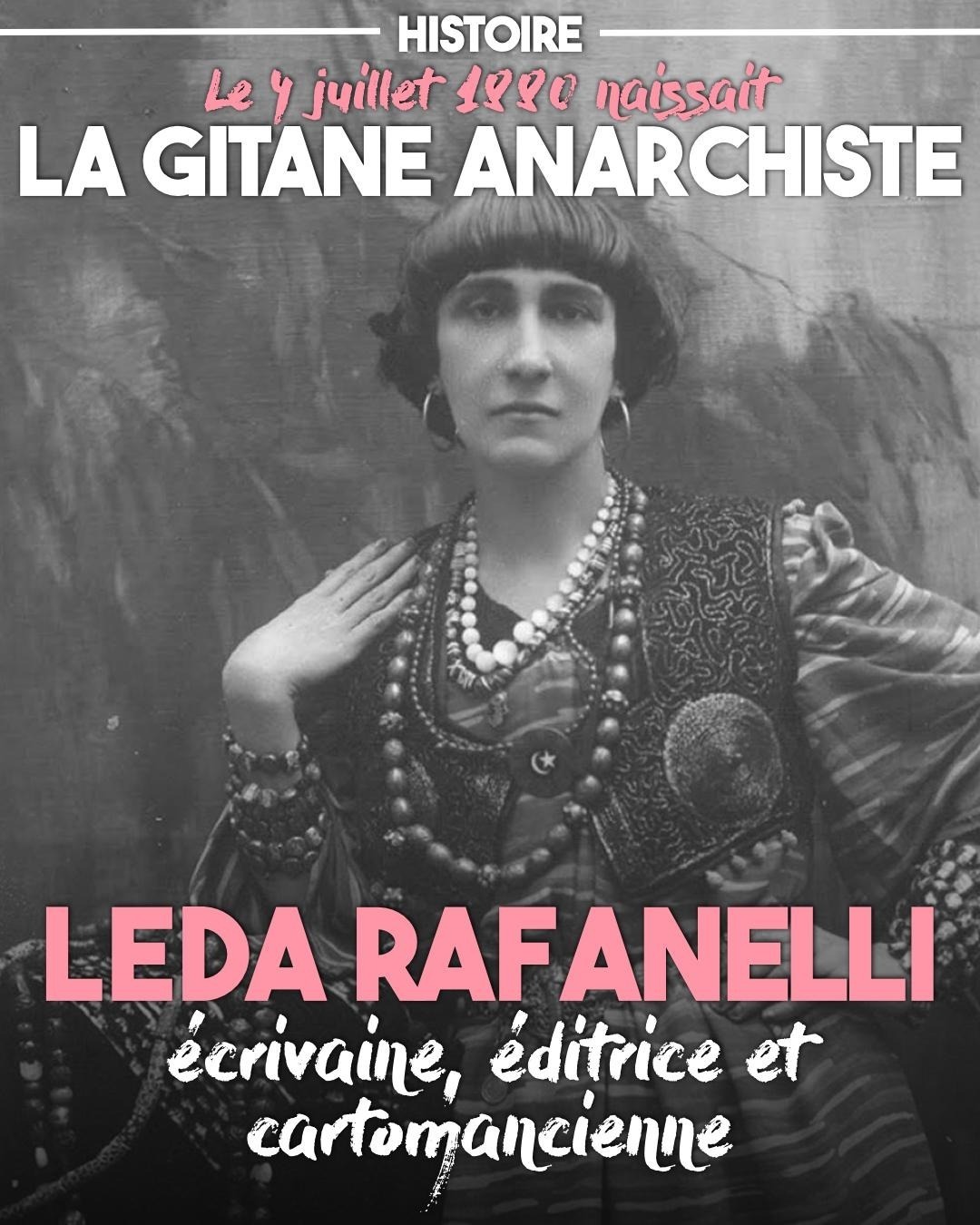

Une réflexion au sujet de « Contrôle social : le mythe de l’enquêteur »
Merci de montrer la voie. la désobéissance individuelle pour amener à la désobéissance organisée et avoir l’espoir de changer la vision du monde qu’on nous impose.